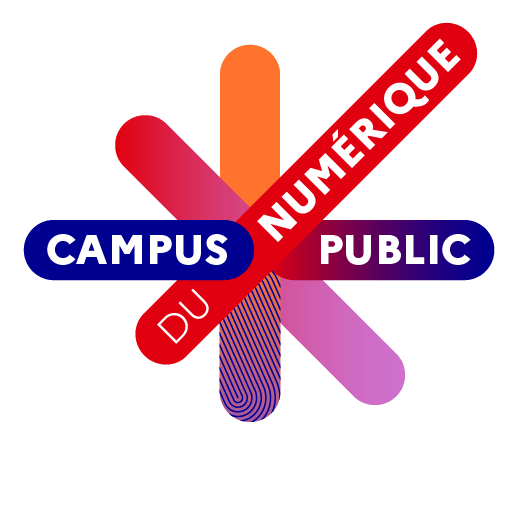Podcast - Le coup de boost Agile
Accéder aux podcasts :
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) Acast (écoute disponible sans inscription)
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) Spotify
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) Deezer
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) Apple podcast
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) Podcast.fr
- (Ouvre une nouvelle fenêtre) Amazon Music
Les transcriptions sont disponibles en bas de la page.

Bande Annonce
Dans cette série de podcasts, nous vous proposons un format vivant pour découvrir et transmettre autrement le numérique public. Après une première saison consacrée aux projets numériques dans les ministères, cette nouvelle saison met le cap sur l’agilité.
Jihane Herizi, psychologue du travail et coach agile, donnera la parole à des figures inspirantes de l’administration… et d’ailleurs. Si vous voulez savoir à quoi peut ressembler un numérique public plus humain, plus audacieux et plus engagé : branchez-vous, et bonne écoute !

Épisode 1 - Campus du numérique public : la souveraineté par la compétence
Et si la souveraineté numérique de l’État passait d’abord par les compétences de ses agents ?
Dans ce premier épisode, Fadila Leturcq, cheffe du Campus du numérique public, raconte comment tout a commencé : une enquête de six mois, une petite équipe pluridisciplinaire, des méthodes agiles… et l’ambition de redonner confiance et pouvoir d’agir aux agents publics.
On y découvre la naissance d’une offre hybride de formations, les premiers retours du terrain, mais aussi les grands défis à venir : intelligence artificielle, passage à l’échelle et résilience des dirigeants.
Un récit inspirant qui montre comment, derrière chaque agent formé, se joue la transformation de l’État à l’ère numérique.

Épisode 2 - La Mélodie Agile (Partie 1) : Mélodie Dahi, un récit d'agilité, de terrain et de conviction
Et si l’agilité dans l’administration commençait non pas par une méthode, mais par un irritant vécu au quotidien ?
Dans ce deuxième épisode, Mélodie Dahi raconte son parcours : entrée à la CNAV, passage par la Direction de la Sécurité sociale, et un jour… l’absurde gestion papier des amendements parlementaires. De cette douleur partagée est née l’idée d’une autre manière de faire : expérimenter, tester, créer — jusqu’à lancer la start-up d’État ZAM, devenue Signal.
On découvre comment un problème apparemment insoluble devient, grâce au réseau, à la confiance et à l’action immédiate, une opportunité d’innovation.
Au fil de la discussion, Mélodie livre aussi sa définition de l’agilité : « la capacité à prendre une décision éclairée et transparente à tout moment ». Elle revient sur ses apprentissages, la bonne distance pour rester engagé sans s’épuiser, et l’importance d’assumer la continuité entre vie perso et vie pro.
Un récit incarné et brut. Enregistré sans montage, comme une conversation vivante entre collègues… et amies.

Épisode 3 - La Mélodie Agile (Partie 2) : Mélodie Dahi, un récit d'agilité, de terrain et de conviction
Dans ce troisième épisode du Coup de boost Agile, Jihane Herizi retrouve Mélodie Dahi pour la suite de son parcours. Après avoir raconté son entrée dans l’agilité (épisode 2), Mélodie partage ici son rôle actuel au sein du département ACE (Appui Conseil Expertise) de la DINUM.
Elle y accompagne des directeurs et directrices de projets et de systèmes d’information dans leurs transitions vers le mode produit et l’agilité, en inventant au passage un métier inédit d’accompagnement interne à l’État.
Au programme de l’épisode :
- comment est née l’activité de mentorat agile au cœur de l’administration,
- la méthode de Mélodie : observation, diagnostic, construction de la confiance,
- trois étapes clés d’une transformation réussie : prise de conscience, réflexes, passage à l’action,
- des anecdotes concrètes qui montrent l’impact d’un changement individuel sur toute une organisation,
- les difficultés rencontrées quand l’accompagnement est choisi… ou imposé,
- et un conseil simple en conclusion : oser un premier pas.
Un témoignage brut et authentique, qui illustre comment l’agilité peut devenir un véritable levier de transformation pour les dirigeants publics et leurs équipes.

Épisode 4 - L'agilité qui panse les blessures humaines par Jihane Herizi
Dans ce quatrième épisode du Coup de boost Agile, Jihane Herizi, psychologue du travail et coach agile à la Direction interministérielle du numérique (DINUM), propose une plongée intime et percutante au cœur de l’agilité humaine.
Elle partage ici une conviction profonde : l’agilité ne sert pas à aller plus vite, mais à souffrir moins.
À travers son regard de psy et de praticienne de terrain, elle explore comment les rituels agiles (daily, rétrospective, revue de sprint, sprint planning) peuvent devenir de véritables gestes de réparation collective, capables de panser les blessures invisibles du travail : rejet, humiliation, abandon, injustice, trahison.
Au programme de l’épisode :
- comment les blessures humaines façonnent nos comportements professionnels,
- la fonction réparatrice de chaque rituel agile,
- les valeurs fondamentales de courage, de respect et d’ouverture vues à travers la psychologie du travail,
- les trois leviers intérieurs d’une transformation durable : la bonne distance, la responsabilité et le 1 % / 7 %,
- et un message fort : quand un agent respire mieux, l’État respire mieux.
Un récit qui relie l’humain, le collectif et le sens du service public.
Une invitation à redonner au travail sa dimension vivante, juste et réparatrice.

Épisode 5 – Répondre à une commande politique publique avec Philippe Vrignaud et Kévin Sériné
Dans ce cinquième épisode du Coup de boost Agile, Philippe Vrignaud et Kévin Sériné, de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), racontent de l’intérieur la réalité d’une commande politique publique : le déploiement, en quelques semaines, d’un dispositif national de médecins dans les déserts médicaux.
Quand une commande politique tombe, tout s’accélère.
Les délais sont courts, les acteurs nombreux, les injonctions parfois contradictoires.
Et pourtant, il faut livrer.
À travers leur expérience, ils partagent les coulisses d’un projet à la fois politique, technique et profondément humain :
– comment transformer une commande imposée en action juste,
– comment préserver le sens du service public quand la politique impose son rythme,
– et comment garder la lucidité nécessaire pour agir sans se perdre.
Un échange sincère sur les contraintes, les arbitrages et les réussites du terrain,
qui montre que l’agilité publique n’est pas seulement une méthode, mais un véritable art du discernement collectif.

Épisode 6 – Protection, Puissance et Permission : les 3 P de l'intrapreneuriat
Dans ce sixième épisode du Coup de boost agile, Jihane Herizi reçoit Philippe, figure singulière de la transformation publique.
Derrière sa voix tranquille, un parcours fascinant : quarante ans de service de l’État, des IRA à la DINUM, en passant par les préfectures de province et la naissance de Démarches Simplifiées.
Avec humour, lucidité et tendresse, Philippe revient sur sa trajectoire d’agent public devenu artisan du numérique.
Il raconte son entrée dans la fonction publique « par défaut », sa découverte de l’analyse transactionnelle dans la Nièvre, et surtout cette posture d’“irrité bienveillant” qui a guidé toute sa carrière : refuser l’obéissance aveugle, écouter les irritants du terrain, et faire, plutôt que briller.
Au fil du récit, on découvre un fil rouge : l’humanité.
Car avant d’être une histoire de code, Démarches Simplifiées est une histoire de confiance, de justesse et de courage.
Au programme de l’épisode :
- Comment un jeune agent sans plan de carrière est devenu un pionnier du numérique public,
- Pourquoi la Nièvre des années 80 a été un laboratoire d’agilité humaine,
- Comment un ordinateur de récupération et une disquette 5 pouces ont changé sa vie,
- Ce que veut dire « faire mieux avec moins » quand on travaille pour l’État,
- Et surtout, pourquoi l’agilité, pour Philippe, ce n’est pas aller plus vite, mais aller juste.
Un épisode vibrant, sincère, et profondément inspirant sur le sens du service public et la beauté du faire.
« Faire, c’est servir. Pas communiquer, pas piloter, pas expliquer. Faire, même petit, même invisible. Parce que c’est ça, le service public : des milliers de petits gestes justes. »

Épisode 7 – Management agile : du contrôle à la permission
Dans cet épisode du Coup de boost agile, Jihane Herizi reçoit Damien Dufourd, coach et entrepreneur, pour une plongée sans filtre au cœur d’un sujet sensible : le management agile et les silos managériaux.
En partant de son expérience au sein de la communauté beta.gouv et de son cabinet WeValue, Damien raconte comment la distribution de l’autorité, la transparence et la co-construction des règles peuvent transformer en profondeur la vie des équipes, sans renoncer aux exigences de performance.
On y parle aussi d’ego, de pouvoir, de peur de lâcher prise… et de la difficulté, très concrète, de passer d’un rôle de “contrôleur” à un rôle de “catalyseur”.
Au programme de l’épisode :
- Pourquoi le management intermédiaire est souvent le point de blocage… et la clé de la transformation.
- Comment casser les silos sans tomber dans l’illusion du “tout horizontal”.
- Gouvernance partagée, consentement, transparence salariale : ce que WeValue a testé (et ce qui n’a pas marché).
- Autonomie, sécurité psychologique et personnalisation du management : rendre les équipes vraiment capables d’agir.
- Le travail intérieur du manager : accepter de ne plus tout décider, de laisser les équipes se tromper, et de se remettre lui-même en mouvement.
Un épisode qui donne des prises très concrètes à celles et ceux qui veulent réinventer le management au quotidien, dans l’administration comme dans le privé.

Épisode 8 – Piloter par l’impact : accepter l’échec, quitter la boule de cristal
Dans cette suite de l’épisode précédent, Jihane Herizi et Damien Dufourd s’attaquent à un mot galvaudé mais décisif : l’impact. Que veut-on vraiment dire quand on parle de “services publics à impact” ?
Et surtout, comment piloter concrètement des politiques publiques autrement que “à la boule de cristal” ?
À partir de l’exemple très concret de Signal Logement (ex-Histologe), Damien montre comment relier investissements, activités, effets pour les usagers et transformations à plus long terme.
La conversation aborde aussi ce que piloter par l’impact implique culturellement : accepter de se confronter à l’échec, de faire moins à budget constant, de renoncer à certaines certitudes… et parfois d’éteindre des projets.
Au programme de l’épisode :
- Ce que “piloter par l’impact” veut dire vraiment, au-delà des indicateurs à la mode.
- L’exemple de la lutte contre le mal-logement : du signalement citoyen à la transformation du parc de logements.
- Pourquoi mesurer l’impact, c’est se confronter au plus dur (échec, incertitude, remise en cause des certitudes politiques).
- Comment créer des “interstices” dans les grands projets pour tester d’autres façons de faire, à risque maîtrisé.
- La différence entre vraie innovation et “théâtre de l’innovation” : investir pour apprendre, pas seulement pour communiquer.
Un épisode sans complaisance, pour toutes celles et ceux qui veulent que chaque euro investi dans le numérique public se traduise en changements concrets dans la vie des usagers comme des agents.

Épisode 9 – IA et Justice : du Shadow IA aux outils agiles souverains
Pour l’épisode 9 du Coup de boost agile, Jihane échange avec Haffide Boulakras, magistrat de l’ordre judiciaire, anciennement au parquet de Bobigny, à Eurojust, à la section antiterroriste de Paris, et aujourd’hui directeur adjoint de l’École nationale de la magistrature.
À partir d’une scène très concrète – un prévenu inconnu des services, interpellé avec une arme – Haffide raconte comment la question de la donnée et de la comparaison des décisions l’a progressivement conduit vers le numérique, les algorithmes, puis l’IA générative.
L’épisode revient sur :
– le passage de la « justice prédictive » à l’IA générative,
– les chiffres inquiétants du shadow AI (des magistrats qui utilisent l’IA sans outil institutionnel ni formation),
– la construction d’outils souverains et sécurisés pour lire, résumer, assister la rédaction et traiter des dossiers volumineux,
– le projet de campus du numérique justice réunissant les quatre écoles (ENM, ENAP, ENG, ENPJJ) pour acculturer et former près de 94 000 agents,
– la question politique centrale : jusqu’où laisser l’IA intervenir sans remplacer la mission humaine de juger.
Un épisode pour comprendre comment l’IA peut rendre la justice plus efficace et plus agile, à condition de rester arrimée à sa boussole : la préservation de l’État de droit.

Épisode 10 – Savoir arrêter un produit public : l’agilité face au réel
Dans cet épisode 10 du Coup de Boost Agile, Jihane Herizi échange avec Arnaud Denoix, directeur de la Plateforme de l’Inclusion, autour d’un sujet encore tabou dans l’action publique : savoir arrêter un produit numérique.
À partir du retour d’expérience sur l’arrêt du service Carnet de bord, Arnaud revient sans détour sur les raisons qui ont conduit à cette décision : absence d’impact réel, indicateurs trompeurs, confusion des objectifs, et responsabilité collective face à l’argent public.
L’épisode explore en profondeur trois piliers essentiels de l’agilité dans le secteur public :
- L’autonomie réelle des équipes, condition de la prise de décision,
- La transparence, notamment sur les objectifs, les usages et les budgets,
- La redevabilité, comme antidote aux projets qui survivent sans valeur.
Ensemble, ils interrogent les biais humains et organisationnels qui empêchent d’arrêter ce qui ne fonctionne plus, les effets des coûts irrécupérables, et les leviers concrets pour créer des garde-fous dès le lancement d’un projet.
Un épisode lucide et utile pour toutes celles et ceux qui pilotent, accompagnent ou financent des projets numériques publics et qui veulent remettre l’impact au centre.
Arrêter un produit peut être un acte de responsabilité.
Transcriptions
Fadila Leturcq : Bonjour à toutes et à tous, curieux du service public de demain.
Je m'appelle Fadila Leturcq, et je pilote depuis 2 ans le Campus du numérique public à la Direction interministérielle du numérique.
La DINUM, pour les intimes.
Le Campus, c’est bien plus qu’un catalogue de formations.
C’est un espace où :
- l’on rassemble,
- valorise
- et déploie l’offre interministérielle de formation au numérique.
Pour accompagner la transformation de l'État.
Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du Campus :
un format, vivant, où le numérique public se raconte et se transmet autrement.
Dans notre saison 1, intitulée "Le numérique dans tous ses états", nous vous avons emmené au cœur des projets en cours dans les ministères.
Et à la rencontre de celles et ceux qui les font vivre.
Pour cette saison 2, cap sur l’agilité !
Elle sera animée par Jihane Herizi Psychologue du travail et coach agile, que vous découvrirez plus en détail dans l'épisode 4.
Je ne vous en dit pas plus !
Jihane, ira à la rencontre de figures inspirantes de l’administration… et d’ailleurs !
Car l’agilité, ce n’est pas juste un mot tendance : c’est une réponse concrète aux incertitudes de notre époque.
Ce n’est pas non plus qu’une méthode :
c’est une culture :
- du mouvement,
- de l’ajustement permanent,
- du doute fécond,
- et surtout, de l’écoute active.
Et quoi de mieux que les récits sans filtres,
- les voix du terrain,
- les erreurs assumées,
- les déclics et les bifurcations courageuses pour se l’approprier vraiment ?
Alors, si vous vous demandez à quoi peut ressembler un numérique public plus humain, plus audacieux, plus engagé… ?
Branchez vous… et bonne écoute !
Ce podcast est produit par la Direction interministérielle du numérique. Si vous aussi vous voulez devenir acteur de la transformation numérique dans la sphère publique, consultez notre site (Ouvre une nouvelle fenêtre) Campus du numérique public.
Jihane Herizi : Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce premier épisode du Coup de Boost Agile. Comme vous l'a dit Fadila Leturcq en bande annonce, parce que j'espère que vous avez entendu la bande annonce, je vais partir durant cette saison 2 à la rencontre de figures inspirantes de l'administration et d'ailleurs, car comme le disait Fadila, l'agilité ce n'est pas juste un mot tendance, c'est une réponse concrète aux incertitudes de notre époque. Tout au long de cette saison, on va donc parler d'agilité, d'agentivité, d'administration, de transformation numérique de l'État.
Avec plusieurs invitées et on commence aujourd'hui l'épisode 1 avec Fadila Leturcq. Bonjour Fadila.
Fadila Leturcq : Bonjour Jihane.
Jihane Herizi : Comment ça va ?
Fadila Leturcq : Ça va très bien, il fait beau et on est en plein été, on a bien mangé.
Jihane Herizi : On a enregistré effectivement en mois d'août. Petit disclaimer, du coup, on n'est pas du tout au bureau, on n'est pas du tout dans un studio.
On a deux micros, un ordinateur, tout comme l'épisode de Mélodie qu'on fera juste après. On est en train de batcher les épisodes et on fait un podcast brut, sans musique, sans montage. On va juste être complètement nous et échanger sur les sujets de l'agilité. C'est quelque chose qu'on avait envie de faire toutes les deux. On avait envie de frugalité, de montrer que c'était possible, qu'on pouvait communiquer de manière agile. Qu'est-ce que tu en penses ?
Fadila Leturcq : Je pense qu'on essaye d'incarner l'agilité comme on essaye de l'enseigner. Donc, typiquement, ce podcast en plein mois d'août, c'est vraiment ça. On a essayé de concrètement l'incarner et de faire nos 1%.
Jihane Herizi : On fait nos 1%, donc on monte ce podcast de façon Lean, le Lean Startup, qui est la méthode de base de l'agilité. Donc, si un téléphone sonne, un chien aboie, une porte frappe, on bafouille, on se perd dans nos mots, ce n'est pas grave, tout va bien. Vous allez nous suivre tout au long de ce podcast de manière très authentique. Fadila, tu le disais dans la bande-annonce, très justement, ça fait deux ans que tu diriges le campus du numérique public. Ce campus auprès duquel j'ai une mission depuis quelques mois et avec lequel je travaille avec joie, avec toi et Mélodie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, avant de commencer à parler d'agilité, on va poser les bases. Qu'est-ce que c'est le campus du numérique public et surtout, pourquoi le campus du numérique public ?
Fadila Leturcq : Alors moi, je suis arrivée à la DINUM en 2020. Je ne suis pas du tout venue pour m'occuper du campus initialement. J'étais sur des sujets de transformation numérique, de stratégie numérique, absolument pas ancré dans les sujets de formation numérique. Et ces sujets-là étaient un peu portés, mais pas à grande échelle. Et donc, en fait, en 2023, le campus du numérique public a été créé. En fait, la volonté, c'était de répondre à un problème qu'on avait identifié. C'était que l'État ne peut pas transformer sans investir dans les compétences de ses agents. Et en fait, pendant longtemps, la DINUM a joué un rôle de DSI de l'État, d'incubateur, d'opérateur, de soutien, d'accompagnement. Mais la transformation numérique, elle s'est faite à vitesse grand V. Et quand une transformation numérique se fait à grande vitesse, on a besoin de talent pour soutenir tout ça. Or, le sujet RH était un petit peu dans l'angle mort de l'accompagnement interministériel. Donc, nous, on faisait très bien les produits, on accompagnait très bien sur les expertises. Néanmoins, sur les sujets des RH, les administrations venaient nous dire qu'on n'est pas assez attractifs, qu'on a du mal à retenir les talents. Aujourd'hui, il n'y a pas de concours dans la fonction publique qui mène à des métiers numériques dans l’administration. Donc, comment on fait pour tenir la cadence ? Et donc, en 2023, ça a été un petit peu un moment fondateur. Là, je parle d'avant la création du campus, parce que pour la première fois, on a eu un rapport qui est le rapport IGF-CGE sur les compétences numériques de l'État, qui faisait état des talents numériques dans l'État, en fait, du nombre de talents qu'on avait, sur quelles expertises, et qui se projetait sur les cinq ans à venir, sur les besoins futurs de l'administration. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment investir sur le sujet et qu'il fallait prendre un cap RH un peu plus affirmé.
Jihane Herizi : Ce rapport qu'on mettra, d'ailleurs, dans les notes de l'épisode du podcast, que vous pourrez lire pour pouvoir comprendre ce que vous raconte Fadila en images. J'imagine qu'il doit y avoir des graphiques et des chiffres.
Fadila Leturcq : Exactement.
Jihane Herizi : Tu me disais que ce sujet n'était pas nouveau.
Fadila Leturcq : Alors oui, ce sujet n'est pas nouveau parce que la mission talent de la DINUM, donc, en fait, la DINUM était dotée d'une mission talent qui avait la charge de faire quelques actions en interministériel, des actions mutualisées au service de l'attractivité des talents numériques et également quelques actions de formation, voire de création de parcours de carrière interne. Donc, c'était un salon, c'était un salon, pardon, c'était une mission.
Jihane Herizi : Il y avait un salon.
Fadila Leturcq : Et voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire.
Jihane Herizi : Il y avait un salon de recrutement, je me rappelle.
Fadila Leturcq : C'était une mission qui proposait un salon de recrutement de l'emploi tech de l'État, des emplois tech de l'État. C'était une mission qui proposait une grille de rémunération. La première grille de rémunération, elle a été faite sous cette mission. Il y a eu quelques expérimentations, par exemple, la création d'un site qui concentrait l'ensemble des offres interministérielles. Donc, c'est aussi une mission qui se donnait le droit d'expérimenter des choses au service de l'attractivité et de la rétention. Donc, elle a quand même posé les bases de ce qui est venu faire après le campus, ainsi que d'autres services aujourd'hui qui constituent la DRH de la filière numérique de l'État. Et donc, comme je disais, en 2023, cette mission existait. Mais vraiment, ce rapport a marqué un cours, un coup d'accélérateur, en fait, dans la façon dont on abordait les RH dans l'État. Et donc, première pierre, entre guillemets, de l'évolution de l'État sur ces sujets RH de la filière numérique, ça a été la création du campus du numérique. Et quelques mois plus tard, la création d'une DRH de la filière numérique de l'État, qui est hébergée à la DINUM et qui vise à attirer, retenir, accompagner tous les talents numériques de l'État.
Jihane Herizi : Il y avait une volonté, tu me disais, de réduire un peu la dépendance aux prestataires privés. C'est quelque chose sur lequel tu es experte. D'ailleurs, tu interviens, il me semble, en école sur cette question du conseil. C'était quoi la volonté de créer le campus et cette DRH ?
Fadila Leturcq : Alors oui, je te confirme. En fait, 2023, je te dis, c'était un moment fondateur parce qu'il y a eu ce fameux rapport. Mais en fait, tout ça s'inscrit dans un contexte un peu plus large, qui est une volonté de réduire la dépendance aux prestataires privés, mais aussi des enjeux de souveraineté numérique qui sont grandissants et surtout une attention de l'État beaucoup plus marquée sur ces sujets-là. Pour la dépendance aux prestataires privés, en fait, on a eu, je ne vais pas revenir sur la polémique qui cible un certain cabinet de conseil. Néanmoins, on a eu beaucoup de réflexions post-Covid sur l'usage des cabinets de conseil au service des politiques publiques et du service public. Et on s'est rendu compte qu'on était en déficit de compétences sur certaines expertises de l'État. Les compétences numériques en font partie. Donc, tu disais qu'effectivement, j'avais développé une expertise là-dessus. En gros, si je te raconte rapidement, mais on n'est pas là pour raconter ma vie, mais si je te raconte rapidement, moi, initialement, avant d'arriver à la DINUM, j'étais dans le conseil. J'ai fait quelques années au sein de ce qu'on appelle un Big Four, donc un gros cabinet de conseil qui accompagnait des organisations publiques comme privées sur des enjeux managériaux. Donc, j'ai eu un pied dans le conseil, j'ai été consultante et j'ai décidé de rejoindre la DINUM parce qu'en 2020, le DINUM de l'époque avait décidé de créer un cabinet de conseil interne à l'État. Et donc, moi, je trouvais que l'aventure était intéressante parce que ça a participé de cette dynamique de réinternalisation des compétences. Et je trouvais ça intéressant d'avoir une in-house advisory team qui puisse accompagner les administrations et apporter un peu d'harmonie dans leur façon d'aborder le numérique. Et donc, moi, mon premier job à la DINUM, ça a été consultante interne à l'État en stratégie numérique. Et donc, j'ai pu voir la différence entre le conseil en externe quand on s'adresse aux services publics et le conseil en interne.
Et donc, moi, j'ai été passionnée par tous les débats autour du recours au cabinet de conseil. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au sein de l'État, il y avait quand même énormément de talents qui n'étaient pas suffisamment exploités, formés, accompagnés pour pouvoir faire face aux grands enjeux du numérique. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'administrations se tournent vers des prestataires privés, voire même organisent leur dépendance à ces prestataires privés. Et donc, déjà, sur la base de ce constat, on va dire que ça a donné un sens à ma mission au sein de la DINUM. Et au-delà de ça, c'est un sujet qui a interpellé beaucoup l'opinion publique. Et donc, j'ai décidé, sur sollicitation de Sciences Po, de monter un cours sur le sujet à destination des élèves en affaires publiques à Sciences Po.Et donc, en fait, depuis trois ans, je donne un cours sur l'enjeu de la réinternalisation des compétences numériques et de s'affranchir de la dépendance au cabinet privé. On se rend compte que l'État doit s'organiser là-dessus. Et le campus est justement là aussi pour répondre à ce besoin.
Jihane Herizi : Oui, parce que du coup, le campus forme, en continu de ce que j'ai compris, les agents de la fonction publique d'État.
Fadila Leturcq : Exactement, un peu plus même. En gros, initialement, le campus a été créé pour les agents de la fonction publique d'État. Donc, notre cible, c'est les agents de la fonction publique d'État. Mais il s'avère que, en fait, l'enjeu de formation numérique dépasse la seule fonction publique d'État. Il concerne toute la fonction publique. Et donc, en fait, pour le moment, depuis sa création, je t'avoue qu'en fait, sur plein de formations, on a des agents de la fonction publique territoriale, mais aussi hospitalière. Là, par exemple, on est en train de travailler avec l’AP-HP sur la formation de ces cadres dirigeants au numérique. Donc, nous, ça nous intéresse aussi d'aller voir les trois versants de la fonction publique. Ce n'est pas forcément notre mandat initial, mais quand on voit qu'il y a un problème ou un besoin dans une administration, on prend le challenge de s'y attaquer. Donc, voilà, le campus s'adresse vraiment à la fonction publique au sens large.
Jihane Herizi : Le campus agrège l'existant et les acteurs de la formation numérique. En tout cas, c'est la volonté, c'est le why, c'est l'objectif, c'est ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire vouloir arriver au maximum et toujours s'en rapprocher. Mais en fait, en réalité, on ne peut jamais avoir 100% de l'offre, même si on cherche à l'atteindre. Il y en aura toujours, toujours des nouvelles choses, toujours des nouveaux acteurs, toujours des nouvelles formations. Et le but du campus, c'est de se rapprocher au maximum de comment on agrège tout ça.
Fadila Leturcq : Exactement. En fait, aussi, la raison d'être du campus, elle a été, on va dire, nourrie par le fait que quand on est agent public, quand on était agent public en 2023 et qu'on cherchait une formation numérique, naturellement, on se tournait vers nos RH de proximité. Sauf que le numérique, ça va très vite et que les RH de proximité n'avaient pas forcément les catalogues à jour, ni la vue sur toute l'offre interministérielle. Donc déjà, ça, c'était un premier constat. Ensuite, deuxième constat, c'est que les administrations ne nous ont pas forcément attendus pour former leurs agents numériques, mais elles avaient déjà fait des choses et il était important de les mettre en visibilité. Donc, le campus, c'était aussi une vitrine pour ces administrations, pour montrer ce qu'elles avaient déjà fait et ce que l'on pouvait faire passer à l'échelle. Je donne un exemple très concret. Pendant le plan de relance, donc ça, c'est ça précédait la création du campus du numérique. Pendant le plan de relance, il y avait des guichets qui étaient dédiés à la formation numérique des agents publics et l'IGPDE à Bercy, qui est l'organisme de formation de Bercy, avait créé ce qu'on appelle le cycle supérieur du numérique, c'est un cycle pour les cadres supérieurs, cadres dirigeants, qui est dédié à leur formation numérique et qui s'adresse à des agents de la fonction publique. Ce cycle-là était initialement dédié aux agents de Bercy. Et bien, il a tellement bien fonctionné et on en voyait tellement bien l'utilité que pendant le plan de relance, la DINUM a financé son interministérialisation. Donc, en gros, on est aussi venus, nous, le campus, on est aussi là pour augmenter, entre guillemets, ce qui existe dans les ministères et le faire passer à l'échelle parce qu'il y a des choses exceptionnelles qui sont faites sur le terrain. Et en fait, le rôle de l'interministériel, c'est de coordonner tout ça, de mettre en lumière et d'accélérer.
Jihane Herizi : Donc, agréger l'existant, être soi-même un acteur de la formation, puisque le campus crée des formations dont tu vas nous parler juste après. Moi, j'ai vraiment une question. Pourquoi t'as pris la tête du campus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est ton « why » profond ? Pourquoi tu t'es dit « je dois prendre la tête de ce département et en faire quelque chose » ?
Fadila Leturcq : Alors, moi, je crois... J'ai beaucoup baigné dans les sujets qui traitent à la défense, à la souveraineté, etc. Donc, pour moi, la souveraineté numérique, ça a toujours été un grand sujet d'attention. Déjà, quand je suis arrivée, que j'ai mis un pied à la DINUM en tant que consultante interne en stratégie numérique, le sujet de la souveraineté m'a torturée, animée. Enfin, vraiment, ça a été passionnant de voir la façon dont les administrations se l'appropriaient et la façon dont ils organisaient leurs programmes, leurs services pour pouvoir y concourir. Je t'ai évoqué le sujet du recours au cabinet de conseil, qui a encore plus relevé mon attention sur ce sujet. Mais il y a un truc, moi, que j'ai constaté, c'est qu'on ne transforme pas l'État sans transformer les femmes et les hommes qui font l'État, en fait. Ce n'est pas possible de donner, de faire des injonctions à la transformation numérique sans accompagner les personnes qui composent l'État, les personnes qui vivent le numérique au quotidien, les personnes qui vont faire usage des outils numériques et des services que l'on crée. Donc, moi, j'ai une conviction profonde, c'est que la souveraineté, ça passe aussi par la compétence. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi j'ai voulu, on va dire, prendre le pilotage de ce projet, à savoir la création du campus. Et autre chose, c'est que quand j'étais consultante interne en stratégie numérique, j'ai rencontré énormément d'agents publics de plein de ministères et j'ai vu que, alors, ils n'étaient pas dépossédés des sujets numériques. Néanmoins, j'ai vu qu'il y avait un fort potentiel pour qu'ils puissent mieux se les approprier. Et je pense que les former, c'est aussi leur redonner davantage confiance en la transformation numérique et en la façon dont elle est menée, parce qu'on en fait des acteurs. Donc, pour moi, c'est vraiment leur redonner de la maîtrise, leur redonner du pouvoir. Voilà, c'est un petit peu les deux moteurs qui m'ont poussée à prendre le pilotage du campus du numérique. En fait, pour moi, c'est la mission du campus. Aujourd'hui, elle est essentielle, tant pour l'État et ses services que pour les usagers du service public.
Jihane Herizi : De ce que j'entends, finalement, tu résumes ça à la souveraineté, donc la souveraineté personnelle pour aider à la souveraineté de l'État. En fait, on ne peut pas avoir la souveraineté de l'État si les agents ne sont pas souverains d'eux-mêmes et de leur formation et de leurs compétences. Finalement, on pourrait résumer le campus à reprendre du pouvoir, de la maîtrise, de la souveraineté sur soi pour aider l'État à le faire.
Fadila Leturcq : Tu as parfaitement résumé ma pensée.
Jihane Herizi : Ou alors, c'est toi qui a été hyper claire en l'expliquant rapidement comment il a été créé, parce qu'on parle d'agilité quand même dans ce podcast. Et moi, depuis quelques mois, je travaille avec toi et je trouve que ta façon de travailler est très agile et à trois avec Mélodie, qu'on entendra dans l'épisode d'après. Il y a une façon de fonctionner, t'as une façon de fonctionner, t'as une façon d'avoir créé le campus tous les jours, de le mener, de le manager qui est agile. Est-ce que tu nous racontes un peu l'irritant, le problème, la solution, le besoin, les utilisateurs, l'équilibre, comment t'as fait de manière agile le campus ?
Fadila Leturcq : Alors, ça a été une création en plusieurs étapes, ça a été très long. Il faut savoir que l'investigation sur le problème préexistait avant d'arriver sur le campus. Donc, il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est la mission talent qui, dans le cadre de ces missions, avait identifié un vrai sujet autour de la formation aux compétences numériques et des remontées interministérielles sur ce sujet. Moi, à l'époque, j'étais encore consultante interne, même si je percevais des besoins et que je faisais moi-même remonter à la mission talent. Je n'étais pas encore pleinement engagée dans ce sujet. Et donc, en gros, l'idée, c'était d'aller comprendre quels problèmes les administrations, on va dire, avaient en matière de formation numérique. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on a géré le plan de relance numérique à la DINUM, il y a deux guichets dédiés aux compétences numériques, à la formation aux compétences numériques qui ont été créés et qui ont permis de financer des projets de formation aux numériques qui étaient proposés par plusieurs administrations. Ça, ça nous a permis de faire un premier constat.
Les besoins sont grands, les moyens sont petits, pas forcément au rendez-vous. Déjà, il faut plus investir. Il fallait plus investir dans la formation aux numériques parce qu'on voyait les besoins exploser, mais pas forcément les moyens dédiés au sein des administrations à ce sujet. Donc, déjà, un vrai problème de moyens alloués à la formation aux compétences numériques, alors que c'était un sujet grandissant et en plus qui a explosé pendant le Covid. Premier constat. Deuxième constat, c'est qu'au détour d'échanges avec des agents, on se rendait compte qu'un agent de la filière numérique, par exemple, qui allait demander une formation à un langage informatique ou une formation à une nouvelle technologie à ses RH, se heurtait parfois à un manque de culture numérique de la part des services de ressources humaines et une incapacité à remplir le besoin des agents de maintenir en condition leur compétence, voire de monter en compétence. Et donc, il y avait une tendance à l'auto-formation des agents. Et on sait très bien que dans plein d'organisations, la formation, c'est un facteur de rétention. C'est un facteur d'accompagnement des talents dans leur carrière. Or, aujourd'hui, là, on était, je ne dis pas aux abonnés absents, ça dépend des administrations, mais on n'était pas suffisamment solide pour répondre aux besoins des agents qui faisaient le numérique du public. Et à côté, on avait des agents qui voyaient une vague d'outils numériques arriver, des nouvelles pratiques arriver, du travail collaboratif arriver et qui n'étaient pas forcément dotés, outillés en termes de compétences pour absorber cette vague. Donc, quand on n'est pas doté et outillé en termes de compétences, naturellement, soit on a peur de ce qui arrive, soit on rejette ce qui arrive, soit on s'extrait. En fait, on a plusieurs mécanismes qui se créent. Et donc, là, l'idée, c'était de les rassurer en leur donnant la compétence qu'il faut au bon endroit, au bon moment. Et après, un autre problème qu'on a identifié, c'est qu'on a des cadres dirigeants et des cadres supérieurs dans l'État. On en a 25 000 et je ne sais pas si tu te souviens. Il me semble que c'était au début du second mandat du président de la République. Il a été demandé à l'administration de former les 25 000 cadres dirigeants et supérieurs de l'État à la transition écologique parce que c'est un enjeu d'aujourd'hui, c'est un enjeu de demain et il faut absolument que les décideurs publics puissent, on va dire, embrasser cet enjeu en ayant les compétences qu'il faut. Et donc, nous, ce qu'on constatait, c'est que sur le numérique, on avait encore énormément de cadres dirigeants et supérieurs qui étaient insuffisamment formés à ce sujet. Donc, on a été creuser ce sujet, ces problèmes, pardon, ces multiples problèmes que j'ai cités. Et pour ça, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'il y a eu une alliance entre la mission talent de la DINUM et BetaGouv, donc Mélodie, je crois, qui intervient dans l'épisode d'après. Mélodie a été la personne chez BetaGouv qui a mené l'investigation pour comprendre ces différents problèmes, avec une personne de la mission talent qui est désormais dans l'équipe du campus qui s'appelle Marie. Et donc, toutes les deux ont fait, il me semble, plusieurs mois d'investigation, je crois, trois mois d'investigation pour bien explorer ces problèmes. À partir de ça, elles ont élaboré un diagnostic et c'est de là qu'a émergé l'idée de la création d'un campus numérique public.
Jihane Herizi : BetaGouv, donc c'est beta.gouv.fr, on en parle avec Mélodie dans l'épisode d'après pour vous raconter un peu ce que c'est, comment elle y a travaillé et comment elle a créé son propre produit, startup d'État. On ne va pas s'étaler sur BetaGouv ici. Vous pouvez découvrir plus d'informations dans l'épisode avec Mélodie. Donc, elles font une investigation. Mélodie nous racontera dans l'épisode d'après, d'ailleurs, comment elle a investigué une autre startup d'État. Elles en font un diagnostic. Elles se rendent compte, du coup, que le problème est bien valide. Finalement, c'est un multiproblème, mais qui revient au problème que tu disais, du manque de souveraineté personnelle de ces compétences numériques. Et donc, je ne suis pas souverain de mes compétences. Je ne peux pas aider l'État à le devenir, qui ensuite est découpé en plein de mini-problèmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Dès que le problème est validé, c'est oui, on a compris, il y a des problèmes.
Fadila Leturcq : Voilà, elles le présentent. Moi, en parallèle, j'étais encore consultante et je m'intéressais à ce sujet de réinternalisation des compétences. Donc, je commence à échanger avec cette petite équipe en leur disant « Attendez, là, vous voyez bien qu'on a plein d'injonctions, on a des circulaires PM qui nous disent qu'il faut réinternaliser les compétences numériques. Et si on commençait par le conseil ? C'est un sujet que je connais bien. Je suis consultante interne, donc venez, on monte un parcours sur ce sujet. Donc, on commence à réfléchir à la création d'un parcours sur ce sujet. Et naturellement, moi, j'arrive à la fin de mes trois ans en tant que consultante interne, j'ai un passé de RH aussi. Ça, je ne te l'ai pas précisé, mais moi, j'ai un passé de RH. J'ai fait du conseil RH, j'étais dans un think tank dédié à des DRH. J'ai fait des RH dans un gros groupe de l'automobile. Et donc, je commence à m'intéresser à ce sujet de la formation. Et je me dis, pourquoi pas allier, on va dire, l'accompagnement que j'ai fait auprès des administrations avec cet enjeu de réinternalisation des compétences, de formation et de souveraineté ? Et donc, c'est à ce moment-là que je prends le pilotage du campus. Donc, je change de poste, c'est une mobilité interne. Et donc, il y a cette investigation. La direction prend la décision de créer le campus. Je suis recrutée pour prendre le pilotage du campus. Et ensuite, on crée une équipe parce que c'est important de créer une équipe.
Jihane Herizi : Vous avez créé le premier produit avant que l'équipe se monte ?
Fadila Leturcq : Alors, sur les produits qu'on a faits, ça a été tout simple. Ça a été une cartographie de l’existant en interministériel et une mise en visibilité. Ça a été un catalogue de formation.
Jihane Herizi : La base finalement. D'abord, on regarde ce qui existe.
Fadila Leturcq : Exactement.
Jihane Herizi : Vous le faites comme des produits, en fait, vos produits de formation. C'est comme les services publics numériques dont on parle aujourd'hui. Vous êtes partie d'un problème et d'un besoin. Vous avez créé le parcours. Puis ensuite, j'imagine, vous avez testé et déployé, c'est ça ?
Fadila Leturcq : Exactement. En fait, on a conçu déjà la méthode d'investiguer le problème. Ça nous a tout de suite mené à penser agile quand on a réfléchi la conception de ce campus. Mais on s'est dit, on ne veut pas faire une énorme boîte avec des offres de formation dans lesquelles les administrations viennent s'adapter. On ne veut plus être dans une posture où nous, on propose des choses, en regard d'observation de terrain, donc des problèmes identifiés ou des besoins identifiés. On crée des produits de formation sur lesquels on itère, parce qu'il ne veut surtout pas se dire que la façon dont on délivre des compétences en 2023 sera la même qu'en 2025 ou en 2027, on le voit déjà. L'IA est venue complètement bouleverser à la fois notre offre de formation et même toutes les réflexions interministérielles qui arrivent. Donc, on a vraiment, on s'est dit, on crée le campus, c'est une marque, c'est une vitrine, c'est plein de choses. Ce n'est pas forcément le produit, le campus, mais dans le campus, il y a plein de produits. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé un petit peu cette organisation. En fait, on a pensé, on s'est mis à la place des agents publics, on s'est dit, je suis agent, j'ai envie de me former au numérique, c'est au campus que je dois aller et dans le campus, je vais aller consommer tel, tel, tel, tel produit. C'est comme ça qu'on a pensé le campus. Et donc, là, l'idée, c'est à ce moment-là, au moment de la création du campus, c'est de se dire, bon, OK, maintenant, il faut former au numérique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va le faire ? De quoi ? D'où on part ? Qui va le faire ? Qui va le faire ? Donc, en gros, on a déjà commencé par créer une équipe. Je pense que c'est important parce que... Donc, Marie, qui faisait partie de la mission talent, s'est complètement greffée au projet et elle a été aux prémices de la création de ce campus. On a ensuite recruté une personne qui est fonctionnaire, qui connaît bien l'administration, qui a fait de la formation à l'INRIA par le passé, qui a fait les IRA et qui avait une connaissance profonde de l'administration parce qu'on trouvait ça important. Nous, en interministériel, comme on aborde un sujet qui est très administratif, la formation, d'avoir une personne qui ait à la fois la connaissance des enjeux de formation et la connaissance de l'administration. Et on a ensuite été recruté une ingénieure pédagogique. Donc, l'idée, c'était d'avoir une équipe pluridisciplinaire, complémentaire, qu'on n'ait pas des profils uniformes, d'une diversité d'expériences, de statut, de connaissances du numérique, etc. pour aller vite. Parce que le besoin était pressant et faire bien aussi. Parce que moi, je crois au fait qu'il faut qu'on ait des diversités de vues, en tout cas dans une équipe.
Jihane Herizi : Du coup, c'est marrant parce que tu dis, on n'a pas pensé le campus comme un produit de base. Finalement, le campus est un produit, tu es intrapreneur aujourd'hui.
Fadila Leturcq : C'est un macro-produit fait.
Jihane Herizi : C'est un produit, Instagram est un produit, LinkedIn est un produit. Ça n'existe même pas macro, c'est que tu peux aller jusqu'au bout du monde avec un produit. Mais du coup, le campus, finalement, est un produit avec des sous-produits. Donc, tu es l'intrapreneur avec cette équipe. Et vous avez fait un truc agile dont on parlera aussi avec Mélodie, c'est finalement, on ne recrute pas des postes. On n'a pas été chercher une personne qui fait ça, qui fait ça, même si vous avez recruté une ingénieure pédagogique. Mais l'idée, c'était de faire une cartographie de quelles compétences on a besoin dans une équipe agile pour que ça fonctionne et pour qu'on aille vite. Et OK, il y a telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et je crois comprendre que jusqu'à maintenant, c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est quels sont les trous dans la raquette en termes de compétences ? Ça ne m'intéresse pas de chercher un poste ou une typologie de poste, en fait, de fiche de poste. C'est cette personne a cette compétence-là. Il nous manque cette compétence.
Et comment on crée une équipe agile ? Et c'est ça que vous avez fait, qu'on a fait et qu'aujourd'hui on est. Finalement, on a un peu toutes les compétences dans l'équipe. Peu importe notre poste, finalement.
Fadila Leturcq : Exactement.
Jihane Herizi : La preuve, c'est qu'on fait un podcast aujourd'hui, alors qu'on n'est pas des podcasteuses. C'est juste que j'ai la compétence du podcast et ainsi de suite. Et on fait des choses qu'on ne fait pas : on fait le café, on fait des impressions…
Fadila Leturcq : C'est ça, déplacer les chaises…
Jihane Herizi : Les goodies et des kakémonos… En fait, on fait tout, mais on a chacune des appétences pour des choses. Et chacune dit en fait, moi, c'est OK, je vais faire ce truc-là. Je vais déménager tel truc. C'est OK pour nous, en fait. On est en mode start-up, en fait.
Fadila Leturcq : On est en mode start-up. On n'a pas voulu créer une structure avec un organigramme. Et on s'est dit, il nous faut ça, il nous faut ça. Non, parce qu'on ne savait pas encore où on allait. Mais on savait qu'on avait besoin de force vive et que si demain, on devait créer un produit de formation, eh bien, on avait des compétences qu'il fallait autour de la table pour pouvoir le faire.
Jihane Herizi : Mais des compétences, surtout, c'est pas des compétences du type, cette personne, elle fait tel métier, cette personne, sa zone de génie, son kiff. Et ce qu'elle fait dans la journée, qu'elle adore, c'est ce truc-là.
Fadila Leturcq : De savoir-être et de savoir-faire.
Jihane Herizi : Mais ce n'est pas un métier, en fait. Quand on envoie la newsletter toutes les semaines, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la com qui le fait. C'est chacun, on va dire, moi, je vais apporter cette bille-là. Et finalement, l'agilité, c'est ça aussi. C'est de savoir reconnaître ce qu'il y a derrière un CV et ce que les gens te disent en fait, ah tiens, ce truc-là, je pourrais le faire. Et ce truc-là, je n'ai pas trop envie, mais il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui est OK pour le faire. Et donc, c'est de savoir se mouvoir un peu dans ce genre d'équipe, en tout cas pour être agile. Super.
Et bien évidemment, on va parler d'impact. Parce que là, on a parlé de problèmes. On a parlé de débit de solution, construction de produits. On a parlé d'équipe et on essaye... En tout cas, moi, je te vois agir au jour le jour sur le bien-être de l'équipe, la santé mentale de l'équipe. C'est un des critères dont on parle dans le booster agile, le cahier de vacances, les formations à l'agilité. Et bien évidemment qu'on va avoir un épisode que je vais tenir dans l'épisode 4 sur la santé mentale. Mais il y a le deuxième pan de l'agilité, qui est l'impact recherché du produit. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça ?
Fadila Leturcq : Alors, la formation, c'est toujours, c'est toujours compliqué de mesurer l'impact d'une formation. Et ça, je pense que c'est partagé par des entreprises privées comme des organisations publiques. Quand on forme, on ne sait pas si la compétence est bien acquise. Donc, il faut déjà mesurer ça. Et on ne sait pas comment elle va être déployée dans le quotidien des agents, des salariés, dans la pratique. Et ça, qui la mesure ? Et ça, qui la mesure ? Qui peut mesurer ? Est-ce que c'est les formateurs ou les managers ou l'agent lui-même qui peut sonder ? C'est vrai que ça a été un casse-tête. Donc, effectivement, on s'est beaucoup creusé, creusé, creusé, creusé les méninges pour se dire quel impact est recherché par le campus. Alors, on a été aidés. C'était super dès le départ parce qu'on a fait en sorte, comme je te disais, d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Je t'ai dit qu'on avait recruté, mais on s'est aussi fait aider de Félix. Félix, qui travaillait pour des startups d'Etat déjà et qui est venu un petit peu nous partager la méthode startup d'Etat et la façon dont l'impact a été créé. En tout cas, pensé dans nos startups. Et donc, en fait, nous, on va essayer au campus, pas seulement de se contenter de seulement faire l'acte de formation. Ça, ce n'est pas notre objectif. On va le faire. On va le faire très bien. On va le mesurer. On va se dire, dans telle administration, tant d'agents bénéficient de X jours de formation numérique. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas forcément là où on a notre impact. Nous, on va essayer d'identifier la chaîne de valeurs sur laquelle nous, on intervient et essayer d'aller sonder à chaque maillon de la chaîne la façon dont notre acte de notre action de formation a eu des effets. Si je prends l'exemple de l'agilité, en gros, quand on forme à l'agilité, on n'a pas juste mesuré le temps qu'on a dédié à la formation et le nombre d'agents qu'on a formés. On va aller voir la façon dont les agents évoluent à trois mois, six mois, un an. Ça, c'est hyper important pour nous. On va aller voir aussi, par exemple, si ça leur a permis d'avoir une mobilité, cette formation, si ça leur a permis d'évoluer dans leur pratique. L'impact va être évalué par du « a posteriori » de la formation, beaucoup plus que sur l'acte de formation en lui-même. C'est toute la complexité, on n'est pas sur un service numérique sur lequel on va avoir des stats et des datas bien élaborés. C'est un travail de longue haleine. Un acte de formation qu'on fait aujourd'hui, il faudra qu'on en évalue les impacts dans un an, un an et demi.
Jihane Herizi : Et l'impact dans un an et demi, ça peut être juste « j'ai quitté mon poste, j'ai changé de poste, ça va mieux dans mon équipe ». Il y a tellement de mesures d'impact finalement qualitatives, autant que quantitatives.
Fadila Leturcq : Exactement. Et par ailleurs, la complexité autour du numérique et des produits qu'on a au sein du campus, c'est que l'impact ne va pas être le même d'une formation à une autre. Oui. Parce que là, quand on forme à l'agilité, ce n'est pas la même chose que former un développeur à l'accessibilité parce qu'il est obligé de se conformer aux standards d'accessibilité. Alors que l'agilité, c'est une posture, mais il n'y a pas forcément d'obligation sur le reste. Donc en fait, l'impact, on ne va pas le mesurer de la même façon en fonction des formations qu'on délivre.
Jihane Herizi : Sur des formations de type obligatoire, en tout cas certifiantes ou qui te permettent de faire un acte obligatoire, à une formation qui est un must-have, une bonne chose pour toi.
Fadila Leturcq : Exactement.
Jihane Herizi : Très bien.
Fadila Leturcq : Après, que te dire sur la création du campus ? Je te disais, c'était plusieurs étapes. Et tu as évoqué quelque chose tout à l'heure, tu as parlé de cartographie, de savoir où on en était. Et comme je t'ai dit, notre premier produit, ça a été de créer un catalogue de formations sur la base de l'existant. En fait, ça, ça a été notre premier job, se situer dans l'existant. Parce qu'on arrive en interministériel avec ce grand projet, mais il ne faut pas oublier qu'on avait, nous, déjà fait des choses, que les ministères avaient déjà fait des choses, que le plan de relance a permis de financer des choses. Et moi, j'ai une conviction, c'est que quand on refuse de s'appuyer sur les briques existantes, qu'on repart de zéro, qu'on cherche à innover à tout prix, qu'on cherche à tout redéfinir, en fait, on s'isole. Et moi, ce n'était pas mon objectif. Moi, je me suis dit, le campus doit rassembler tous les acteurs de la formation au numérique interministériel et tout ce qui a déjà été fait. Donc, en fait, la V1 du catalogue, ça a été d'identifier, de cartographier tout ce qui avait déjà été fait par les ministères, de mettre en visibilité, voire de proposer aux administrations d'ouvrir des places en interministériel. Ça, ça a été vraiment notre premier job.
Jihane Herizi : C'est important parce que ça vous permet aussi de savoir où placer votre énergie. On a tout ça. Et maintenant, les trous dans la raquette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, quel est le problème ? Où est-ce que ça manque d'acteurs ? Où est-ce que ça manque de formation, etc.
Fadila Leturcq : Là, c'est ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Effectivement, ça nous a permis d'identifier les angles morts. Et en fait, ça nous a permis d'aller, en tout cas dans notre production, vers des produits de formation qui n'existaient pas, qui n'existaient pas. Et pour moi, c'est là où on a notre 0 to 1. C'est là où on a une vraie valeur ajoutée en tant que campus. C'est qu'on va venir intervenir sur tout ce qui n'est pas encore exploré en termes de formation numérique dans l'administration.
Jihane Herizi : Ce qu'on est en train de faire là, l'agilité finalement, la communication agile. Je sais qu'il y a une formation de chargé de déploiement qui est en train d'être créée, produit. Et puis, il y a une grosse formation de conseiller en stratégie numérique, finalement, qui rejoint ce que tu faisais avant. Et pour s'affranchir du privé, il faut que les gens deviennent aussi des consultants en interne. Il y a une formation là-dessus, il me semble.
Fadila Leturcq : C'est une formation de six mois et typiquement, c'est du jamais vu. On n'aura jamais un organisme privé qui viendra former des consultants internes dans une administration. Autant nous saisir du sujet. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce que quand on a lancé cette formation, on a eu plusieurs clients. On a eu le ministère de la Transition écologique, etc., et qu'on a accompagné pour réfléchir à la création de postes de consultants internes. Ça veut dire que cette formation, elle a engendré la création de postes de consultants internes. C'est le cas au sein du ministère de la Culture, c'est le cas au sein du ministère de la Transition écologique. Désolée pour les acronymes, je dis MTE, mais en fait, c'est le ministère de la Transition écologique. En fait, cette formation a concrètement permis, tu vois, là, si on recherche l'impact, l'impact, finalement, ce ne sera pas le même d'un produit de formation à l'autre. Cette formation a concrètement permis la création de postes en interne pour réinternaliser la compétence en conseil.
Jihane Herizi : Et finalement, réinternalisation et finalement, moins de dépenses envers les cabinets privés. Et finalement, et finalement, en fait, l'impact, c'est une boule de neige. Moi, je suis intervenue dans cette formation et on remercie aussi les autres intervenants. Et je pense notamment à Thomas Houy, dont on mettra le coursera, enfin le, comment on appelle ça, le MOOC et son livre en bas du podcast, qui est excellent et qu'on vous invite, peut-être même que je l'inviterais sur un des épisodes, parce qu'il est juste incroyable. Manager dans l'incertitude, c'est l'avenir, c'est le monde de demain. Justement, on parle d'incertitude. On ne connaît pas les cibles au départ. On ne connaît pas toutes les compétences à développer. On arrive sur le campus, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, on va les atteindre ? Comment, comment vous allez définir un peu les cibles et les compétences ?
Fadila Leturcq : Alors là, tu nous parles, on est le campus du numérique public hébergé à la DINUM. Donc déjà, par nature, on est interministériel. Il faut savoir que dans la fonction publique d'État, les agents publics, on les compte en millions. C'est cinq millions au total, je crois, un peu plus de deux millions pour la fonction publique d'État seule. Et en fait, quand t'es en interministériel, tu te prends en pleine face la diversité de cibles, la diversité d'administration aussi, avec des métiers très différents, la diversité de missions, la diversité de besoins. Donc nous, on a identifié trois grandes cibles qui sont des cibles génériques. Ça va être les agents de la filière numérique, donc ceux qui font le numérique d'aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir leurs compétences à l'état de l'art pour remplir les besoins numériques de l'État. Ça, c'est vraiment notre première cible. Les cadres dirigeants et les cadres supérieurs, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est eux qui sont sponsors de la transformation, parce que c'est eux qui pilotent, dirigent, gèrent les administrations, qui tiennent les bourses aussi des administrations, qui donnent leur GO ou pas, qui incarnent aussi la transformation. Pour nous, c'est important de les aguerrir en matière de numérique. Et aussi tous les agents publics, parce qu'en fait, peut-être que tu inviteras quelqu'un qui travaille là-dessus, mais par exemple, on est en train de déployer une suite numérique dans l'État, des outils collaboratifs à destination des agents publics, le quotidien des agents s'envoie bouleverser. Même là, avec l'IA qui va arriver dans le quotidien des agents, tant en termes de process qu'en termes d'interaction avec les usagers, etc., en fait, tous les agents publics vont voir leur environnement numérique de travail se transformer, donc leur travail se transformer. Et pour ça, il faut les former.
On a ces trois cibles génériques, agent de la filière numérique, cadre dirigeant supérieur et en fait, tout agent public. Mais à chaque fois qu'on crée et qu'on pense à un produit de formation, on affine ses profils, on affine ses cibles, parce que, par exemple, dans la formation conseillers qu'on évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, on a 35 personnes sur un parcours de six mois. Dedans, tu as des gens qui ont fait du numérique avant, donc des agents de la filière numérique qui étaient soit développeurs, qui ont dirigé des programmes numériques ou autres. Mais tu as aussi des gens qui sont issus du métier et que parce qu'ils connaissent bien le métier, ils feront des très bons conseillers en stratégie numérique parce qu'eux, ils savent mettre le numérique au service de la politique publique et de son impact. Et en fait, eux, ce dont ils ont besoin, c'est juste s'aguerrir pour bien comprendre les enjeux du numérique, parce qu'au final, le rôle d'un conseiller, ce n'est pas forcément d'être dedans. Il ne va pas développer le conseiller. Mais c'est d'être dans une posture de conseil, mais qu'il soit au plus près des besoins de l'administration. Donc, en fait, typiquement, conseillers en stratégie numérique, on n'a pas une seule cible, on a plusieurs cibles. Et à partir de ces différentes cibles, on va leur proposer des parcours qui sont adaptés à ce qu'ils viennent rechercher.
Jihane Herizi : Finalement, ça rejoint la question que je te posais sur les compétences. C'est qui a besoin de quoi ? À quel niveau de maîtrise ? Est-ce que c'est plutôt des méthodes ? Est-ce que c'est de l'information, de l'accessibilité, de la data, de l'agilité ? C'est un peu ça, c'est comme ça que vous avez construit vos référentiels et à chaque fois, ça évolue en fonction de la réglementation. Comme tu disais, création de nouveaux postes égale nouvelle formation, évolution du métier de conseiller. Et j'imagine qu'il y aura un niveau 2, un niveau 3 parce que finalement, ils vont avoir encore plus de besoins. Le monde change. Donc là, on a les cibles, on a les compétences. Tu nous as parlé tout à l'heure d'identifier les angles morts et les produits qui n'existaient pas, que tu as créés, que vous avez créés dans l'équipe, qui sont l'agilité, conseillers en stratégie numérique, communication agile, chariot de déploiement. On mettra une petite liste à la fin du podcast avec le site du campus et toutes les formations qui sont en ligne. Mais évidemment, le module IA dont parlait Monsieur le ministre Marcangeli.
Fadila Leturcq : Oui, on a fait une vidéo cet été.
Jihane Herizi : Cet été, qui nous a fait une vidéo et un post sur LinkedIn qu'on vous mettra aussi en bas. On a les DAC qui ont suivi tout un parcours de formation. Ils étaient combien ? Une centaine ?
Fadila Leturcq : Alors, en fait, les DAC, c'est les directeurs d'administration centrale. Ils sont 220 au sein de l'État. Ils sont pilotés, en tout cas, leur carrière est pilotée par la DIESE, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. Et donc, on a commencé pour la formation des cadres dirigeants et supérieurs de l'État par cette cible-là, parce que pour nous, c'est on va dire, c'est tous les dirigeants des grandes politiques publiques et des administrations. Ils étaient 220 et en fait, au lancement du campus, on leur a proposé un programme de formation. Alors, ce programme de formation s'étend sur un an, mais il ne prend pas beaucoup de temps en réalité. En fait, sur un an, on va leur proposer une journée de formation obligatoire à l'INSP, où on fait intervenir des personnalités inspirantes. Tu as cité Thomas Houy, mais aussi on a fait intervenir Gilles Babinet, des CIO de start-up. Voilà, on a eu vraiment des personnes qui sont venues un petit peu les secouer, un petit peu les alerter sur l'importance en tant que dirigeant de s'intéresser au numérique. Ensuite, ils ont une demi-journée de learning expedition, donc d'expédition apprenante pour être française. Donc, on les emmène hors les murs, découvrir le numérique. Donc, on les a emmenés voir des GAFAM, parce que je pense que c'est important quand on parle de souveraineté (Google…) on les a emmenés voir des grandes boîtes françaises de la tech, je pense à Dassault Systèmes, par exemple. On les a emmenés voir des start-up de la French Tech ou des Lauréats de France 2030. On les a emmenés dans des maisons France Service aussi ou chez Emmaüs Connect.
Jihane Herizi : C'est nos GAFAM à nous.
Fadila Leturcq : Exactement, c'est nos GAFAM à nous. Et en fait, pourquoi aussi Emmaüs Connect ou les maisons France Service ? Parce que pour nous, ces entités-là, c'est quand même des vecteurs de l'inclusion numérique. Et c'est important aussi de sensibiliser des dirigeants à qui on dit il faut transformer les administrations, il faut transformer les politiques publiques, au fait qu'il faut le faire bien. Il faut le faire dans l'inclusion des citoyens, des usagers. Et aussi des agents qui composent l'administration. Et donc, c'était important pour nous de les emmener, par exemple, chez Emmaüs Connect. On a des directeurs d'administration centrale qui ont passé trois heures à aider un retraité à se créer une adresse mail. Et en fait, voilà, les faire plonger dans le numérique pleinement. Et après, ils ont une masterclass obligatoire sur un sujet au choix. Et donc, ils ont eu des masterclass sur le cloud, etc. C'est vraiment approfondir des thématiques qui traitent au numérique. Voilà. Et tout ça, ça se déroule sur un an. Et aujourd'hui, on en a formé un peu plus de 200. Donc, quasi tous sont passés par cette formation. Là, maintenant, le gros défi qu'on a, c'est d'entretenir la culture numérique et de continuer à les former sur ce sujet.
Jihane Herizi : Et justement, on a écrit un article récemment qui était sur le site de la DINUM, qu'on mettra aussi en référence. Tu racontes une histoire dedans en lien avec l'armée. Dans l'interview sur une personne de l'armée qui s'est confiée. On vous laissera découvrir l'interview en bas du podcast. Fadila vous raconte un peu plus en détail ses convictions autour de la formation. Mais elle nous raconte aussi ses petites histoires que moi, j'ai trouvé génial. Où finalement, quand ils se retrouvent entre eux, ils parlent, ils ont besoin de parler et ça ouvre sur des champs de ces prochains mois où on va justement parler de performance durable, de résilience, de travail, d'économie du travail, des dirigeants, peut-être même un jour de santé mentale. En tout cas, on va ouvrir sur ces sujets là pour comprendre comment les dirigeants fonctionnent et de quoi ils ont besoin pour être résilients et que notre état soit plus souverain numériquement. Pour pouvoir faire ça et pour pouvoir les attirer, forcément, ils ne seraient pas venus travailler avec n'importe qui. Tu ne peux pas appeler les DACs comme ça et leur dire il y a une formation, il faut venir. Le campus a une marque forte. On a créé une marque forte, t'as créé une marque forte aujourd'hui autour du campus. Forcément, il y a une identité, il y a des valeurs, il y a une baseline. Tout a été créé autour de ça. Oui, c'est qui vous a aidé ?
Fadila Leturcq : Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, comme on s'adresse pour nous, nos premiers clients, entre guillemets, même si c'est gratuit pour l'instant, pour l'instant, pour nous, nos premiers clients, c'est les agents publics. Et pour pouvoir identifier campus, on avait besoin d'avoir une marque forte, d'être bien identifié auprès de ces agents publics. Et donc, au tout début de la création du campus, on a posé nos valeurs. On a posé nos convictions, on a identifié nos cibles, nos contours, etc. Et on s'est fait aider pour ça par l'APIE. L'APIE, c'est l'Agence du Patrimoine Immatériel de l'État. C'est un service de Bercy et c'est des personnes exceptionnelles qui nous accompagnent sur la création de marques. Et donc, ça, ça nous a permis de faire ressortir aujourd'hui tout ce que tu vois autour du campus. Donc, à la fois une baseline, une explication de ce qu'est le campus, une transmission de valeurs. Dans nos valeurs, il y a la souveraineté. Il y a plein d'autres choses aussi. Il y a le savoir, la transmission. Il y a plein de choses. Et notre logo qui est super, parce qu'en plus, il a des belles couleurs pop. Il donne envie, quoi. Ce n'est pas du bleu, blanc, rouge. C'est plus que du bleu, blanc, rouge.
Jihane Herizi : Oui, c'est vrai que j'ai été étonnée. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils ont réussi à faire un truc qui sort un peu du design system de l'État. Même si ça se rapproche, c'est très proche et que vous avez respecté les règles, je trouve que ça donne un peu de peps. Du coup, c'est un peu le côté encore où on reprend un peu de pouvoir. Donc, on remercie l'APIE pour leur travail. Mais encore une fois, c'est encore un travail de start-up d'État. C'est encore on crée le produit. On commence à faire une première solution.
On crée l'équipe et on voit le logo après, les valeurs après, la baseline après. On n'a pas besoin d'un slogan et d'un site Internet, si on va parler du site juste après, d'ailleurs, pour pouvoir fonctionner. Le catalogue, c'est fait sans le site et on n'a pas besoin. Et donc, les gens, généralement, quand ils montent des produits dans l'État, c'est non, mais attends, on va avoir toute la communication. Ça va toucher tout le monde. On va faire une V12 directe. Il faut qu'on ait recruté tout le monde, qu’on ait payé tout le monde et il faut que tout soit prêt. Finalement, regarde, là, on a un petit logo pour le podcast. On monte les épisodes, on est en plein été. On n'a pas encore validé la suite, mais en juste, on lance, on fait. Et c'est ce que vous avez fait avec le campus.
Et là, vous êtes dit, ah, ça fonctionne. On va créer une marque forte autour de ça et on va se mettre sur un site Internet, mais on ne va pas faire de LMS, donc un endroit où on pourrait dire Podia, Systemio, Schoolmaker, tous les produits, en fait, où on se rend pour se former. Finalement, on n'a pas besoin de ça. On va rassembler, on va valoriser, mais on ne va pas créer d'outils. Et là, l'agilité fait qu'on utilise nos propres produits de no code, finalement, puisque le campus a été fait sur...
Fadila Leturcq : Sites Faciles. Sites Faciles qui est un outil qui permet de créer des sites Internet facilement, au sein de l'administration. En fait, c'est clairement ce que tu dis. Nous, on n'a pas voulu créer une boîte tout de suite. On n'a pas voulu créer la boîte et après la remplir. On a d'abord créé, identifié ce qu'on pouvait créer. Et ensuite, on a couvert, on a créé la façade. Voilà. Il fallait que nos bases soient solides quand même. Il fallait que nos fondations soient solides. Donc, tu as raison. En fait, on a cette marque-là. C'est arrivé progressivement. C'est arrivé après parce qu'on était sûr. En fait, je pense que si la marque aujourd'hui est forte, c'est parce qu'on avait déjà fait des choses avant. Et ça, je pense que c'est hyper important. On n'aurait pas pu créer juste une marque et juste une intention marketing sans avoir de contenu, sans avoir sondé les administrations, sans avoir créé cette première cartographie, ce premier catalogue. En fait, parfois, un produit, c'est un fichier et c'est le partagé.
Jihane Herizi : Les gens ont peur de ça. On a peur d'être jugé sur l'extérieur, sur est-ce que c'est beau ? Est-ce qu'il y a un logo ? Est-ce qu'il y a une baseline ? Et souvent, ce n’est même pas que les gens ont peur, c'est qu'on leur demande que le truc soit tellement carré avant que ça sorte. Alors que finalement, quand on regarde tout ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est des trucs qui partent de rien. Aujourd'hui, le cahier de vacances, il est sur Docs. Les documents sont sur Resana. Les vidéos sont sur Tube. On n'a pas un endroit où on a tout mis et ça fonctionne très bien. On a eu plus de 1500 inscrits au cahier de vacances en à peine deux semaines. Donc finalement, et ça fait même du bien parce qu'on fait que ce qui est essentiel et on passe à l'étape d'après à chaque fois. Donc, vous avez créé le site Internet. Donc aujourd'hui, il y a des vidéos, des MOOCs, des classes virtuelles. Là, on fait le podcast. On lance des articles. Il y a des conférences, des serious games, des ateliers. Je sais qu'il y a du présentiel. Il y a du distanciel. Là, on a fait du distanciel avec le cahier de vacances. On fait du présentiel avec le booster Agile, avec la communication Agile parce qu'on veut créer du lien. C'est ce que tu as toujours voulu depuis le début. C'est ce que l'équipe a toujours voulu. Je dis on parce que je vous ai rejoint il y a quelques mois et que on est tellement d'accord sur ce qu'on fait que du coup, pour moi, c'est le on de je suis tellement à fond dans ce qu'on fait qu'on le fait ensemble. Mais les communautés de l'apprentissage, on a des gens sur Tchap aujourd'hui. Ils se parlent entre eux. Les gens se rencontrent, ils se voient, ils prennent des verres. Et vraiment, c'est beau à voir parce qu'aujourd'hui, toi, tu penses qu'on ne peut pas miser que sur le distanciel. On ne peut pas miser que sur synchrone, asynchrone, distanciel, présentiel. Il faut un mix. Le campus pour toi doit être un mix de tout. En fait, c'est la bonne modalité de formation au bon moment.
Fadila Leturcq : Et en fait, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Et quand j'ai créé le campus, tout le monde a pensé que ça allait être une plateforme de formation en ligne. Sauf que moi, je ne suis pas, comme tu disais, un LMS. En tout cas, le campus n'est pas un LMS. Un LMS, c'est le Learning Management System. En gros, c'est un outil de diffusion de MOOCs et de vidéos en ligne. Nous, initialement, le campus, c'était diffuser des compétences, mais ça ne voulait pas dire être une plateforme de formation en ligne parce que, par ailleurs, elle existe déjà en interministérielle. Ça s'appelle Mentor et ils ont déjà fait le taf. Donc, on ne va pas, nous, s'investir. On ne voulait pas réinventer la poudre. Comme je t'ai dit, on voulait se situer dans l'existant et on ne voulait pas réinventer la poudre. Pour nous, la formation en ligne, c'est un vecteur, mais parmi d'autres vecteurs. Et par ailleurs, il y a aussi une attention particulière à porter. Quand on est dans le numérique, on a parfois cette déformation professionnelle de penser que tout doit passer par le numérique. Et moi, je pense qu'en fait, tous les agents et toutes les personnes au monde n'apprennent pas de la même façon. Il y en a qui ont besoin de contacts visuels avec d'autres personnes et d'échanges avec d'autres personnes pour apprendre. Il y en a qui ont besoin d'écouter des récits pour apprendre. Il y en a qui ont besoin de faire pour apprendre. Il y en a qui ont besoin de lire beaucoup pour apprendre. En fait, on n'a pas tous, cognitivement, les mêmes capacités, faire les mêmes capacités, pardon, ce n’est même pas en termes de capacités, mais les mêmes vecteurs d'apprentissage. Et donc, pour moi, c'était hyper important déjà de penser plusieurs modalités de formation lorsqu'on pense formation au campus. Et l'objectif de chaque produit de formation, c'est d'avoir la bonne modalité pour la bonne compétence, pour le bon agent public.
Jihane Herizi : Avec aussi le bon formateur ou la bonne formatrice sur la bonne expertise pour le bon apprenant. En gros, qui est-ce qu'on choisit ? Quand est-ce qu'on choisit de se faire former ? Ça, tu l’as fait aussi parce que t'as désiloté, tu travailles avec des partenaires. Aujourd'hui, le campus ne te dit pas je travaille tout seul. Il y a Québec, l'UNESCO, il y a plein de partenaires, il y a l'INRIA…
Fadila Leturcq : Oui, ça, c'est hyper important parce qu'en arrivant dans le paysage interministériel, le campus n'était pas seul. Tu as des ministères qui avaient déjà des académies de formation au numérique. Tu as des ministères qui avaient déjà des organismes de formation en propre. Par exemple, au ministère des Armées, ils avaient l'académie du numérique de défense. A Bercy, ils avaient déjà l'IGPD. Donc, en fait, ce paysage-là existait. Nous, notre objectif, c'était de se dire on arrive sur le segment du numérique. Comment on fait front commun avec eux pour accélérer la formation au numérique et l'acquisition de compétences numériques par les agents publics ? L'idée, c'était vraiment de les rassembler. Donc ça aussi, l'aspect communauté, il est important. Quand je te disais tout à l'heure, on a essayé de se situer dans l'existant, se situer dans l'existent c’est aussi identifier nos pairs, nos alliés, les partenaires pour mutualiser et faire front commun et créer des communs numériques, des communs de formation. J'aime bien dire les communs de formation, vu que c'est l'avenir, les communs. Mais voilà, c'est l'avenir, les communs. Et donc, l'une des choses qu'on a fait assez vite après la création du campus, ça a été de créer un forum dédié à tous ces partenaires-là, tous ces référents formation en interministériel. Parce que c'est eux qui viennent nous dire ce dont les agents ont besoin. Nous, dans notre tour d'argent interministérielle, c'est un peu pour caricaturer, mais dans notre tour d'argent interministérielle, on n'est pas au plus près des besoins du greffier ou du policier ou du gendarme ou du militaire ou du civil de la défense. En fait, c'est ces acteurs-là qui viennent nous dire ce dont ils ont besoin.
À partir de ça, on identifie ce qu'ils peuvent faire commun entre les ministères et on appuie tous les projets de création de produits, voire d'expérimentation de produits de formation par cela. Et donc, on a toute cette communauté qu'on anime, on les rassemble une fois par trimestre désormais autour du forum et on mène aussi des actions de formation très concrètes avec eux. On produit des produits de formation avec eux, des parcours de formation. Et à côté, on a aussi des partenariats internationaux. Tu as cité le Québec, tu as cité l'UNESCO. Alors pourquoi des partenariats internationaux ? C'est hyper intéressant. Naturellement, on ne penserait pas qu'un campus du numérique dédié aux agents publics ait à faire des partenariats internationaux. Néanmoins, pour nous, c'est très intéressant parce qu'en fait, déjà dans l'espace francophone, et c'est pour ça qu'on a eu un partenariat pendant deux ans avec le Québec, les besoins de formation des agents publics sont les mêmes. Et en plus, on a l'avantage de créer des formations en français. Et donc, le deal qu'on a fait avec l'Académie de la transformation numérique du gouvernement québécois, qui est émergée à l'université Laval, ça a été de se dire, bon, nous, on a des experts sur des sujets que vous, vous n'avez pas. Pourtant, ils portent des sujets de formation dont vous avez besoin. Je prends l'exemple du numérique écoresponsable ou de l'agilité. Eux, ils ont beaucoup de contenu online et nous, on a envie d'en faire. Mais en fait, pourquoi en faire si vous vous en avez en français ? Et donc là, l'idée, ça a été d'avoir un échange de mots procédé. Et donc, nous, on leur a permis d'interviewer des experts français sur des questions assez pointues et nouvelles au sein du gouvernement québécois et de créer des MOOC. Et inversement, nous, on a été faire notre liste de courses dans leur catalogue de formation. Et pareil pour l'UNESCO. L'UNESCO, eux, ils ont toute une alliance de gouvernements du monde entier. Et ils ont un service qui est dédié à la transformation numérique des gouvernements et qui a un angle autour de la formation. Mais donc là, à titre d'exemple, l'UNESCO, ils sont en train de monter un MOOC sur l'intelligence artificielle avec l'université d'Oxford. Ils demandent à plusieurs pays de contribuer pour faire remonter des cas d'usage, des exemples de transfo, etc. Et ce MOOC va être traduit dans toutes les langues. Donc nous, ça nous intéresse plutôt que de refaire notre MOOC. Et s’il faut rajouter des briques à ce MOOC pour avoir du contexte franco-français, on le fera, mais voilà.
Jihane Herizi : L'idée, c'est de faire récupérer l'existence, finalement, travailler avec les autres en réseau et ne pas refaire l'eau en poudre.
Fadila Leturcq : Exactement. Mutualiser, mutualiser, mutualiser.
Jihane Herizi : Je vous laisse imaginer ce que c'est que l'eau en poudre. C'est vrai. Donc, de manière générale, ce que tu dis pour le résumer, c'est qu'il faut travailler avec des experts, mais il faut les aider. A la DINUM par exemple, aujourd'hui, il y a plein d'experts qui peuvent former, mais ils ne sont pas formés à la pédagogie. Et du coup, c'est toujours de la logique, du code. Ce ne sont pas des gens qui ont appris à mobiliser l'attention. Et donc, de manière générale, dans le réseau, c'est ceux qui savent déjà faire l'existant. On rajoute des briques, on travaille avec eux. Et de l'autre côté, ceux qui savent déjà faire, mais qui ont du mal à transmettre, on les aide à transmettre. On pourrait résumer ça comme ça, finalement.
Fadila Leturcq : Oui, tu as touché un point très important, parce que qui forme au campus ? En gros, la vraie question, c'est qui forme au campus ?
Jihane Herizi : Parce qu'on cherche des gens pour former au campus. Donc, c'est bien de faire appel aujourd'hui aux compétences.
Fadila Leturcq : Ça, ça fait partie des problèmes qu'on avait à investiguer. En gros, on se rendait compte que dans les problèmes qu'on avait à identifier, c'est qu'aujourd'hui, pour se former, il faut passer par des marchés interministériels parce que les règles du recours aux prestations extérieures sont telles qu'elles sont au sein de la fonction publique. Et on a recours à des organismes de formation qui, parfois, proposent des formations sur catalogue qui sont totalement hors sol des besoins des agents publics. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'on avait identifiés. Donc, nous, on a toujours ce véhicule parce que c'est hyper important. Ces organismes de formation là, par exemple, ils sont toujours alertes au regard de l'arrivée de nouvelles technologies, etc. Donc, ils peuvent nous apporter de la formation. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas se contenter que de ça. Et donc, il y a deux choses qu'on a souhaité activer au campus. C'est le recours à des formateurs indépendants, parce que, comme je te disais, le numérique, ça va très vite. Et en fait, parfois, il vaut mieux aller chercher un formateur indépendant qui ait la bonne compétence et qui connaisse la fonction publique et les besoins d'un segment de la fonction publique pour délivrer cette compétence. Et surtout, on a développé un réseau de formateurs internes occasionnels parce qu'il y a plein de choses qui motivent ça. Il y a le fait que dans le numérique, on a des super experts. On a des experts qu'on aimerait mettre en visibilité. Ça participe de l'attractivité. Ça participe de la marque employeur. Ça participe de leur rétention. Ça participe de reconnaître leurs compétences aussi. Pour moi, c'est une forme de, ce qu'on dit dans le privé, c'est des rewards. Mais pour moi, c'est une forme de reconnaissance, en fait, que de les nommer formateurs internes occasionels. Et par ailleurs, la fonction publique est bien faite parce que ce statut là est rémunéré. Et donc, c'est aussi un incentive que d'être formateur interne occasionnel. Après, tu ne peux pas faire ça toute ta life. Tu ne peux pas non plus passer 75% de son temps à former. Néanmoins, tu as une forme d'incentive à partager ta compétence et à la délivrer. Et donc, on s'est dit là où on est en tension à la fois budgétaire, à la fois en termes d'effectifs, etc. En fait, on a une mine d'or devant les yeux de gens compétents. Utilisons-les aussi pour transmettre des compétences.
Jihane Herizi : Donc aujourd'hui, on est toujours à la recherche de personnes compétentes. Donc, on mettra également dans les notes du podcast le lien de formateur interne occasionnel. Si vous sentez que vous êtes expert de votre sujet, que vous avez envie d'être pédagogue, de transmettre, de donner envie, de venir avec nous pour former les gens sur un certain sujet, on vous met les notes en bas du podcast. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on travaille ensemble, tout simplement. Je vais te donner un défi, je vais te poser deux questions. J'aimerais avoir ton rapport d'étonnement après un an et demi de campus en cinq points. Et j'aimerais que tu me racontes ton propre rapport à la formation en trois points. On commence par le rapport d'étonnement.
Fadila Leturcq : Écoute, gros défi, mon rapport d'étonnement après un an et demi de campus, donc tu as dit cinq points. En fait, je pense que le premier constat que je fais après un an et demi d'existence du campus, c'est que les administrations, elles n'attendaient que ça. Elles n'attendaient que ça et elles continuaient à avoir des très, très fortes attentes.
Jihane Herizi : On a beaucoup de demandes en réalité.
Fadila Leturcq : On a beaucoup de demandes et on le voit, on a des listes d'attente à rallonge. Sur certaines formations, on a des centaines d'agents publics qui sont sur les lits d'attente. Sur d'autres, on a des milliers d'inscrits.
Jihane Herizi : Sur le webinaire NoCode, on a fait plus de 3000 inscrits. Je crois qu'à midi, en sein de webinaire, il y avait encore 1500 personnes qui étaient connectées. Et sur l'agilité, là, sur le booster numéro 1, on avait, je crois, plus de 200 personnes qui s'étaient inscrites pour 80 places. Et on a re-eu encore 200 personnes alors qu'il y avait déjà une liste d'attente de plus de 120 personnes. Et donc, on doit faire des choix. Ce n'est pas des chiffres bidons qu'on donne. Il y a vraiment des milliers sur les webinaires et des centaines de personnes en liste d'attente.
Fadila Leturcq : En fait, c'est un peu ça. Et mon rapport d'étonnement, c'est qu'on sent qu'on est utile. On sent que ce qu'on fait est positif parce que ça attire les agents publics. On sent qu'il y a un besoin et qu'ils ont envie de se former. En plus, c'est très positif. Ça nous donne encore plus envie d'agir parce qu'on sent que l'élan de formation, il est là. On sent que les administrations sont heureuses qu'on existe. Le truc, c'est que c'est aussi vertigineux parce qu'on ne peut pas encore répondre à tous les besoins. Donc ça, c'est un petit peu le premier point de rapport d'étonnement. Ce qu'on fait est utile, mais ça fait peur parce qu’il y a de fortes attentes en face, exactement.
Jihane Herizi : J'imagine qu'à un moment donné, il va falloir mettre en place un modèle économique pour pouvoir faire tenir campus et rémunérer des formateurs. Et on va devoir y arriver.
Fadila Leturcq : Exactement. Ce n'est pas encore une urgence, mais c'est un point de réflexion. Deuxième chose, en interministériel, on se rend compte que c'est un peu illusoire de vouloir tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire parce qu'on n'a pas tous les moyens du monde. Et ça, on vient de l’évoquer. Le passage à l'échelle, il est difficile. Comme je te disais en début de podcast, on parle de millions d'agents issus de différentes administrations. Alors effectivement, la formation online, ça permet d'avoir plein d'agents qui se forment. On peut avoir plus de 5 000 agents qui vont se former en une semaine sur un module. Et ça, c'est génial. Mais comme je disais, ce n'est pas parce qu'on se forme online qu'on a acquis la compétence. Et tout le monde n'apprend pas de la même façon. Il y a cet enjeu du passage à l'échelle. Et par ailleurs, le spectre des métiers et de l'administration, il est beaucoup trop large pour qu'on puisse former à la maille des missions et des expertises. Et donc, il y a plein de métiers aussi qu'on ne connaît pas. Le campus est hébergé à la DINUM. Mais moi, à la DINUM, je ne connais pas un directeur d'établissement culturel. Je ne connais pas les contours de son métier au quotidien. Je ne vais pas connaître les contours du métier d'un gendarme. Je ne vais pas connaître les contours du métier d'un directeur de greffe, d'un diplomate. Donc en fait, on a ce besoin de travailler étroitement avec les ministères et de faire du sur mesure. On a, comme je te disais tout à l'heure, des partenaires et des référents interministériels. Heureusement qu'ils sont là parce qu'ils nous permettent de mieux connaître les populations. Et en fait, c'est à la fois des bons relais et même eux-mêmes, nous apportent énormément pour nourrir nos catalogues de formation. On a des acteurs de la formation continue dans certains ministères aussi qui agissent au plus près de ces agents. Je te parlais de l'IGPDE, mais je ne t'ai pas parlé de l'École nationale de la magistrature. Par exemple, avec l'École nationale de la magistrature, l'année de la création du campus, on a créé un cycle approfondi au numérique. C'est un cycle dédié aux cadres dirigeants supérieurs, en tout cas les greffiers, les directeurs de greffe, les magistrats du ministère. Et donc, c'est un cycle de neuf mois autour du numérique. Et pourquoi on l'a fait avec l'ENM ? En tout cas, c'est l'ENM qui a pris l'initiative de le faire. Mais pourquoi ils l'ont fait avec nous ? Parce qu'eux, ils connaissent bien le métier, mais nous, on connaît bien le numérique. Et donc là, l'idée, c'est de créer des alliances avec des organismes de formation. Et après, comme je te disais, comme on ne peut pas tout faire, je pense que l'un de nos gros défis pour le passage à l'échelle, c'est de former des formateurs internes occasionnels. En fait, faire de la formation de formateurs qui pourront être peut-être le relais de nos formations en interne ministérielle. Et c'est très drôle aussi, il y a des ministères qui commencent à avoir des idées. Ils veulent créer des spin-offs du campus du numérique public dans leur administration. C'est le cas du ministère de la Justice. Je ne sais pas si tu as lu le dernier rapport sur l'IA en justice qui a été remis au garde des Sceaux il y a quelques semaines. Et donc, dans les propositions, il était proposé de créer une spin-off du campus du numérique public, donc un campus du numérique justice. Alors moi, je serais ravie d'accompagner le ministre de la Justice dans la création d'une filiale.
Jihane Herizi : Donc les administrations n'attendent que ça. C'est ambitieux, on ne peut pas tout faire. Le troisième point de rapport d'étonnement, ça serait quoi ?
Fadila Leturcq : Alors, la formation, ce n'est pas quelque chose de neutre. Alors ça, c'est un sujet très... C'est un étonnement qui est assez touchy. Et en fait, là, je me nourris aussi de mon expérience dans le privé pour m'étonner de ça. En fait, moi j'ai une vision, c'est dans l'administration qu'il y a accès à la formation, accès au pouvoir. C'est le cas dans plein d'administrations privées aussi, mais dans l'administration, c'est quand même assez marqué. En fait, normalement, la formation, ce n'est pas qu'un outil d'apprentissage, c'est aussi un dispositif de gestion de carrière. Mais dans certains cas, ça peut devenir un dispositif de contrôle, parce qu'on a une hiérarchie qui peut décider de qui y accède et qui n'y accède pas. On a déjà eu le cas. On a eu des personnes qui voulaient faire une formation et qui ont été empêchées par leur hiérarchie. Et moi, je constate encore que, même si nos formations sont gratuites pour l'instant, comme je disais, il y a encore du management, des responsables hiérarchiques des administrations qui limitent l'accès à la formation de certains de leurs agents. En général, les arguments qu'on nous a pensés, ça ne correspond pas au poste. Il faut un projet avant de se former. Ce n'est pas un agent que je fais prioriser. L'agent n'a pas le temps de consacrer C'est horrible d'entendre ça. Moi, je remarque que ça concerne surtout les femmes.
Jihane Herizi : C'est vrai. Aussi.
Fadila Leturcq : Aujourd'hui, je trouve que la formation de la fonction publique, elle est un peu trop normée. Et l'idée même de devoir demander à son supérieur hiérarchique l'autorisation pour se former, pour moi, elle est aujourd'hui dépassée. Je te dis ça parce que je te faisais le parallèle tout à l'heure avec mon expérience dans le privé. Quand j'étais dans le conseil dans le privé, nous, on avait une plateforme de formation. Déjà, on avait des formations obligatoires pour maintenir à l'état de l'art nos compétences.
Jihane Herizi : À Accenture, on avait ça aussi. Dans le conseil, c'est comme ça.
Fadila Leturcq : Exactement. Tu as un socle de compétences. En fait, il faut qu'ils soient maintenus pour aussi ces gages de qualité du service qu'on rend. Et après, on avait un accès à la formation, mais qui était complètement illimité. Parce que la diversité de sujets qu'on abordait, et c'est le cas aussi dans la fonction publique. Dans la fonction publique, un fonctionnaire peut passer d'un ministère à l'autre, d'un métier à l'autre. Donc, la diversité de sujets qu'on abordait faisait qu'on avait besoin d'avoir une culture générale très large sur plein de sujets quand on faisait de la transfo. Et donc, moi, j'aimerais que demain, l'administration, ça devienne une organisation apprenante. Voire même, j'aimerais militer pour qu'on ait des jours obligatoires de formation aux compétences numériques, tant c'est important aujourd'hui dans l'exercice du métier de l'administration. Et donc, voilà. Ça, c'est un des points du rapport d'étonnement que j'ai. La liberté de se former.
Quatrième point. Quatrième point. Quand est-ce qu'on s'intègrera à la formation initiale ?
Jihane Herizi : On essaye un petit peu, mais c'est encore compliqué. C'est laborieux. Oui. Forcément, Sciences Po, tu y fais quelques points. Mais c'est à ton nom.
Fadila Leturcq : C'est à mon nom. Et en fait, dans les écoles du service public, aujourd'hui, nous, le mandat du campus, c'est de faire de la formation continue au service du stock de fonctionnaires et d'agents publics existants.
On ne nous a pas demandé de former le flux. Donc, toutes ces écoles du service public, je pense, par exemple, aux écoles, je ne sais pas, l'école nationale de gendarmerie, l'école nationale de police, l’INSP, les IRA, etc. Ce sont des écoles qui vont former les futurs fonctionnaires et aux fonctionnaires de demain. À mon sens, c'est très important qu'on puisse travailler avec eux pour qu'ils aient un socle de base en compétences numériques et que ce socle-là puisse être enseigné dans les modules de formation dans ces écoles. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut aller plus loin et travailler sur l'évolution des métiers et la façon dont l'IA et le numérique vont venir impacter ces métiers pour sans cesse rien déroger les parcours de formation, les modules qui sont délivrés. Parce qu'en fait, on ne peut pas former un magistrat ou un greffier ou un policier ou un gendarme en 2020, comme on le ferait demain en 2026. Parce que les métiers vont évoluer. Le numérique va impacter profondément ces métiers, donc c'est hyper important de pouvoir être dans une approche itérative au regard des programmes de formation.
Jihane Herizi : Tu parles beaucoup des métiers de sécurité parce que tu es réserviste et tu fais partie un peu de ces domaines-là. On entend tout à l'heure greffier, policier, gendarme, c'est parce que tu vois au jour le jour ces personnes autour de toi dans les autres fonctions.
Fadila Leturcq : C'est mon côté régalien. Et peut-être pour terminer sur le rapport d'étonnement, comme on a évoqué la question de l'argent, la question de l'investissement dans la formation. Pour moi, la formation, ça reste encore trop vu comme un coût à maîtriser plutôt que comme un investissement. On parle beaucoup de transformation, de réinternalisation des compétences numériques, d'agilité, de culture du changement. Mais en fait, il faut arrêter de voir la formation comme une dépense, mais vraiment comme un investissement structurant parce que c'est ça qui va nous permettre de remplir ces impératifs et ces objectifs de réinternalisation des compétences et d'aboutir à notre souveraineté. Comme je te disais, mon expérience dans le Conseil m'a vraiment forgée là-dessus. Je vois la valeur de la formation. Ce n'est jamais perdu de former un agent.
Jihane Herizi : Surtout que c'est gratuit. Alors qu'en fait, les gens payent à l'extérieur des milliers d'euros. On a estimé le booster agile à au moins 1500 euros. Et ce sont des frais qui sont offerts. En plus, il y a le cocktail, il y a le café. Alors certes, on ne paye pas les logements et les déplacements parce qu'on est sur quelque chose d'assez lean. Mais si demain, on avait un modèle économique, on pourrait prendre en charge. Mais en réalité, ça ne coûte presque rien. Si ce n'est que on a eu le cas avec une des formations avec deux personnes de l'armée qui ne se parlaient plus, qui avaient du mal à travailler ensemble. Une journée de formation, ils se sont reparlés. Ça veut dire un produit qui fonctionne mieux. Donc finalement, c'est un jour de formation pour peut-être un an de gagné sur un produit. C'est un investissement qui en plus n'est pas extrêmement coûteux pour l'instant. Si on rappelle les cinq points, moi j'ai noté les administrations n'attendaient que ça et elles continuent d'avoir de fortes attentes. En interministériel, c'est ambitieux et illusoire de penser pouvoir tout faire. La formation n'est pas neutre et qui a accès à la formation a accès au pouvoir. J'ai presque envie de la mettre en titre de podcast. Quand s'attaquera-t-on à la formation initiale, tu m'as dit, et la formation reste trop souvent perçue comme un coup à maîtriser plutôt qu'un investissement. Ce sont tes cinq points de rapport d'étonnement après deux ans de campus maintenant. Pour terminer, moi j'aimerais qu'on revienne à toi, à ton agilité autour de la formation et puis on fera probablement un autre épisode sur la suite du podcast pour parler un peu de ton parcours et de toi, ta vision de l'agilité et en quoi tu es agile.On a beaucoup parlé du campus et c'est très important pour que les gens comprennent d'où ça vient, d'où c'est né tout ça. C'est un vrai travail, c'est un gros travail. Je veux dire, ce n’est pas un logo, une baseline et un site internet et trois pèlerins qui sont derrière un bureau en train de s'amuser. Moi je le vois au jour le jour. C'est une vraie équipe et c'est comment on se bat, comment on travaille tous les jours. C'est parfois des journées où tu finis très tard, où les gens sont hyper actifs dans l'équipe pour répondre, où on essaye toujours de se dire, ok, il y a un besoin, comment on y répond rapidement et c'est déjà interministériel, c'est des besoins tellement vastes, des profils tellement vastes. Là j'aimerais qu'on parle de toi et de ton rapport à la formation. Je t'ai donné un défi en trois points. Ça donnerait quoi ton rapport à la formation ?
Fadila Leturcq : Premier point, mon rapport à la formation, je pense que c'est apprendre à apprendre. Toutes les études nous montrent que de toute façon, on ne fera pas le même métier toute notre vie. Il me semble que c'est entre trois et sept fois qu'on va changer de métier au cours de sa vie professionnelle. Moi, j'ai déjà un peu plus de dix ans d'expérience et j'ai dû déjà changer deux ou trois fois de métier. J'ai été consultante, j'ai été dirigeante dans un think tank dédié au DRH.
Jihane Herizi : Tu as été RH, chef du campus. Finalement, tes compétences sont les mêmes. C'est des noms de métiers, mais tes compétences sont les mêmes.
Fadila Leturcq : Exactement. Les compétences, j'ai pu naviguer dans certaines compétences. Pour moi, naviguer, c'est apprendre à apprendre. C'est apprendre à s'adapter en permanence. C'est apprendre à développer une certaine curiosité. Moi, mon rapport à la formation, ça a été souvent quand je voulais aborder un nouveau sujet ou un nouveau métier, d'aller apprendre toute seule, de lire beaucoup, parce que j'aime bien lire et que c'est comme ça que je me nourris, d'aller rencontrer des personnes qui font ce métier, de faire des formations courtes ou longues, des projets associatifs aussi. Moi, ça m'a beaucoup formée. D'aller demander à des potes qui travaillent dans certains secteurs d'activité, qui m'intéressent, de passer une journée avec eux : un « vis ma vie », un « vis mon job ».
Pour moi, il faut se mettre en condition où on va chercher le savoir, parce que de toute façon, il ne nous sera pas servi sur un plateau ou quand il nous est servi sur un plateau, il est fait souvent au sein d'organisations qui ont envie que tu acquières une compétence, certes, au service du métier, de la mission de l'organisation, mais est-ce que c'est à ton service ?
Jihane Herizi : C'est intéressé.
Fadila Leturcq : Deuxième rapport à la formation, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Apprendre à apprendre. Pour moi, il faut être agile dans sa carrière. Être agile dans sa carrière, mais ça, vous le verrez tout au long du podcast, je pense. C'est se former, bien sûr, et ne pas attendre d'avoir l'autorisation pour le faire. C'est sortir du cadre, oser, créer des ponts. Moi, j'ai beaucoup multiplié les expériences extra-professionnelles, parce que je trouve que ça a été un accélérateur dans ma carrière, dans mon apprentissage. Ça m'a beaucoup nourrie. Ça a nourri mon assertivité. Ça a nourri, je pense, une petite partie de leadership. En fait, j'ai gagné en assurance en allant me former à l'extérieur des organisations dans lesquelles j'étais. Et je pense que c'est hyper important d'apprendre à sortir du cadre. Et je trouve ça dangereux, en fait, comme on voit beaucoup dans des gros groupes, ou dans des big fours dans lesquelles j'ai travaillé, ou un peu partout dans toutes les organisations, de confier son destin professionnel à un service RH. Je pense que nos aspirations changent tout au long d'une carrière, nos envies aussi. Il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir se prendre à main. Il faut être proactif dans sa carrière, au point d'aller suggérer des choses à ces services RH, plutôt que d'attendre que nos services RH viennent nous suggérer des choses. C'est pour ça que je pense qu'il faut décomplexer les gens vis-à-vis de la formation. En tout cas, moi, je suis vraiment décomplexée par rapport à ça, et je pense que c'est important d'aller chercher de savoir où il est, et d'être proactif dans sa carrière.
Jihane Herizi : Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas une formation « apprendre à être son meilleur gestionnaire de carrière » ? On a fait la communication Agile, « être son communiquant, son chargé de déploiement H24 », est-ce qu'on ne ferait pas un produit, devenir son gestionnaire de carrière ? On a fait des RH toutes les deux.
Fadila Leturcq : On y va.
Jihane Herizi : On vient de le lancer en direct. Vraiment, ce n'était vraiment pas prévu, donc on vous tient au courant dès qu'on a une date.
Fadila Leturcq : Voilà, donc on y va. Et peut-être aussi un truc qui est relié à ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas avoir honte de déclarer les compétences qu'on a, qui ne correspondent pas au poste. Ça, c'est hyper important, et moi, pendant longtemps, j'ai siloté mes mondes. Pour tout te dire, pendant longtemps, j'ai siloté mes mondes. Il y a des choses que je faisais dans le cadre extra-professionnel, et je ne voulais pas que ça se sache dans le cadre pro, parce que j'étais dans des cadres très normés, et en fait, il ne fallait pas sortir du cadre, mais en fait, je pense que non, au contraire, c'est une richesse, parce que c'est à la fois accélérateur de carrière, mais aussi, tu peux être identifié comme une personne qui peut aider sur des sujets nouveaux, parce que tu peux apporter une brique de compétences nouvelle dans une organisation. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Pourquoi tu souris ?
Jihane Herizi : Parce que tu connais mon postulat, qu'il n'y a pas des limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et qu'en fait, les gens se font du mal à essayer d'esquiver, en se disant, oui, mais non, oui, mais c'est là, c'est pas comme ça, mais en fait, c'est ça qui fatigue. Alors que si tu es dans le flot, et que tu passes de l'un à l'autre comme ça, et que tu es la même personne, et bien en fait, on te découvre des choses, et qu'en fait, on vient te chercher, et la preuve de ce podcast, on vient te chercher sur ce truc en disant, attends, tu fais ce truc-là ? Attends, mais je ne savais pas, mais nous, on a besoin. Mais déjà, il faut voir quelqu'un qui sait faire un truc pour des fois penser aux besoins qu'on a. Donc, s'il vous plaît, décomplexez-vous. C'est le hashtag du jour, et montrez ce que vous savez faire, même si ce n'est pas en lien avec votre poste, parce que finalement, c'est ça qui fait qu'on monte en escalier. C'est en faisant d'autres choses, où on t'a dit, attends, tu sais faire ce truc, mais on pourrait l'utiliser d'ailleurs, tu vois ? Mais si tu ne le dis pas comme on sait ? Être à l’aide avec soi-même, être en conscience avec soi-même, et rendez-vous à l'épisode 4, j'en parlerai un peu plus.
Fadila Leturcq : Dernier point, et ça, je te l'avais dit, il me semble, dans la formation, dans l'interview qu'on avait faite, c'est que moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est, il faut penser contre soi-même, et je t'avais dit, moi, je crois qu'il faut se former contre soi-même. En fait, aller, soyez curieux, aller là où on ne connaît rien, aller là où on ne nous attend pas, parce que, de toute façon, c'est de l'apprentissage qui est fait. Je pense qu'il faut raviver la curiosité au travail. Dans le numérique, je le vois beaucoup. En fait, c'est important, pour les numériques, d'aller voir les métiers, et pour les métiers, d'aller voir les numériques, pour se comprendre, parce que souvent, c'est des mondes qui ne se comprennent pas, c'est des mondes qui, parfois, n'arrivent pas à définir les frontières aussi qu'il y a entre eux, les forces de chacun et les forces de l'autre. Et donc, pour moi, c'est hyper important d'aller dans des domaines inconnus, d'aller apprendre de l'autre, etc., parce que c'est comme ça qu'on arrivera mieux à collaborer.
Jihane Herizi : Je me demande si on ne va pas créer un autre truc, du coup « Vis mon job du numérique », dans le Campus. Si vous êtes partant, je vais créer un questionnaire, en dessous de l'épisode, je viens de l'annoncer, encore une fois, ce n’était pas prévu. Si vous avez envie que d'autres personnes, dans d'autres ministères, viennent voir ce que vous faites, et que vous avez envie, vous, de venir voir ce qu'il se passe dans d'autres ministères, on va vous faire matcher, et ça sera vis mon job en interministériel, dans le numérique, on l'a pas encore appelé, puisqu'on vient d'en discuter. Ça me fait penser à un truc, ça me fait sourire, j'ai une amie qui s'appelle Mathilde, qui un jour est entrée dans une salle de sport, et qui s'est trompée de cours, et qui est entrée dans un cours de MMA, alors qu'elle n'avait jamais fait de MMA, elle est devenue championne de MMA de France à plusieurs reprises, elle n'aurait jamais pu le savoir, sans rester dans le cours, c'est-à-dire qu'elle est rentrée, elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée de cours, elle est restée, et en fait, elle s'est découverte des capacités de MMA, et elle est championne de MMA de France, vous pouvez taper dans Google Mathilde, je vous donnerai son nom de famille, et en fait, elle raconte son histoire à la caméra, et en fait, je me dis, c'est la même chose, bon, on va pas devenir championne de MMA en interministériel, mais c'est la même chose, c'est-à-dire, rentrer dans des endroits qu'on ne connaît pas, y rester, penser contre soi, se dire attends, je vais aller voir quand même, je vais voir si ça me plaît ou pas, il va rien vous arriver, il va rien se passer, la seule chose qu'on fera au pire, c'est d'avoir appris un truc, dont on s'en moque, et ça ira au combat, à quelqu'un d'autre finalement, ou on pourra dire à quelqu'un d'autre tiens, tu voulais faire ce truc, moi je l'ai fait, j'ai pas aimé, mais c'est pour toi. Fadila, c'était un long épisode, de 1h20 et quelques, mais c'était essentiel pour ouvrir cette saison qui va être très riche, je le sens, avant de parler avec Mélodie dans l'épisode 2, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé, quelque chose que tu souhaiterais ajouter, que tu souhaiterais dire, un conseil, une parole, quelque chose avec lequel tu souhaiterais laisser les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ?
Fadila Leturcq : Venez visiter le site du campus. Venez visiter le site du Campus, évidemment vous aurez le lien.
Jihane Herizi : Le campus du numérique de la DINUM. On leur dit merci pour être restés jusque-là, vous êtes des warriors si vous êtes restés jusque-là, et surtout si vous êtes restés jusque là, c'est que vous avez envie d'écouter la suite, c'est que vous avez envie d'en apprendre plus sur l'agilité, et on a plein de formations qui arrivent, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée, merci Fadila pour tous ces éléments hyper intéressants, et j'adore travailler avec toi.
Fadila Leturcq : Merci, moi aussi. Salut !
Jihane Herizi : Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode du Coup de Boost Agile.
Dans le premier épisode, j’étais avec Fadila Leturcq, que vous avez entendu sur le Campus du numérique public de la DINUM, et le pourquoi du Booster Agile et du podcast Coup de Boost Agile. Et aujourd’hui, j’ai le plaisir d’accueillir Mélodie Dahi, qui est une de mes collègues à la Direction interministérielle du numérique.
Alors pourquoi Mélodie ? Mélodie c’est un pur produit de l’administration publique, c’est une des personnes les plus agiles que je connaisse autour de moi.
Petit disclaimer : on n’est pas du tout au bureau, on est en plein mois d’août. On est comme deux copines qui sont en train de boire un café et de discuter d’agilité. Donc vous allez probablement nous entendre rigoler, s’il y a un téléphone qui sonne, un chien qui aboie, quelqu’un qui frappe à la porte… vous allez l’entendre. Il n’y aura ni montage, ni musique, tout est brut. On est en mode frugalité extrême, agilité, Lean Startup. Ce qu’on vous apprend, on le fait aussi.
Et merci Mélodie aujourd’hui de m’accorder ton temps en plein mois d’août. On n’est pas en vacances, on travaille, mais plein de gens sont en vacances. Je suis ravie d’être là au fin fond de la région parisienne, devant un super jardin, avec deux petits micros et un petit ordinateur. On a monté ce podcast parce qu’on avait envie de partager plein de choses au monde de l’administration. Alors je viens d’expliquer pourquoi j’ai souhaité faire ce deuxième épisode avec toi. J’ai envie que tu racontes à tout le monde ton parcours, ta définition de l’agilité, comment tu as fait pour être aussi agile. Voilà ce qu’on raconte dans le Booster Agile : que ça soit enregistré, partagé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Mélodie, d’où tu viens dans l’administration ?
Mélodie Dahi : Merci pour l’invitation déjà. Merci d’être venue jusqu’à moi aussi pour enregistrer.
Jihane Herizi : Avec plaisir.
Mélodie Dahi : Tu vas m’aider à raconter tout ça. Alors, pourquoi, comment ? Alors oui, je te raconte. Donc moi j’ai commencé effectivement ma carrière dans l’administration. C’est vraiment une vocation depuis toujours. J’ai toujours su que je travaillerais dans le service public. Je m’en suis très très peu écartée dans ma carrière, parce que je sais aujourd’hui que j’y finirai ma carrière. Et donc j’ai commencé moi à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, à moitié par hasard en fait, parce que la moitié qui n’est pas par hasard, c’est que j’ai fait des études spécifiques sur la protection sociale. Donc c’était quand même là où j’étais destinée. Mais par hasard parce que c’était sur un poste qui ne m’intéressait pas tant que ça.
Et maintenant que j’y pense, c’est un peu un début d’agilité. Je me suis dit : tu sais quoi, première étape, j’ai envie d’entrer dans cette institution-là. Peu importe le poste, en fait, je m’y plairai. Je vais m’y plaire quoi qu’il arrive. Je suis allée sur un poste qui, sur le papier, ne me plaisait pas tant que ça. J’ai fait des super rencontres. Ça a été vraiment un début de carrière top.
Jihane Herizi : Mais comment ça se fait que tu dis… Personne va te dire, je vais à la Caisse nationale de vieillesse. T’as quel âge ?
Mélodie Dahi : J’avais 23 ans. J’étais vraiment en sortie d’études.
Jihane Herizi : D’où, déjà ? De quelle école ?
Mélodie Dahi : Sciences Po. J’ai fait Sciences Po Paris. J’ai fait le master affaires publiques en spécialisation santé et protection sociale. Donc je savais vraiment que je voulais rentrer. Je m’étais dit : j’aimerais bien commencer par une caisse nationale. Et la vieillesse, c’est l’avenir. C’était l’avenir déjà à ce moment-là, mais ça l’est toujours aujourd’hui. Et selon moi, en tout cas, c’était une branche qui m’attirait beaucoup. Et je me suis dit : je vais regarder ce qu’il y a comme postes.
J’ai trouvé un poste, c’était un CDD en plus à l’époque. Je me suis dit : j’y vais, je verrai bien, je vais rencontrer des gens.
Jihane Herizi : Tu l’as trouvé sur le site de la CNAV du coup ?
Mélodie Dahi : Je l’ai trouvé sur l’APEC à l’époque.
Jihane Herizi : L’APEC, vraiment ?
Mélodie Dahi : J’ai regardé ça, j’ai trouvé, j’ai postulé.
Jihane Herizi : C’était quoi comme poste du coup ?
Mélodie Dahi : C’était un poste de rédactrice au secrétariat du conseil d’administration. Donc c’était en fait pour rédiger les comptes rendus des réunions du conseil d’administration. Donc vraiment, ça n’avait aucun rapport ni avec ma spécialisation en protection sociale de manière directe. C’est-à-dire que je n’allais pas travailler sur des dossiers dans le fond, ni en rapport avec autre chose dans mes études. Mais c’était l’institution, en fait. Je voulais mettre un pied dedans et je savais que c’était la première étape.
Jihane Herizi : Donc tu rentres là où tu as envie de rentrer, en faisant des sacrifices, des compromis…
Mélodie Dahi : Et à ce moment-là, je ne le vis même pas comme ça. Je me dis : j’ai envie de bosser, il faut que je gagne des sous aussi, parce que j’avais cette urgence-là à ce moment-là. Donc je me suis dit : en fait, je ne vais pas attendre qu’il y ait le poste parfait sur le papier. Parce que moi, en parallèle de mes études, je travaillais depuis déjà longtemps. Donc je savais qu’en fait le poste parfait, ça n’existe pas. Une fois que t’es quelque part avec des gens cools, ça devient parfait. Donc je me suis dit : écoute, mon seul critère, a priori, c’est que j’ai envie de rentrer dans la Sécurité sociale, spécifiquement la CNAV. J’ai trouvé un CDD, j’ai dit go. J’ai postulé, j’ai été prise et voilà. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça.
Jihane Herizi : T’as passé combien d’années là-bas ?
Mélodie Dahi : J’ai fait mon CDD de six mois, et après sur ces six mois-là j’ai fait plein de rencontres dans cette institution et notamment une qui m’a proposé un poste sur autre chose. Donc là je suis restée en CDI et après je suis restée du coup pour tout, quatre ans quasiment.
Jihane Herizi : Donc le réseau ?
Mélodie Dahi : Le réseau. Rencontrer les gens, discuter avec les gens, c’est primordial. Exactement. Avant même de très bien faire son boulot. Et j’ai toujours des amis que j’y ai rencontrés, des collègues de l’époque qui sont toujours des amis aujourd’hui.
Jihane Herizi : Et donc après ces quatre années, t’as trouvé autre chose ?
Mélodie Dahi : Oui. Et donc après, c’est pareil, une rencontre qui fait que… C’était un ancien collègue de la CNAV qui partait à la Direction de la Sécurité sociale, qui m’a proposé de le rejoindre. Donc je suis arrivée là-bas sur un poste de chargée de mission. Et là, j’ai été confrontée à ce que j’appelle un « irritant ». Vraiment un irritant quotidien. C’était la coordination de toutes les réponses aux amendements sur la loi de financement de la Sécurité sociale.
Jihane Herizi : Ah, les amendements parlementaires.
Mélodie Dahi : Ouais, exactement. Et en fait, c’était un enfer. C’était un enfer de logistique, d’organisation, de gestion. On passait des nuits blanches, des week-ends, à essayer de tenir le rythme. Et moi, je me suis dit : mais ce n’est pas possible qu’on continue comme ça. On ne peut pas accepter ça comme une fatalité.
Jihane Herizi : Tu te rappelles à quoi ça ressemblait concrètement ?
Mélodie Dahi : C’était des classeurs papier énormes, dans lesquels il fallait classer les réponses des différentes directions. Et ça bougeait en permanence, parce que les amendements changeaient, les textes évoluaient. Donc tu pouvais passer deux heures à classer, et deux heures après c’était déjà obsolète. C’était vraiment… c’était de la souffrance organisationnelle.
Jihane Herizi : Et donc toi, t’as pas dit « c’est comme ça ».
Mélodie Dahi : Non. Je me suis dit : il faut qu’on trouve une solution. On a eu la chance d’avoir un petit budget laissé par un directeur qui partait. Et on s’est dit : on va tenter quelque chose. Donc on a d’abord créé une « liseuse » numérique pour remplacer les gros dossiers papier.
Jihane Herizi : C’était quoi la « liseuse » exactement ?
Mélodie Dahi : C’était une tablette, en fait. Une application qui reprenait les réponses aux amendements, mais dans un format numérique, consultable facilement. Et là, il y a eu un moment décisif. Un soir, à l’Assemblée, la ministre de l’époque, Agnès Buzyn, était en séance. Et il y avait un amendement, la réponse papier n’était pas à jour. Mais la réponse numérique, elle, était à jour. Elle a pris la tablette, elle a lu, et elle a été sauvée par ça.
Jihane Herizi : C’est fort comme image.
Mélodie Dahi : Oui. Tout le monde a compris à ce moment-là qu’on avait mis le doigt sur quelque chose. Que ce n’était pas juste un gadget, mais une vraie solution.
Jihane Herizi : Mais toi, tu disais : le problème, c’était pas juste le classeur.
Mélodie Dahi : Exactement. Je voyais bien que le vrai irritant, ce n’était pas seulement le support papier. C’était le processus de production et de coordination des réponses. Tant qu’on ne s’attaquait pas à ça, on ne réglait pas le problème.
Jihane Herizi : Donc là, tu te dis : en fait, le vrai irritant, c’est pas le classeur, c’est la manière dont on produit les réponses.
Mélodie Dahi : Oui. Exactement. Le problème, c’était tout le flux en amont. Les fichiers Word, les suivis de modifications, les mails saturés, les validations de dernière minute. C’était un cauchemar. Et donc je me suis dit : il faut un outil où tout le monde peut contribuer directement, en même temps, et où on a de la visibilité.
Jihane Herizi : Et c’est comme ça que tu tombes dans l’univers des start-up d’État ?
Mélodie Dahi : Oui. À ce moment-là, ma DSI me dit : va voir la DINSIC — qui est devenue la DINUM. Et là, je découvre le programme beta.gouv, les start-up d’État. Et tout d’un coup, je comprends qu’on peut faire autrement : partir de l’irritant, tester une solution rapidement, avec un petit budget, en équipe réduite.
Jihane Herizi : Et toi, tu deviens intrapreneure.
Mélodie Dahi : Oui. J’ai une lettre de mission, je suis détachée à 90 % de mon temps. Et je pars dans l’aventure. Je rencontre Raphaël Pierquin, qui devient mon coach. On monte une petite équipe avec deux devs, une UX. Et on crée ZAM — pour « Zen Amendements ».
Jihane Herizi : Et ça prend tout de suite ?
Mélodie Dahi : Oui, parce que la douleur était partagée. On avait Bercy qui souffrait encore plus que nous sur le PLF. Et donc ils nous disent : « On veut tester votre truc. » Et c’est eux qui l’utilisent en premier, avant même nous. Et ça marche. Ils sont soulagés.
Jihane Herizi : Donc en fait, vous avez fait simple, mais ça répondait à un vrai besoin.
Mélodie Dahi : Exactement. Et puis on a travaillé avec un groupe utilisateur, qui grossissait toutes les deux semaines. Au début on était cinq, à la fin on était quarante. Et c’était des gens motivés, qui avaient vraiment mal, qui avaient envie d’essayer.
Jihane Herizi : Et c’est ça qui a fait l’effet boule de neige.
Mélodie Dahi : Oui. Parce qu’une fois que le PLF et le PLFSS ont utilisé ZAM et ont dit « c’est trop bien », toutes les autres administrations ont voulu l’adopter. Et là, c’était lancé.
Jihane Herizi : Et après ZAM, il y a eu la pérennisation ?
Mélodie Dahi : Oui. ZAM a été internalisé à la DILA, et est devenu « Signale ». Moi, j’ai accompagné ce transfert pendant un an. Ensuite, j’ai fait un petit passage dans le privé. Et puis je suis revenue à la DINUM.
Jihane Herizi : Alors justement, parlons d’agilité. Tu dis souvent : on n’a pas besoin d’avoir tous les postes, on a besoin d’avoir toutes les compétences. Est-ce que tu peux donner ta définition de l’agilité aujourd’hui ?
Mélodie Dahi : Oui. Ma définition de l’agile aujourd’hui, c’est : être capable à tout instant de prendre une décision éclairée et transparente. C’est ça pour moi, l’agile. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix absolu. Il y a juste : est-ce que je sais pourquoi je prends cette décision-là, avec les éléments que j’ai, et est-ce que je peux l’expliquer clairement aux autres.
Jihane Herizi : Donc pour toi, c’est pas juste une méthode avec des post-it et des stand-ups.
Mélodie Dahi : Ah non. Pour moi, l’agile, c’est une posture de transparence, de clarté, d’action. Et ça vaut dans une équipe numérique, mais ça vaut aussi dans la vie de tous les jours.
Jihane Herizi : Est-ce que tu penses que tu as toujours été agile, même avant de connaître le mot ?
Mélodie Dahi : Oui. Instinctivement. Dans ma vie perso, j’ai toujours eu ce réflexe : j’ai un problème, je cherche une solution immédiate. Pendant mes études, quand j’étais en galère d’argent, je n’ai pas attendu de réfléchir pendant six mois. Je suis allée bosser sur les bateaux parisiens, j’ai fait des crêpes, voilà. Je ne me suis pas demandé si c’était prestigieux ou pas. J’ai toujours eu ce réflexe de passer à l’action.
Jihane Herizi : Donc en fait, c’est ton perso qui a forgé ton pro.
Mélodie Dahi : Oui. Pour moi, il n’y a pas de séparation entre le perso et le pro. On est une seule et même personne. Ce qu’on vit dans sa vie influence ce qu’on est au travail, et inversement.
Jihane Herizi : Tu parles aussi souvent de « la bonne distance ». C’est quoi pour toi ?
Mélodie Dahi : Pour moi, l’agile, c’est aussi ça : savoir trouver la bonne distance. Je suis capable de m’impliquer à fond dans un projet, mais je ne souffre jamais. Je sais où est ma limite. Je mets mon énergie, mais pas au point de m’épuiser ou de mettre en danger ma vie perso. C’est ça, la bonne distance. Et ça vaut pour les projets, pour les relations, pour tout.
Jihane Herizi : Donc tu dirais que l’agilité, c’est une manière de se protéger aussi ?
Mélodie Dahi : Oui. C’est une posture qui permet d’être efficace et heureux, sans tomber dans le sur-engagement destructeur.
Jihane Herizi : Qu’est-ce qui reste difficile pour toi, aujourd’hui, dans l’agilité ? Parce que là, ça a l’air facile quand tu le racontes.
Mélodie Dahi : Alors non, ce n’est pas toujours facile. Il y a eu des moments très compliqués. J’ai frôlé le burn-out, parce que je n’avais pas encore trouvé cette fameuse bonne distance. Aujourd’hui, ce qui reste dur pour moi, c’est le perfectionnisme. J’ai tendance à vouloir que tout soit nickel, carré, parfait. Que ça soit dans le pro ou dans le perso. Et parfois, ce n’est pas possible.
Jihane Herizi : Donc il y a encore un peu de rigidité ?
Mélodie Dahi : Oui. Mais aujourd’hui, je le sais. Et rien que ça, ça change tout. Je suis capable de me diagnostiquer en temps réel. Quand je sens que je pars dans le perfectionnisme, je me dis : ok, là, je m’éloigne de l’agile, je me tends trop. Donc j’essaie de relâcher. C’est un travail de toute une vie.
Jihane Herizi : Finalement, être agile, c’est aussi savoir dire : « là je ne le suis pas encore, mais je le vois ».
Mélodie Dahi : Exactement. C’est éclairer même ses propres failles. Dire : « je ne suis pas encore assez agile là-dessus, mais au moins je le sais ».
Jihane Herizi : Super. Écoute, on a encore beaucoup de choses à dire. Moi, je te propose qu’on arrête là pour aujourd’hui, et qu’on fasse une deuxième partie.
Mélodie Dahi : Avec plaisir.
Jihane Herizi : Dans la deuxième partie, on parlera des mentorats que tu accompagnes, des transformations que tu observes, et aussi des difficultés qu’on rencontre encore toutes les deux quand on forme ou qu’on accompagne. Ça sera l’épisode 3. Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter d’ici là ?
Mélodie Dahi : De continuer sur ma lancée. Moi, j’aspire à une forme de continuité. Je travaille tous les jours pour rester sur la bonne voie, donc je veux rester dessus.
Jihane Herizi : Parfait. Merci Mélodie. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutées. Si vous avez tenu jusqu’au bout, bravo. Et n’hésitez pas à nous écrire à campus-numerique@gouv.fr, à partager l’épisode avec vos collègues, vos amis, vos familles, et à nous dire ce que ça vous a fait. On se retrouve très vite pour la deuxième partie.
Mélodie Dahi : Merci Jihane.
Jihane Herizi : Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du Coup de boost Agile. On vous avait promis une deuxième partie avec Mélodie Dahi qui est avec moi. Salut Mélo !
Mélodie Dahi : Bonjour ! Je suis contente de te voir.
Jihane Herizi : On enregistre une semaine après la première partie. On n'avait pas du tout prévu de faire deux parties, mais on a tellement de choses à dire… ça se trouve, on va promettre encore une troisième partie. On va voir. On verra à la fin de l'épisode. Vous le savez : on est complètement agiles, on fait ce qu’on prône.
Pour rappel, pour ceux qui commenceraient par ce petit morceau d'épisode — et je le rappellerai à chaque fois — c'est un podcast brut. Il n'y a pas de musique, pas d'intro, pas de conclusion, pas de souriture. On est vraiment là en train de discuter à deux personnes, et peut-être à plus sur d'autres épisodes. Donc voilà, ne vous attendez pas à des montages, à des effets spéciaux. Il n'y aura rien du tout. Ce qui arrivera, arrivera. Je suis trop contente de te voir.
La dernière fois, on avait enregistré la première partie de l'épisode et on avait parlé de ton parcours personnel, individuel, professionnel, autour de l'agilité. On a parlé de la CNAV, de la DSS, de la DINUM, des startups d’État chez beta.gouv. Et pourquoi on a commencé par ça ? Parce que ce que je voulais donner à voir — et c'est ce dont on va parler aujourd'hui — c'est qu'en développant ton agilité, grâce à ta vie personnelle vers le pro, et ensuite en faisant le cercle retour, c'est comme le sigle infini, du pro vers le perso… même si on s’est tout à fait dit toutes les deux qu’on ne voyait pas de limite ou de différence entre perso et pro.
D’où le sigle infini : en développant cette agilité, quelque part tu ne savais pas ce que tu allais en faire, et petit à petit tu en as créé quelque chose. On t’a appelée, tu as monté des choses, et finalement aujourd’hui tu es revenue à la DINUM. Tu dis que tu avais fait un petit passage par le privé rapidement — dont on ne va pas parler parce que ce n’est pas le sujet. Tu reviens à la DINUM, et finalement ce que tu as toujours fait, qui était très naturel, qui était un avantage secondaire, à côté, et qui n’a jamais été le cœur de ton poste… est devenu ton poste finalement.
Est-ce que tu nous racontes un tout petit peu comment tu reviens dans le département qu’on appelle ACE à la DINUM ? Qu’est-ce que c’est ACE ? Comment tu as créé l’agilité dans ton poste, et de ton poste l’agilité ? Et nous ce qui nous intéresse aujourd’hui, comme ça on est à 2 minutes 17 — vous savez si vous voulez éteindre l’épisode si ça vous intéresse — c’est :
On va parler des accompagnements de Mélodie, en gardant l’anonymat des clients. On ne parlera pas des structures, on ne donnera pas de noms. Peut-être les titres de poste — puisqu’aujourd’hui Mélodie accompagne des directeurs, directrices de projets, des directeurs, directrices de systèmes d’information. Donc ça, ce n’est pas reconnaissable. Mais c’est ce niveau-là de profils qu’elle accompagne. Et l’idée, c’est que vous compreniez :
- quel type de profil,
- comment elle les aide à se transformer en individuels, en collectifs, avec leurs équipes,
- et qu’est-ce qu’on en a déroulé au Campus.
Et comment aujourd’hui on se retrouve face à des difficultés, face à des incompréhensions. Il y a des choses qui sont extrêmement faciles, qui fonctionnent, on a plein de retours qu’on pourra vous mettre sur le site. On n’est pas en train de parler aujourd’hui de comment on fait les choses bien, de faire du marketing. On est plutôt là pour discuter de qu’est-ce qui bloque aujourd’hui, parce qu’on a besoin de vous. On a besoin de parler avec vous, de comprendre, de vous accompagner. On a besoin que vous reveniez vers nous, que vous nous écriviez pour dire : voilà, nous aussi on a ce problème-là, et on peut travailler ensemble.
Donc écoutez bien jusqu’à la fin si ça vous intéresse : ça vous donnera des billes pour vous. Et gardez bien une chose en tête avec laquelle on conclura : si vous devenez agile, ou si vous êtes déjà agile, ou si vous utilisez cette façon de faire, cette façon d’être… peut-être que vous pourrez vous aussi en créer un poste comme Mélodie. Puisque notre objectif final c’est d’avoir des ambassadeurs agiles dans toutes les administrations, de les former, et que vous puissiez vous aussi devenir mentor, coach — peu importe, utilisez le mot que vous voulez. Nous on n’aime pas ces mots, on oublie de les utiliser, parce qu’on ne sait pas comment faire autrement. Mélodie va vous en parler mieux que moi.
Mélodie, du coup, quand est-ce que tu es revenue à la DINUM ? En quelle année ? Est-ce que tu peux nous raconter ACE ?
Mélodie Dahi : Oui. Alors je ne suis techniquement pas revenue directement à ACE, mais je vais te raconter. Je suis revenue en 2022, si je ne me trompe pas. Donc entre mon départ et mon retour il s’est passé le Covid et mon expérience dans le privé. Donc il s’est passé quand même pas mal de trucs, même d’un point de vue perso. Et je reviens pour bosser avec la brigade à l’époque. Tu te souviens ? C’était l’équipe, la BIN, la brigade d’intervention numérique qu’on avait créée…Donc je reviens pour bosser avec la brigade à l’époque. Tu te souviens ? C’était l’équipe, la BIN, la brigade d’intervention numérique qu’on avait créée. Je crois que c’était fin 2020. Nous on était la deuxième. Moi j’avais monté la première, je me rappelle, et ensuite Inès avait repris la deuxième. Mais le format avait été un peu modifié et amélioré. Donc toi tu rejoins la deuxième pendant le Covid. Moi je rejoins la deuxième qui est censée être du coup plus structurée, plus officielle, etc. Donc qui est un peu censée être la première vraie sous la forme passionnelle et optimiste.
En fait c’est un test. C’est un test. En réalité, j’ai l’impression que ça s’est créé plutôt organiquement. On s’est dit : tiens, il y a un besoin. Et ça s’est fait en un mois et demi. On a monté douze personnes en plein Covid.
Donc voilà : l’idée de cette brigade, c’était de se dire : il y a des commandes politiques qui tombent régulièrement, il faut mobiliser rapidement des experts sur des trucs. Pourquoi est-ce qu’on n’aurait pas des experts à disposition en permanence ? Donc on est, je sais plus combien, une dizaine à être recrutés multidisciplinaires : il y a des designers, des devs et des coachs. Alors du coup sur nos contrats on nous appelle des “intras”. C’est marrant, parce qu’on voit qu’il y a déjà une confusion autour de ce truc-là. Mais voilà : des profils plutôt produit / coaching.
Donc moi je reviens là-dessus, je reviens en tant que coach dans la brigade. L’actualité politique du moment, c’est : renouvellement de gouvernement, renouvellement de cabinet… donc un peu un flou, une temporisation sur les commandes politiques. Plus, actualité politique beaucoup plus proche de nous : arrive la réorganisation de la DINUM. Et c’est là où se crée le poste que j’occupe aujourd’hui.
Jihane Herizi : Donc en fait, au départ tu arrives encore une fois sur un autre prétexte, et puis tu finis par aller ailleurs.
Mélodie Dahi : Exactement.
Jihane Herizi : Et ACE, c’est quoi ?
Mélodie Dahi : ACE c’est un département qui existait avant la réorganisation de la DINUM, mais qui s’appelle donc Appui Conseil Expertise. Et c’est un assez gros département dans lequel il y a notamment une équipe — un peu dans la même idée — qui s’appelle aujourd’hui aussi la brigade d’intervention numérique, une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a différentes expertises, et qui est à la disposition des équipes dans tous les ministères, dans tous les organismes publics, pour en fait tout simplement les appuyer ponctuellement sur leurs difficultés, ou leur apporter des expertises particulières sur leurs projets, sur leurs produits.
Et en fait, au moment de la réorganisation, on s’aperçoit que dans ACE il y a historiquement une équipe qui s’occupe d’appliquer le droit de la DINUM : en fait l’audit, voire même la sanction, sur les gros projets et produits informatiques de l’État. Ceux qui dépassent un certain seuil budgétaire. Alors il y a un chiffre, je ne sais plus exactement ce que c’est… franchement je l’ai oublié pour être honnête. Dans ma tête c’est 7 millions, mais c’est peut-être 3, peut-être entre 3 et 7. Bref.
Donc l’idée, c’est : la DINUM, de par son expertise sur le numérique, a par décret le droit d’aller auditer, ou donner un avis favorable ou défavorable. Et donc ça peut carrément arrêter un projet, sur tout projet ou produit qui dépasse ce seuil.
À partir du moment où on a dépassé ce montant-là, on peut être sujet à une procédure. Pas automatique, mais ça existe. On appelle ça les procédures article 3, article 4. Peut-être que le seuil a changé depuis, peut-être qu’il a diminué. Voilà. En tout cas, cette équipe-là existe depuis toujours.
Et en fait, on se rend compte à un moment donné qu’on a cet axe d’action, ce levier d’action — auditer, sanctionner — mais qu’on n’a pas le pendant “accompagnement”. Soit on n’y va pas, soit on y va pour sanctionner. Mais on n’avait pas cette notion de : on vous propose de l’aide. Pas un mentor, mais quelqu’un qui vient, qui vous aide à y voir plus clair sur : qu’est-ce que c’est l’impact, l’agilité, le mode produit, etc.
Et donc, au moment où la DINUM opère sa réorg, le mode produit est vraiment mis à l’honneur. On dit officiellement : c’est la manière dont on veut travailler, dont on veut que tous les ministères travaillent. Et donc on crée une équipe à disposition des ministères pour basculer, pour accompagner, pour sanctionner.
Jihane Herizi : Conduite du changement, quoi. Pas juste dire “on veut que ce soit comme ça” et ne rien faire.
Mélodie Dahi : Exactement. On dit “on veut que ce soit comme ça” et on met en place des moyens.
Jihane Herizi : Donc toi, tu entends cette opportunité, et tu fonces.
Mélodie Dahi : Ah oui. Super intéressant. Moi, ça faisait déjà quelques temps que je coachais en interne, principalement les équipes du programme beta.gouv. Donc je me dis : quoi de mieux, dans mon envie d’avoir de l’impact et d’aider les agents publics à transitionner, que d’aller faire quasiment la même chose pour des équipes ministérielles, partout dans l’État ?
Donc moi je fonce faire ça. Et voilà pourquoi c’est hyper important que ça soit complètement dissocié de l’équipe “maîtrise des risques”, qui s’occupe des procédures article 3, article 4, audits et sanctions. Je sais pas si “sanction” est le mot officiel, mais en tout cas voilà. Parce que je peux pas être juge et partie. Moi j’ai le moins possible de contact avec eux. Si les équipes que j’accompagne se retrouvent dans une posture particulière parce que j’ai trop d’échanges ou d’implications dans les procédures réglementaires, ça marche plus. Le lien de confiance ne se crée pas.
Donc très volontairement, et en accord avec l’équipe maîtrise des risques — avec qui je m’entends très bien — on s’est tout de suite dit : quand on rentre en contact avec une équipe, on fait les contacts ensemble au départ, pas de souci. Mais dès qu’on peut, on se dissocie. Eux font les audits, nous on fait l’accompagnement. Voilà pourquoi je ne me mélange pas trop avec cette procédure.
Jihane Herizi : Ce qu’on appelle, je crois, en juridique, la “muraille de Chine”, quand des avocats ne doivent pas se parler.
Mélodie Dahi : Exactement.
Jihane Herizi : Ok, donc tu commences comme ça. Et donc, sans dévoiler les structures, ce sont des ministères ?
Mélodie Dahi : Oui, ça peut être des ministères, ça peut être aussi des organismes publics. En tout cas, ce sont des équipes qui sont depuis peu ou depuis longtemps en train de travailler sur un projet informatique, et qui ont des difficultés.
Donc quand on a dit ça, on voit bien que la définition est très floue. Et c’est volontaire : surtout dans un contexte où on crée cette activité d’accompagnement, on n’avait absolument pas de critères pour dire “oui, vous avez droit à un accompagnement” ou “non, vous n’y avez pas droit”.
Dès que quelqu’un levait la main, on y allait. Alors je dis “on”, mais au départ j’étais toute seule. Après l’équipe s’est constituée. Aujourd’hui je crois qu’on est sept mentors, un truc comme ça.
Jihane Herizi : Sept mentors internes à la DINUM ?
Mélodie Dahi : Oui. On est vraiment à la disposition des équipes qui sont en difficulté. Parce que ça peut venir en complément d’une procédure qui va avoir lieu ou qui a eu lieu en matière d’audit ou de sanctions. Exemple : vous venez d’avoir un audit, on vous propose un accompagnement. Ou : vous allez devoir faire une procédure de demande d’avis sur votre projet, donc prenez un accompagnement pour pivoter, pour remplir correctement les papiers.
Mais ça peut aussi être quelqu’un qui lève la main et qui dit : “On est en difficulté, est-ce que la DINUM peut nous aider ?” C’est arrivé que des gens disent : “On ne sait pas quoi faire, on toque à la porte de la DINUM, qu’est-ce que vous avez pour nous ?” Et maintenant, on est capables de dire : on a, si vous voulez, des mentors.
Donc c’est vachement bien, parce que c’est gratuit évidemment — administration à administration — donc ça apporte quelque chose de très fort symboliquement. Avant, on se faisait beaucoup accompagner par des coachs extérieurs, des prestataires. Et moi j’ai toujours l’image en tête : comment veux-tu qu’un prestataire ait envie de scier la branche sur laquelle il est assis ? Quel est son intérêt à te rendre indépendant de son accompagnement ?
Donc ça crée des dynamiques hyper particulières. Moi je trouve que c’est génial qu’on ait cette offre de service en interne, à la DINUM, pour les administrations.
Jihane Herizi : C’est exactement ce que racontait Fadila dans l’épisode 1 sur les cabinets de conseil et la réinternalisation des compétences.
Mélodie Dahi : Absolument.
Jihane Herizi : Donc toi, tu rejoins ce point-là. Et on est beaucoup à le rejoindre.
Mélodie Dahi : Oui. L’idée, c’est de se dire : on réinternalise la compétence. On devient des profs-consultants de l’État en interne, en étant agents publics et en ayant le pied dedans.
Jihane Herizi : C’est ça finalement : on est des experts. Mais on ne décide pas à la place des prestataires. On dit non, au contraire, la prestation est un levier puissant, si on l’utilise correctement.
Mélodie Dahi : Exactement. Quand la prestation compense un manque — pas assez de sous pour engager, etc. — là on touche la limite. Mais quand on dit “la DINUM a l’expertise, la DINUM vient vous aider”, c’est fort.
Jihane Herizi : Mais du coup, tu n’as pas été formée à ce métier. C’est quelque chose que tu as créé personnellement, puis professionnellement, puis étape après étape pour arriver ensuite à être repérée. Donc tu l’as pratiqué, tu as montré que tu savais le faire.
Et nous, c’est ça qu’on essaie de faire aujourd’hui — notamment avec le Booster Agile. Que les agents soient boostés sur leur agilité pour faire évoluer leur carrière, booster leur carrière. Qu’ils puissent se dire : “Ok, j’ai appris ça, ça me sert dans ma vie, mais je peux aussi refaire quelque chose autour de mon job, et lever la main pour dire : je sais faire ça, je peux accompagner des équipes dans mon ministère ou mon organisme.” C’est un peu ça notre objectif.
Donc jusqu’à présent, tu as accompagné combien de personnes ?
Mélodie Dahi : En nombre de personnes c’est dur à dire… mais en nombre de projets : cinq ou six, sur deux ans.
Jihane Herizi : Et sur chaque projet, ça touche combien de personnes environ ?
Mélodie Dahi : En moyenne, ça se centre sur un noyau de quatre personnes. Mais parfois ça s’élargit : j’ai un exemple en tête où il y a au moins une vingtaine d’interlocuteurs réguliers. Et parfois ça se resserre : spécifiquement sur le directeur ou la directrice, une seule personne. Parce que cette personne a besoin d’un coaching régulier vraiment pour elle.
Donc ça dépend. C’est complètement sur mesure. Moi je crois beaucoup à la puissance de ça. Déjà parce que c’est une activité qui se crée — donc forcément on invente le métier en même temps qu’on le fait. Et aussi parce que je me rends compte qu’il n’y a que comme ça que ça fonctionne.
Même si je dis souvent que je n’ai pas de protocole — parce que des choses inattendues peuvent arriver — globalement, je m’aperçois que les phases se répètent dans mes mentorats. J’ai toujours une phase d’observation. Souvent je leur demande de me raconter : comment eux vivent la situation, pourquoi je suis là, pourquoi ils ont appelé, ou pourquoi l’aide leur a été imposée. Je les écoute, je les observe.
Je demande aussi à participer en auditeur pur à toutes leurs réunions, tous leurs rituels. Voir les dynamiques : qui prend la parole, sous quel prétexte on se réunit, et qu’est-ce qu’on se dit vraiment.
Puis, j’ai une phase de diagnostic. Je leur dis ce que j’ai vu, ce que ça m’évoque, et je leur demande ce qu’ils en pensent. J’essaie de partager à la fois des faits et des ressentis. Parce que c’est précieux pour eux d’avoir quelqu’un d’extérieur, qui a un regard neuf et qui dit : “Il se passe ça, moi j’ai l’impression qu’il se passe ça, ça.” Parfois ça les rassure, parfois ça les étonne. Mais il se passe toujours quelque chose à ce moment-là.
C’est aussi une phase de construction de confiance. Souvent, c’est le moment où je parle plus de mes expériences, pour qu’ils comprennent ma légitimité. Et eux, de leur côté, commencent à décider s’ils veulent s’ouvrir. Parce que moi, je ne peux pas forcer quelqu’un à transitionner s’il n’a pas envie.
Donc j’essaie de les amener à ça, en disant : voilà mon parcours, voilà mon diagnostic, voilà ma manière d’accompagner. Chacun a son style. Moi, mon style, c’est de dire : l’agilité, c’est un continuum.
Il y a deux extrêmes qui n’existent pas : l’extrême catastrophique (0% d’agilité), ça n’existe quasiment nulle part ; et l’extrême inverse (100% d’agilité), ça n’existe pas non plus. Donc le sujet, ce n’est pas de dire “vous êtes à 0 et vous voulez aller à 100”. C’est : vous êtes quelque part entre les deux, et qu’est-ce qu’on peut faire pour avancer d’un pas dans la bonne direction ?
Jihane Herizi : C’est exactement ce qu’on fait en coaching, en thérapie. Tu prends les gens là où ils sont, et tu avances 1% par 1%. Tu demandes : “Sur 10, tu es à combien ? À 4 ? Ok, comment passer à 5 ? Puis à 6 ?”
Mélodie Dahi : Voilà. Moi je ne suis même pas très intéressée de savoir précisément où ils sont. Je veux juste savoir dans quelle zone. Et ensuite, on avance. Petit pas par petit pas.
Jihane Herizi : Donc là, tu crées un cadre de sécurité. Tu leur expliques ton fonctionnement, tu dis : il va se passer ça, ça, je ne sais pas exactement quoi, mais je partage mes expériences, mes intentions, ma manière de faire… Et eux choisissent s’ils veulent jouer le jeu.
Mélodie Dahi : Oui. J’essaie au maximum de répondre à leurs inquiétudes. D’observer dans quel état d’esprit ils sont, et de me mettre en miroir.
Par exemple, j’ai eu un cas où je me suis rendue compte qu’un petit collectif — pas celui que j’accompagnais initialement — avait besoin d’aide. Et leur réaction était un peu inquiète, presque hostile. Moi, j’ai tout de suite capté qu’ils avaient besoin de comprendre qui j’étais, d’où je venais, pourquoi j’étais légitime.
Donc j’ai organisé un échange volontairement comme un tribunal. C’était clair pour moi : ils devaient me voir vulnérable, pour être en confiance. Je me suis mise en face, loin de la table, sans appui. Comme un accusé presque. Mais évidemment, dans mon discours, pas du tout : j’étais souriante, naturelle, telle que je suis. Et ils m’ont bombardée de questions.
Au bout de quarante minutes, le chef de l’équipe m’a dit : “Ok, c’est bon pour moi, on peut bosser ensemble.” Voilà, il avait besoin de ça.
Jihane Herizi : Et souvent, c’est une phrase précise, juste avant ou après, qui déclenche le basculement.
Mélodie Dahi : Exactement. Et dans ce cas, je crois que c’était mon image du continuum : “Mon objectif n’est pas de vous amener à 100%, mais de vous faire avancer dans la bonne direction.” Je pense que ça a déclenché.
À l’inverse, j’ai eu un autre cas où la confiance s’est créée hyper vite. En quelques semaines, les trois personnes au noyau du projet avaient déjà transitionné. Ils avaient les déclics tout de suite. Ils n’avaient presque plus besoin de moi au quotidien. Juste ponctuellement, pour des situations spécifiques.
Et ça, pour moi, c’est une étape importante.
La première étape, c’est la prise de conscience : révéler où ça bloque.
La deuxième, c’est l’acquisition de nouveaux réflexes. J’appelle ça “l’effet moniteur d’auto-école”. Quand quelqu’un me dit : “Je sais ce que tu vas dire : tu vas me demander pourquoi, ou de chercher le besoin…” Là, je coche la case dans ma tête : ils ont intégré le réflexe. Comme quand j’étais en auto-école : mon moniteur m’avait dit un jour, en descente, “Dieu merci, on a les freins.” Et encore aujourd’hui, à chaque côte, j’entends sa voix.
La troisième étape, c’est quand ils passent à l’action. Exemple : une directrice qui a un problème avec une personne de son équipe. Première question qu’elle se pose : “Qu’est-ce que j’ai fait de mal, moi ?” Là, c’est gagné : le doigt vers soi, la responsabilité.
Autre exemple : un directeur de projet qui avait mis une fonctionnalité importante en bas de sa liste. En discutant, il s’est rendu compte que c’était en fait la plus utile pour son objectif. Deux semaines plus tard, il m’a dit : “J’ai changé la prio, tu avais raison.” Et je lui ai répondu : “Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est toi.” Là, je sais qu’il a musclé son cerveau à agir différemment.
Jihane Herizi : Donc les trois clés : 1. prise de conscience, 2. réflexes, 3. passage à l’action. Et toi, tu dis toujours : le 0% et le 100% n’existent pas. On est entre les deux, et on avance.
Mélodie Dahi : Oui. Et ça vaut pour tout dans la vie. Quand quelqu’un dit “je ne suis pas créatif”, ou “je ne sais pas faire ça”, en fait il n’est jamais à zéro. Il peut toujours progresser d’un cran.
Jihane Herizi : Finalement, ton objectif, c’est d’apporter de l’éclairage sur deux choses : l’impact et la santé mentale.
Mélodie Dahi : Oui. Toujours ces deux axes. Impact et santé mentale. Mais je précise : je ne fais pas de thérapie, ce n’est pas mon rôle. Ce que je veux, c’est que les gens aillent mieux, qu’ils comprennent leurs blocages et qu’ils puissent les changer. C’est de l’agilité relationnelle, pas de la psy.
Et sur l’impact, c’est souvent : soit on n’en a pas, soit on ne le voit pas, soit on en veut mais on ne sait pas comment. Mon rôle, c’est d’aider à clarifier.
Jihane Herizi : Donc la transition, pour toi, c’est : révéler où ça bloque, puis donner des clés. Et une des clés, c’est un mot : “Pourquoi”.
Mélodie Dahi : Exactement. Pour moi, “Pourquoi” est le mot le plus puissant en agilité. Pourquoi ce besoin, pourquoi cette réaction, pourquoi ce choix… C’est un mot que je répète dix fois par jour. Et c’est souvent lui qui déclenche la prise de conscience.
Jihane Herizi : Mais tu dis aussi qu’il faut marcher sur des œufs au départ. Parce que tu dois poser des diagnostics parfois durs — du style : “Aujourd’hui, vous êtes en échec.”
Mélodie Dahi : Oui. Et c’est difficile à entendre. Donc je dois pouvoir le dire sans perdre la confiance. Sans créer d’impudeur non plus, parce que dans l’administration il y a beaucoup de pudeur, parler des échecs n’est pas simple. Mon rôle, c’est d’amener à la prise de conscience sans que ça devienne contre-productif.
Après, une fois que cette première étape est franchie, les suivantes s’enchaînent beaucoup plus vite.
Jihane Herizi : C’est aussi ce qu’on retrouve dans le Booster Agile. On voit trois cas :
– les volontaires, qui s’inscrivent et qui au début râlent mais à la fin adorent ;
– les “intermédiaires”, pour qui c’est dans leur parcours mais pas vraiment choisi, et qui disent “vous ne comprenez pas notre contexte” ;
– et enfin les réfractaires, pour qui c’est tombé dessus et qui sont fermés.
Mélodie Dahi : Oui. Et ça, c’est la grande différence avec mes mentorats. Parce que dans les mentorats, je vais dans leur quotidien. Je parle leur langage, j’apprends leur sujet, leurs sigles, leurs contraintes. Du coup, ils ne peuvent pas me dire “ça ne s’applique pas”.
Alors que dans un Booster, on est hors de leur quotidien. Ils peuvent penser que ça ne s’applique pas.
Jihane Herizi : Et c’est là où on se dit qu’on doit être nous-mêmes plus agiles. Faire plus de sur-mesure. Étudier un peu plus le contexte avant d’intervenir. Parce que sinon, on nous renvoie : “Oui mais vous êtes la DINUM, vous êtes beta.gouv, vous êtes à part.”
Mélodie Dahi : Oui, c’est frustrant. On nous dit : “Oui mais toi, c’est pas pareil. Tu es différente.” Et moi je ne sais pas comment leur montrer que non, je ne suis pas différente. J’ai juste fait ce travail. C’est difficile.
Jihane Herizi : C’est comme si toi tu étais au chapitre 4, eux au chapitre 1, et ils n’arrivent pas à imaginer que c’est possible.
Mélodie Dahi : Voilà. Comme des univers parallèles. Tout existe en même temps, mais c’est improuvable. Comme la loi de Schrödinger : tant qu’on n’a pas vérifié, on ne sait pas.
Jihane Herizi : Et c’est pour ça qu’on aimerait inviter d’autres personnes, d’autres ministères, d’autres opérateurs, pour témoigner. Pour montrer que ça existe ailleurs, pas seulement à la DINUM. Parce qu’on le sait : la DINUM, ce n’est pas 100% agile. Comme nulle part. C’est des personnes, des personnalités, pas une institution.
Mélodie Dahi : Exactement. Et plus on sera nombreux à témoigner, plus le discours sera légitime.
Jihane Herizi : Alors, Mélodie, est-ce qu’il y a une chose que tu voudrais laisser aux auditeurs à la fin de cet épisode ?
Mélodie Dahi : Oui. Un conseil simple : osez. Si vous avez une petite chose en tête, une conversation à avoir, une demande à faire… osez. Souvent on se fait des montagnes pour rien. Oui, il y a des contraintes dans l’administration. Mais il y a aussi des bulles de liberté. Et souvent, il ne se passe rien de grave si vous osez. Donc faites un petit pas.
Jihane Herizi : Merci. Et je complète avec une phrase pour l’épisode 4 : l’imagination est plus douloureuse que la réalité. Sortez de vos têtes, confrontez vos terrains. C’est ça, être agile.
Merci Mélodie. Merci à vous d’avoir écouté. Nous on va aller déjeuner et profiter du soleil, puisque c’est le 15 août. Prenez soin de vous, et à très vite dans le prochain épisode.
L’agilité qui panse les blessures humaines
par Jihane Herizi, psychologue du travail et coach agile
Dans les 3 épisodes précédents vous m'avez entendue interviewer Fadila et Mélodie.
Fadila Leturcq, cheffe du Campus du numérique public, porte une vision claire : celle d’un État plus souverain par la compétence, où chaque agent devient acteur de sa transformation, et où apprendre, c’est déjà agir.
Et Mélodie Dahi, figure de terrain, a incarné l’agilité dans sa forme la plus brute : celle qui naît d’un irritant, d’un désordre, d’une nuit blanche. Elle a prouvé que l’agilité ne vient pas d’un post-it, mais d’un sursaut intérieur.
Fadila, c’est la vision. Mélodie, c’est le mouvement. Et entre les deux, il y a le vivant. Ce que je viens raconter aujourd’hui.
L’agilité, une manière de rester vivant
Un jour, un agent m’a dit :
« Je ne suis pas fatigué de travailler. Je suis fatigué de devoir être fort tout le temps. »
Cette phrase m’a traversée. C’est là que j’ai compris que l’agilité n’était pas une méthode, mais une manière de rester vivant.
Ces dernières années, j’ai vu l’agilité se répandre dans les administrations, les collectivités, les startups d’État. Et j’ai vu une chose essentielle : l’agile ne sert pas à aller plus vite, ni à livrer plus. Il sert à livrer plus justement. Justement dans le sens de l’équilibre humain : à la bonne cadence, avec du sens, du respect et du lien.
L’agile, quand il est compris, ne pousse pas : il respire. Il redonne la juste mesure entre la performance et la paix.
Parce qu’entre notre première respiration et la dernière, rien n’est stable. Tout change. Et l’agile, c’est l’art de traverser le changement sans perdre son âme.
Comment j’ai découvert la vraie agilité
Pendant longtemps, j’ai cru que l’agile servait à délivrer mieux. À organiser des rituels, à fluidifier des processus, à gérer des projets autrement. Et puis, un jour, j’ai compris : l’agile n’était pas un cadre, mais une boussole.
Cette révélation est venue non pas d’un livre, mais d’un terrain. Un terrain fatigué, tendu, humain. Un jour où tout semblait bloqué. Je me souviens d’une réunion où plus personne ne parlait : juste des regards fuyants, des mâchoires serrées. Et j’ai vu qu’avant de parler d’organisation, il fallait parler de respiration. Avant de parler de méthode, il fallait parler de sécurité intérieure.
Ce jour-là, j’ai compris que l’agilité ne change pas les outils : elle change la manière de se tenir au monde. Elle apprend à écouter, à ajuster, à pardonner, à recommencer. Et c’est à ce moment précis que j’ai cessé d’enseigner l’agilité, pour commencer à la vivre.
D’où viennent nos blessures
Avant de parler d’agilité, parlons d’humanité. Parce qu’on ne laisse pas son passé à la porte du bureau. Et qu’aucune transformation n’est durable si elle oublie la part blessée de ceux qui la portent.
Quand on est enfant, on découvre le monde à travers le regard des autres. Si ce regard est stable et aimant, le cerveau apprend : « Je suis en sécurité. » Mais si ce regard est absent, moqueur ou incohérent, le cerveau apprend : « Je dois me protéger. »
Alors, on crée des stratégies : se battre, fuir, se figer, plaire. Et ces stratégies, on les rejoue au travail, sans s’en rendre compte.
Il n’y a pas de problèmes de couple ou de travail. Il y a des enfants blessés dans des corps d’adultes, qui cherchent encore à être vus, entendus, aimés.
Et c’est pour ça que le personnel finit toujours par atterrir dans le professionnel. Pas parce qu’on est fragiles. Parce qu’on est humains.
Les blessures humaines et les rituels qui réparent
Il y a cinq grandes blessures : le rejet, l’humiliation, l’abandon, l’injustice et la trahison. Et l’agilité, quand elle est vivante, vient les réparer une à une, par le collectif, le rythme et la parole.
Chaque rituel agile est un symbole psychique. Un outil concret, oui, mais surtout un geste thérapeutique collectif. Parce que ce qu’on ne soigne pas en soi, on le répète avec les autres.
Le rejet — réparé par la visibilité et le Daily
Le rejet, c’est la peur de ne pas avoir sa place, de déranger, de ne pas compter. Le daily, cette brève rencontre quotidienne, vient réparer cette peur silencieuse.
C’est un cercle où chacun se voit, se salue, se resitue.
On dit : « Voilà où j’en suis, voilà ce qui me bloque. »
On ne rend pas des comptes, on se relie.
Psychologiquement, c’est un rituel de visibilité et d’appartenance.
Le kanban, ce tableau visible des tâches, devient le miroir du lien.
Il dit à chacun : « Regarde, tu fais partie du mouvement. »
L’humiliation — réparée par la parole et la Rétrospective
L’humiliation laisse une trace de honte. Elle pousse certains à dominer, d’autres à se cacher.
La rétrospective vient réparer cette trace.
C’est l’espace de vérité douce : on parle des faits, pas des fautes.
Là où la honte se cache, la parole éclaire. Et quand la parole circule, la honte s’évapore.
C’est une thérapie collective du travail, sans blouse blanche.
L’abandon — réparé par la co-présence et le Sprint Planning
L’abandon, c’est la solitude au milieu du collectif.
Le sprint planning vient réancrer le lien.
On décide ensemble ce qu’on entreprend, on s’écoute, on s’engage.
Ce rituel réécrit une phrase intérieure : « Je ne suis pas seul. »
Le backlog, cette liste vivante des besoins, agit comme un contenant psychique.
Il donne une structure à l’invisible, un espace sûr où tout ce qui compte trouve sa place.
L’injustice — réparée par la clarté et la Revue de sprint
L’injustice, c’est la colère du flou.
La revue de sprint rétablit la justice symbolique.
On y montre ce qu’on a fait, on reconnaît l’effort, on partage les apprentissages.
C’est un rituel de clarté et de validation.
Ce qu’on éclaire ne fait plus mal.
Quand la contribution est reconnue, le corps se relâche, le cœur se rouvre.
La trahison — réparée par la cohérence et la Congruence
La trahison, c’est la rupture de confiance.
L’agilité répare cette blessure par la congruence : dire ce qu’on va faire, faire ce qu’on dit, reconnaître quand on se trompe.
Les user stories, ces phrases qui décrivent un besoin humain réel, reconnectent à la sincérité :
« En tant qu’usager, j’ai besoin de… »
La parole tenue, c’est la racine de la confiance.
Chaque rituel agile est une micro-thérapie collective.
Il transforme le chaos en rythme, la peur en clarté, le flou en mouvement.
Ce n’est pas de la méthode, c’est de la rééducation du lien.
Une histoire pivot
Je me souviens d’un directeur, un homme solide, respecté, qui m’a dit un jour :
« Jihane, j’ai tout donné. Et pourtant, plus personne n’avance. »
Je lui ai demandé :
« Et vous ? Quand avez-vous pris soin de vous pour la dernière fois ? »
Il m’a regardée longtemps et a dit :
« Je ne sais plus. »
Ce jour-là, j’ai compris que ce ne sont pas les organisations qui s’effondrent, ce sont les humains qu’on oublie d’entretenir.
Et l’agilité, quand elle est vivante, sert avant tout à ça : remettre de la respiration dans le vivant.
Le désenchantement et le courage de recommencer
Quand on entre dans l’administration, on croit servir un idéal.
Et puis on découvre la lenteur, les contraintes, les murs invisibles.
L’agilité ne supprime pas ces murs : elle apprend à marcher avec eux, à trouver les failles de lumière.
Elle permet de retrouver la joie d’agir, sans attendre que tout change.
Le désenchantement est souvent un signe de lucidité.
Et la lucidité, quand elle se relie à l’action, devient courage.
Les valeurs agiles, vues par la psy
Derrière les mots courage, focus, engagement, respect, ouverture, il n’y a pas des injonctions, mais des besoins humains.
Le courage, c’est rester présent dans l’inconfort.
Le focus, c’est ramener son attention à l’instant.
L’engagement, c’est agir en accord avec ses valeurs.
Le respect, c’est reconnaître la valeur de l’autre et la sienne.
L’ouverture, c’est accepter de ne pas tout savoir et rester curieux.
Ces valeurs calment le système nerveux, restaurent la sécurité intérieure et rendent possible la coopération réelle.
Ce n’est pas la vitesse qui sauve, c’est la justesse.
L’histoire du “nous”
Nous avons hérité d’un État fort, protecteur, mais parfois rigide.
Et nous essayons aujourd’hui de lui rendre sa souplesse sans lui retirer sa force.
L’agilité n’est pas une mode managériale : c’est une manière de redonner du souffle à l’État, de reconnecter les institutions à la vie qui les traverse.
Parce qu’un État qui ne respire plus, c’est une société qui s’essouffle.
Les outils agiles comme symboles humains
Le backlog est un miroir intérieur : tout ce qu’on a à faire, à dire, à clarifier.
Le kanban rend visible le mouvement et libère le mental.
Les user stories apprennent l’empathie et la clarté.
Les rituels — daily, rétrospective, revue de sprint, planning — sont autant de formes de respiration psychique.
Ces outils ne sont pas des outils de productivité, ce sont des outils de santé mentale collective.
Ils rendent le flou visible, apaisent les tensions invisibles et créent du rythme, de la clarté et du lien.
Les trois leviers intérieurs
L’agilité devient profonde quand elle s’appuie sur trois leviers : la bonne distance, la responsabilité et le 1 % / 7 %.
La bonne distance, c’est savoir s’engager sans se dissoudre, donner sans s’épuiser.
La responsabilité, ce n’est pas “c’est ma faute”, c’est “j’ai une réponse possible”.
Et le 1 %, c’est la sagesse du petit pas : changer un mot, une respiration, un regard.
Un pour cent par jour, sept pour cent par semaine, et au bout d’un cycle, un nouveau soi.
Les objections et la zone de pouvoir
« Oui mais, mon manager ne comprend pas. »
« Oui mais, les RH ne suivent pas. »
« Oui mais, l’État est trop lent. »
Ces “oui mais” sont vrais, mais ils volent ta zone de pouvoir.
Tu ne peux pas tout changer, mais tu peux toujours agir quelque part.
L’agile commence là où tu es, dans ton espace d’influence, ton souffle, ton équipe.
L’agilité, c’est le refus d’attendre que le monde change pour commencer à respirer.
L’agilité comme hygiène de santé mentale
Les rituels agiles sont des rituels de soin collectif.
Le daily prévient le burn-out.
La rétrospective soigne la honte.
La revue de sprint rend justice.
Le backlog et le planning apaisent la confusion.
Le kanban réintroduit la clarté.
C’est de la psychologie appliquée, sans blouse blanche.
Et ça fonctionne, partout où les humains osent se parler vraiment.
L’agile face à la mort et à la maladie
La mort, la maladie, la perte, le deuil : ce sont les imprévus ultimes.
Et l’agile, c’est l’art de recommencer.
Il nous apprend à aimer ce qui change et à rester debout dans l’impermanence.
Quand un agent respire mieux…
Quand un agent respire mieux, l’État respire mieux.
Parce que l’État, c’est une somme de souffles humains.
Et quand un humain retrouve le sien, tout le système se réaligne un peu.
Et si… (horizon collectif)
Et si, demain, chaque ministère, chaque collectivité, chaque hôpital devenait un espace où l’on apprend à se parler comme des humains ?
Peut-être qu’alors, la République respirerait à nouveau — calmement, lucidement, ensemble.
Conclusion
L’agilité ne sert pas à aller plus vite. Elle sert à souffrir moins, à vivre mieux, et, le moment venu, à partir plus paisiblement.
Elle nous apprend à recommencer, à pardonner, à respirer.
Elle nous réconcilie avec la vie, dans son chaos et sa beauté.
Il n’y a pas de problèmes de travail : il y a des adultes fatigués, qui abritent des enfants blessés, et qui cherchent à se sentir en sécurité.
Notre rôle, à travers l’agile, c’est de leur redonner cette sécurité, ce lien, cette cohérence.
On ne souffre pas tant de la réalité que de la résistance qu’on lui oppose.
Chaque sprint, chaque souffle, chaque jour est une occasion de bouger d’un pour cent, ou de sept.
Parce qu’au fond, être agile, c’est apprendre à aimer la vie telle qu’elle est.
Et si, finalement, l’agilité n’était rien d’autre qu’un art de s’aimer un peu mieux, chaque jour, un pour cent à la fois ?
Respirez.
Bougez.
Parce qu'on est pas des arbres.
Ce que l’on transforme en soi, on le transforme dans le monde.
Jihane
Bonjour messieurs, comment ça va ?
Philippe
Très, très bien ce vendredi.
Jihane
Vous avez passé une bonne semaine ?
Philippe
On a passé une semaine fabuleuse, avec des gens fabuleux qu'on a croisés, rencontrés, écoutés encore ce matin. C’était hier. Gros sujet souveraineté numérique cette semaine, pour moi.
Jihane
Hier, on était au Booster Agile. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement tous les deux ? Après, je rappellerai les conditions de pourquoi on enregistre cette vidéo et ce qui s’est passé hier au Booster.
Philippe
OK. On commence par Kévin, le plus jeune.
Jihane
OK.
Kévin
Merci beaucoup pour cet honneur, Philippe. Salut, Jihane.
Moi, c’est Kévin. Je suis l’adjoint de Philippe au pôle Relations Usagers et Agents.
C’est un pôle qui opère des démarches numériques tournées vers les usagers et centrées sur la relation entre l’usager et l’administration.
On opère Démarches Simplifiées et Rendez-vous Service Public — donc vraiment des produits de relations usagers-agents.
Du coup, j’ai eu la chance de travailler avec Philippe ici présent.
Jihane
Depuis combien de temps ?
Kévin
J’ai commencé le 26 décembre 2024. Ça va faire bientôt un an. Le temps passe vite.
Jihane
Ça passe super vite. Merci, Kévin. Philippe ?
Philippe
Je suis responsable de ce pôle dans lequel on a les deux produits qu’a évoqués Kévin.
Je me prépare gentiment à partir un peu en retrait avant de partir à la retraite.
J’ai donc, en particulier, initié le projet Démarches Simplifiées il y a dix ans.
Déjà dix ans, exactement.
En septembre 2015, j’ai lancé Démarches Simplifiées avec un développeur, avec une seule commande :
« Fais-moi le Google Forms de l’État, et qu’il soit aussi un outil qui intègre le back-office de gestion et qui soit connecté à toutes nos API existantes. »
Ça tenait en une phrase.
Jihane
Tu nous raconteras tout le détail dans le podcast qu’on va enregistrer.
Démarches Simplifiées en chiffres, et Rendez-vous, ça donne quoi aujourd’hui ?
Philippe
Rendez-vous, je te laisse Kévin en parler.
Kévin
Rendez-vous Service Public est aujourd’hui en forte croissance.
C’est un produit qui a été d’abord proposé aux collectivités avant le service de l’État.
La DINUM est rentrée dedans très récemment.
En termes de nombre de rendez-vous, on propose presque 500 000 rendez-vous.
On a bientôt atteint les 500 000 rendez-vous par mois.
L’objectif, c’est d’atteindre un million de rendez-vous par mois assez rapidement l’année prochaine.
À côté de ça, on a 20 à 25 % des services de l’État qui, aujourd’hui, sont impliqués dans au moins une organisation active dans le produit.
Jihane
Il existe depuis combien de temps, Rendez-vous Service Public ? Vous l’avez lancé quand ?
Philippe
En 2018. Pour l’anecdote, c’est du développement en Ruby, la même techno que pour Démarches Simplifiées.
Une partie de l’équipe Démarches Simplifiées est partie en 2017-2018 pour aller développer ce qui s’appelait Lapins.
C’est parti d’une initiative d’une collectivité territoriale.
L’idée, maintenant, c’est d’en faire un produit qui a vocation à être utilisé par tout acteur public qui a besoin de prendre des rendez-vous avec des usagers.
Jihane
Ce qui est impressionnant, c’est que Lapins est né autour d’une formation Alpha, avec deux personnes du Pas-de-Calais — Alpha étant devenu le Booster Agile.
On voit qu’il y a un produit qui est né avec Alpha et qui fait aujourd’hui 500 000 rendez-vous par mois.
Sept ans après, ça fonctionne ! Finalement, les formations qu’on donne, ça marche.
Et l’ambition, ce serait ?
Kévin
Non, j’ai dit une bêtise, pardon. Ce n’est pas 500 000 du tout !
C’est 200 000 rendez-vous par mois, aujourd’hui, plutôt.
Jihane
Et l’ambition ?
Kévin
L’ambition, c’est un million de rendez-vous par mois.
Je ne sais pas pourquoi j’étais resté sur 500 000, je ne sais pas du tout pourquoi.
Philippe
500 000, c’est le chiffre de Démarches Simplifiées sur le mois de septembre.
Kévin
C’est pour ça que j’avais ce chiffre.
Jihane
Alors Philippe, les chiffres de Démarches Simplifiées, c’est 500 000 sur le mois de septembre – et globalement ?
Philippe
Pour l’instant, on est autour de 17 millions de dossiers déposés depuis le début.
On est à 40 000 démarches mises en ligne.
On en a fait 1 200 au mois de septembre.
On a 140 000 agents traitants en relais ; 20 000 quotidiennement sur l’application, qui font de l’instruction de dossiers.
On a plus de 1 000 formulaires connectés à des applications de back-office — c’est-à-dire que les données sont déposées dans Démarches Simplifiées, récupérées dans les back-offices sur lesquels il y a des traitements, et on remonte des informations vers les usagers côté front.
C’est dix ans de travail, avec une progression régulière d’une année sur l’autre.
L’an dernier, on était autour de 3,6 millions de dossiers ; cette année, on devrait être autour de 4,5 millions.
Pas de grosse explosion, et tant mieux : il fallait progresser en nombre, mais aussi dans tout ce qui touche à la sécurité, l’hébergement, l’accompagnement et la formation.
On est une toute petite équipe : 12 personnes, dont 6 développeurs et 3 personnes au support.
Le support, c’est 300 mails par jour, avec un taux de réponse de 92 % en moins de 24 heures.
Ça aussi, c’est l’ADN de l’équipe depuis le début.
Au départ, quand Démarches Simplifiées s’est lancé, il y avait un seul développeur qui a fait des trucs géniaux…
Mais quand la deuxième équipe est arrivée derrière – certains sont encore avec moi aujourd’hui – ils m’ont dit :
« C’est bien ce qu’il a fait, mais c’est que de la merde : il faut tout refaire, parce que ça ne tiendra jamais l’ambition qu’on peut avoir pour un produit de cette nature. »
Jihane
J’espère que le développeur ne regardera pas cette vidéo !
Philippe
Non, mais il le sait. Et il avait raison.
Ce qu’on avait besoin de montrer, quand on a créé le produit, c’était l’enjeu, tout de suite.
Dès fin 2015, on avait déjà un déploiement qui tournait ; mi-2016, on avait déjà deux acteurs en production.
Et c’est ça, l’esprit agile : on fait, on teste, on trouve deux premiers clients.
Et si je vous dis comment on les a trouvés : autour d’un bar !
J’étais dans une réunion, je testais l’appli. À côté de moi, une nana me dit :
« Mais c’est quoi l’appli que vous avez là ? »
Je lui dis : « Regardez, on fait le formulaire à la volée, puis on instructe ça. »
Elle me dit : « Mais ça, c’est génial pour la politique de la ville. À Calais, on aurait vachement besoin de ça. Est-ce que tu peux venir la semaine prochaine ? »
Je lui dis : « Attends, on va attendre que la réunion se termine quand même… »
Et on est allés la voir. La semaine suivante, on a rencontré le sous-préfet à Arras, et c’est comme ça qu’on a trouvé le premier client.
Ce n’était pas parfait, mais ça permettait d’avoir des gens qui saisissaient et traitaient des formulaires.
Ensuite, il a fallu passer à la phase production – ça, je vous en parlerai après.
Jihane
Pour raccrocher, on fera, je pense, le podcast en détail sur Démarches Simplifiées et Rendez-vous Service Public.
Juste pour raccrocher avec le Booster Agile qu’on a lancé hier, et où tu étais présent en partie dans l’amphi : on a voulu s’attarder hier après-midi sur la question du problème.
Damien a fait une intervention d’une demi-heure pour leur expliquer ce que c’est qu’un problème, à quel point on peut mesurer qu’il est majeur, réel et actionnable – donc : majeur, qui a un impact ; réel, ancré dans les faits ; et actionnable, sur lequel on peut agir.
Et juste rapidement : Rendez-vous et Démarches Simplifiées, en une ligne, le problème de base, de base, de base, c’était quoi ?
Philippe
Le point de départ, c’est les lapins : le nombre de rendez-vous non honorés.
Trente pour cent des rendez-vous pris – la personne ne venait pas.
Jihane
Trente pour cent ? Les gens ne viennent pas aux rendez-vous ? On n’avait pas le chiffre ?
Philippe
On ne l’avait pas à la base, mais l’idée, c’était : quand vous avez un lapin, des gens se mobilisent, et puis il n’y a personne. Ils perdent du temps.
Pour Démarches Simplifiées, c’est un peu différent : c’était plus conceptuel.
Seulement 15 % des démarches sont réellement dématérialisées en France, et on ne sait dématérialiser que les grosses procédures.
Or, la vie administrative, elle, est faite de plein de petits processus aujourd’hui non numérisés.
Il n’y a pas de possibilité d’avoir une relation immédiate entre un usager et un agent.
Quand on a créé Démarches Simplifiées, l’objectif, c’était de permettre à des usagers d’être mis en relation directe avec les agents qui traitent leur dossier.
C’était l’enjeu principal.
Et derrière tout ça, il y avait une idée : démocratiser la possibilité de dématérialiser des procédures administratives qui, jusque-là, se faisaient essentiellement par mail.
Jihane
Ok. Mais au départ, ce n’était pas dit comme ça ? En deux phrases, ce n’était pas aussi long ?
Philippe
Au départ, c’était : si vous voulez simplifier la vie des gens, commencez par numériser la relation.
Trouver un support numérique entre les usagers et les agents.
Jihane
Mardi, je t’ai demandé de m’aider à trouver un problème pour nos boostés, les participants du Booster Agile, à travailler l’après-midi.
On a croisé deux consignes :
la première, “vous avez compris ce que c’est qu’un problème, discutez-en et trouvez une solution.”
Et ils se sont vite rendu compte que c’était parti en dispersion : une réunion classique, frustrante.
Pendant une demi-heure, ils ont vécu ça. Dans toutes les salles, c’était le chaos.
La deuxième demi-heure, on leur a demandé de reformuler le problème et de proposer une piste d’action, avec trois rôles : facilitateur, rapporteur et gardien du temps.
Là, il y avait plus de cadre.
Enfin, la troisième demi-heure, chacun a pris un angle :
une salle “faits et données”, une “émotions et perceptions”, une “risques et opportunités”, une “idées et créativité”, une “organisation et pilotage”.
C’était assez intéressant.
Je ne vais pas te raconter le fond, parce que ce qui m’intéresse, c’est que vous, vous me racontiez cette histoire, puisque vous êtes en train de traiter ce problème – c’est vous qui m’avez donné ce problème.
En l’occurrence toi, Philippe : faciliter le déploiement de médecins dans les déserts médicaux sur la France, en novembre.
Et ce qui nous est revenu dans les salles, c’est assez parlant : dès le début, personne n’a reformulé le problème.
Quand on leur a dit “discutez librement”, ils ont cherché la solution.
Quand on leur a redemandé de reformuler, certains l’ont fait largement, d’autres se sont attardés sur chaque mot :
“Déploiement, c’est quoi ? Désert, c’est quoi ? Médical, c’est quoi ? France, c’est quoi ? Novembre, c’est demain ?”
Chaque salle était différente.
Ce qui en est ressorti de positif, c’est que certaines ont tout de suite demandé :
“quelles sont les failles de données ? combien ? quand ? à qui parler ?”
Une autre a choisi un petit secteur géographique.
Une autre encore s’est demandé : “qui sont les plus touchés ? les médecins ? les populations ? où sont les déserts médicaux ?”
C’était intéressant.
Mais ils sont allés tout de suite chercher la solution.
Et quand on leur a dit “une seule piste d’action”, on s’attendait à ce qu’ils s’attardent davantage sur le problème, qu’ils fassent une recherche sur l’existant, et qu’ils se disent : “la première action, c’est de parler avec des gens.”
Politiquement, quel médecin, quel patient ? Il faut enquêter.
Non : ils sont allés directement à la solution.
Et on a eu des propositions du type :
le Airbnb du médecin, Adopte un médecin, des plateformes, encore des plateformes.
Alors qu’on sait bien que la première piste d’action, c’est “à qui on parle”.
Et dans une salle, on m’a même dit : “Jihane, c’est quoi la solution ?”
Beaucoup de plateformes, pas de recherche sur l’existant.
Et dans les salles, on a observé des biais :
la salle “émotions” ne s’est pas attardée sur ses émotions autour du sujet,
personne n’a dit “quelle est ma distance personnelle avec ce sujet”.
Une seule personne a dit “je suis médecin”.
Les autres parlaient des gens “là-bas”.
La salle “risques et opportunités” a rempli des colonnes entières, avec des risques, des opportunités, des pistes d’action.
Et on a eu un moment très drôle : la salle “créativité” a fini par choisir sa piste d’action en jetant un stylo au milieu de la salle sur toutes les idées, en disant : “On prend celle-là.”
C’était fun.
Mais ce qui m’intéresse, c’est que vous racontiez : comment vous avez reçu cette commande ? Comment vous l’avez traitée ? Où vous en êtes ? Et ce que vous trouvez compliqué ou simple à faire.
Philippe
Moi, je voulais justement prendre un peu de temps sur : quelles sont les opportunités pour lancer les projets ?
Parce qu’en fait, selon la façon dont on lance un projet, ce n’est pas du tout pareil.
Il y a plusieurs manières d’initier un projet.
La première, c’est exactement ce que vous aviez hier : la commande.
Vous recevez une commande qui vous arrive, on ne sait pas trop d’où, on ne sait pas pourquoi elle est là, ni pourquoi c’est celle-là plutôt qu’une autre.
On est dans la commande.
J’ai déjà rencontré ça plusieurs fois dans ma carrière, et c’est un profil classique du fonctionnaire : il est recruté pour mettre en œuvre quelque chose qu’il n’a pas décidé.
Donc, il applique.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu me racontes, Jihane, c’est que les gens n’ont pas pris le temps de re-questionner la commande.
Jihane
Certains ont pris le temps, mais très peu, et ils n’avaient pas beaucoup de temps.
Philippe
Voilà. Premier cas classique : on a une commande, et on l’applique.
Je vais expliquer comment moi je m’y suis pris, parce que j’ai vécu ça.
Deuxième type de situation : vous êtes vous-même agent public, à l’initiative d’un truc qu’on ne vous a jamais demandé.
Ça, c’est particulier, j’en parlerai une autre fois, parce que c’est ce qui me caractérise le plus.
Mais revenons à la commande publique.
Je me souviens d’un exemple :
un président de la République, dans un discours, dit :
« Il serait bien que tous les Français disposent d’un compte personnalisé avec toutes leurs informations. »
Et la commande qui arrive, c’est : il faut créer un truc pour tous les Français, qui fasse je ne sais pas quoi, et qui réponde à je ne sais pas quel problème.
La première chose que j’ai faite, c’est :
quels sont les problèmes réels ? les irritants ? comment les factualiser ?
Qu’est-ce qui me touche, moi ? Qu’est-ce qui a de l’impact ?
Moi, je dis toujours : montre ce que tu as dans le ventre, pas ton nombril.
Qu’est-ce qui me touche dans le problème ? Comment je le vis ? Qu’est-ce que ça dit ?
Et ensuite, j’allais voir d’autres personnes pour voir si ça leur parlait aussi.
Créer une communauté de personnes concernées, pas des personas abstraits, des personnes vraies, autour de la table, capables de dire : “oui, ce problème est réel et mérite d’être investi.”
Parce que parfois, dans une commande, le vrai problème n’est pas celui qu’on croit.
Entre le problème perçu et la solution proposée, il y a un écart.
À un problème, il peut y avoir 25 000 manières de répondre.
Et quand la commande donne déjà la solution, c’est encore plus complexe.
Là, par exemple, on attendait de nous qu’il y ait des médecins dans les déserts médicaux.
Donc, la solution était déjà implicite.
Il fallait donc remonter au problème.
Et ce problème, il faut le percevoir à travers tous les acteurs du dispositif : les médecins, les patients, les élus, les ARS.
Et la première chose à faire, c’est de rassembler les gens autour de la table, plusieurs fois s’il faut.
Ce qu’on a fait hier, ce n’était pas de trouver une solution, c’était de poser une action :
créer un espace où suffisamment de gens puissent dire ensemble : “oui, ce problème existe vraiment.”
Et parmi les solutions, il y en aura peut-être une qui répondra à plusieurs besoins.
Mais il faut d’abord fédérer autour du problème.
Et parfois, il faut accepter que la solution, ce ne soit pas forcément “plus de médecins”.
Peut-être que ce n’est pas la présence d’un médecin une fois tous les quinze jours dans un village qui réglera le problème.
Ce temps de recul est difficile à prendre quand on a une commande politique, parce que ça veut dire : calmer le temps, calmer la pression.
Jihane
C’est exactement ce qu’on apprend aux conseillers en stratégie numérique au Campus : prendre le temps, ralentir les dégâts.
Philippe
Ce qui n’est pas évident, parce que là, vous avez une commande politique.
Kévin
Justement, c’est exactement la difficulté de cette commande.
On est totalement dans un cas d’usage d’agilité publique.
La commande, elle venait du cabinet du ministère de la Santé, avec la DINUM sollicitée pour exécuter.
Et la première difficulté, c’était le temps.
La seconde, c’était que les acteurs concernés étaient réfractaires, parce qu’on leur demandait de participer à une mesure imposée, même si elle répondait à un besoin réel.
Personne ne contestait le besoin : permettre à des usagers d’accéder à des soins dans les déserts médicaux.
Mais la mesure, elle, arrivait comme un cheveu sur la soupe.
Et surtout, elle ne répondait pas à un seul problème : il y avait des problèmes imbriqués.
D’abord, il fallait s’assurer que les médecins mobilisés avaient bien le droit d’exercer.
Ensuite, quel système d’information utiliser pour gérer tout ça ?
Et c’est là que Philippe a raison : on va trop vite vers une solution, et dans la pratique, ce n’est pas la bonne.
Dans ce cas, il y avait une pluralité de solutions possibles.
Les médecins nous ont proposé leur propre outil de garde : Ordigarde, utilisé par le Conseil de l’Ordre.
Ce n’est pas un mauvais outil, mais il n’était pas fait pour gérer des rendez-vous.
Notre rôle, à la DINUM, c’était de dire : architecturalement, structurellement, ce n’est pas la bonne réponse.
Plutôt que d’imposer un outil, on a mis les bonnes personnes autour de la table : tous les acteurs du circuit, de la demande de l’usager jusqu’à la prise du rendez-vous.
L’objectif, c’était un parcours sans couture, et une offre vraiment connectée à la demande.
Parce qu’au début, on avait les médecins prêts à se déplacer… mais pas encore les patients.
Jihane
C’est fou. Moi, j’ai quitté Limoges pour ça. Il y avait un désert médical là-bas : on avait les médecins connus, mais pas les patients.
Kévin
Exactement. Et pour vulgariser : quand on a reçu la commande, la première question, c’était : est-ce que nos produits peuvent servir ?
Ella, la cheffe de projet, a tout de suite pensé à Rendez-vous Service Public.
On en avait déjà parlé six mois avant. L’idée : créer une alternative à Doctolib pour les services publics.
Mais très vite, on s’est heurtés à des problèmes de systèmes d’information.
Et on a décidé de ne pas faire un outil spécial.
Philippe
Oui, c’est ça. Nous, on n’allait pas faire un outil juste pour ce cas-là.
Kévin
On nous a proposé de connecter Rendez-vous Service Public à Ordigarde via une API, sauf que ça n’avait pas de sens.
On a refusé : on a préféré que le ministère se connecte à notre API.
Et aujourd’hui, Ordigarde n’est même plus utilisé.
C’est le signe d’une agilité d’esprit collective : on a fait un outil structurellement agile.
À la DINUM, nos produits doivent avoir une forme d’élasticité, pour pouvoir s’adapter à plusieurs cas d’usage.
On ne répond jamais “oui” à une demande spécifique, si elle ne répond pas à un besoin plus large.
Donc concrètement, on a refusé de se connecter à Ordigarde,
mais on a accepté de renforcer notre API pour que le ministère puisse s’y brancher,
et que tout le système soit réutilisable : cartes des médecins, mises à jour, etc.
Jihane
Tu parlais tout à l’heure de médecins qui pouvaient peut-être ne pas avoir le droit d’exercer. Finalement, c’est un problème dans le problème : il faut vérifier ça aussi, non ?
Kévin
Absolument. Et ça, on y répond aujourd’hui avec une vérification directement sur la base d’une RPS — qui est demandée dans Démarches Simplifiées — avec un circuit habillé de tous les acteurs qui ont accès à cette donnée.
Ce n’est pas : « tu t’inscris et tu exerces ». Il y a des vérifications croisées.
Structurellement, on a déjà des connexions par API dans Démarches Simplifiées, on en a aussi du côté de Rendez-vous Service Public, et on a même intégré GRIS, un autre outil de la Suite numérique, dans le processus.
Jihane
Mais ça, vous n’auriez jamais pu le savoir si vous n’aviez pas mis les gens autour de la table pour qu’ils vous remontent tous les problèmes ? Votre première action, ça a été ça finalement : mettre les acteurs ensemble ?
Philippe
Concrètement, oui. La première action, ça a été ça.
C’est Célia – qui était à la manœuvre avec tous les acteurs du secteur de la santé – qui a piloté cette partie.
Nous, on était plutôt en proposition de solution.
Mais si on avait été impliqués dès le tout début, on aurait peut-être abordé le sujet autrement : non pas sous l’angle procédural, mais sous l’angle de la confiance.
C’est-à-dire : les médecins sont déjà reconnus à l’Assurance Maladie, ils ont déjà un numéro d’identification.
Pourquoi faudrait-il leur refaire déclarer qu’ils sont médecins ?
Mais on a découvert que l’ACNAM rattache chaque médecin à un lieu d’exercice.
S’il se déplace ailleurs, il doit refaire une procédure complémentaire.
Et ça, c’est typiquement une lourdeur administrative qui pourrait être évitée.
Si on était vraiment un pays agile, on dirait :
on fait confiance à un médecin habilité, même s’il consulte ailleurs.
Le maire du village pourrait simplement l’accueillir, et hop, il facture depuis ce lieu-là.
Là, au contraire, on a empilé des procédures pour couvrir un risque de fraude qui représente…
0,001 % des cas.
On a construit une usine à gaz pour une exception.
Le vrai sujet, ça aurait été de factualiser le risque, pas de le présumer.
Mais on est arrivés trop tard pour ça ; la machine était déjà lancée.
Et du côté des patients ? Le premier retour de l’expérimentation, c’est qu’il n’y avait pas de patients.
Jihane
Comment ça ? Il n’y a pas de patients dans les déserts médicaux ?
On cherche des médecins pour des endroits où il n’y a pas de patients ?
Philippe
Il y a le besoin, évidemment. Mais quand tu regardes, tu vois bien que le dispositif s’est monté sans vérifier si l’offre correspondait à la demande.
On est partis de l’hypothèse que mettre un médecin une fois tous les quinze jours dans un désert médical allait résoudre le problème.
Mais on n’a jamais vérifié si c’était la bonne réponse.
Kévin
Il y a eu une latence, au début.
Le médecin se déplaçait, mais il n’y avait pas encore de patients informés.
Et effectivement, ça arrivait : des médecins faisaient des kilomètres, arrivaient sur place… et personne ne venait.
C’est en train de s’estomper grâce à la communication locale.
Il faut expliquer, dire : “tel médecin sera là, tel jour.”
C’est un dispositif local avant d’être national ; il faut toucher les bonnes personnes.
Philippe
Exactement. Et quand tu vois ce qui se passe, tu réalises que tout est une question de temporalité.
Les gens ont besoin d’un médecin au moment où ils en ont besoin, pas quinze jours plus tard.
Et c’est là que le système montre ses limites.
Jihane
Donc, si je résume : il y a des patients, mais comme ils ne savent pas qu’il y a un médecin, il n’y a pas de patients.
Kévin
C’est exactement ça.
Au début, c’était flagrant, maintenant ça va mieux.
On a 43 médecins qui ont confirmé leur compte et pris des rendez-vous, et à peu près autant d’usagers.
Le dispositif commence à s’équilibrer.
Jihane
Mais vous n’avez pas traité toute la France ?
Kévin
Non, pas encore.
Il y a 151 zones géographiques définies par décret.
On est partis de ces zones, puis on a cherché les médecins, et la communication s’est faite en parallèle.
Jihane
Est-ce que tu peux découper les étapes, vraiment simplement ? Comme si je ne comprenais rien à ce que vous faites.
Kévin
Alors, nous, on accompagne surtout sur la partie numérique.
On ne gère pas tout le parcours, mais Ella, oui.
Elle, elle fait le lien avec l’ensemble des acteurs du ministère, des ARS, des collectivités.
Jihane
Donc elle s’arrête sur les zones, récupère les données… Est-ce qu’elle a aussi pris les spécialités de médecins ?
Kévin
Oui. Majoritairement des généralistes, mais aussi quelques spécialistes.
D’ailleurs, au début, quand on a conçu le formulaire d’appel à candidatures, on avait mis toutes les spécialités.
Et les médecins nous ont dit :
« Non, il n’y a que les généralistes. »
On a donc simplifié.
Jihane
C’est intéressant, parce qu’une des équipes du Booster avait trouvé exactement ça :
que les zones les plus touchées étaient celles des généralistes, et qu’il fallait commencer petit.
Mais du coup, est-ce qu’on peut vraiment généraliser sur toute la France d’ici novembre ?
Philippe
Je ne sais pas si on aura le temps de faire un vrai retour d’expérience, mais ce qui est clair, c’est qu’on aurait pu tester plusieurs modèles.
On avait 150 zones, on aurait pu expérimenter plusieurs approches, comparer les résultats, voir ce qui marche où.
Parce qu’un modèle qui fonctionne en zone urbaine ne fonctionnera pas en montagne.
Et pourtant, on a voulu un truc uniforme pour tout le monde.
C’est typiquement le cas d’un problème réel mal factualisé.
On a dit : “il faut agir vite”, mais sans avoir le temps de vérifier le fond.
Et tout ça, ça s’est joué pendant l’été.
Nous, on n’était pas prêts sur Rendez-vous Service Public.
On a dû intégrer Démarches Simplifiées dans la boucle.
Et franchement, ça a été un temps de tension énorme.
Ella s’est battue comme une lionne avec son équipe.
Et nous, on a été obligés de dire non à certaines demandes :
soit on utilise les produits existants, soit on ne pourra pas livrer à temps.
Et là, tu vois, on est dans de l’agilité outil, pas encore dans l’agilité profonde.
Parce qu’on ne sait même pas encore si les usagers, à la fin, vont dire :
“ce dispositif m’a aidé.”
Jihane
Donc aujourd’hui, vous avez 40 médecins, mais pas encore de matching réussi ?
Philippe
Si, un peu. Mais pour vraiment savoir si ça répond au besoin, il faudrait aller sur le terrain.
C’est ce qu’on appelle une approche Lean : prendre son bâton de pèlerin, descendre à Digne ou à Plougastel, et interroger les gens.
“Qu’est-ce que ça a changé pour vous ? Qu’est-ce que ça vous a apporté ?”
C’est ça, le vrai feedback.
Mais là, on est sur un projet hyper urgent, une commande pure et dure.
Les marges de manœuvre sont très réduites.
On a fait ce qu’on a pu, avec ce qu’on avait.
Et il faut le dire : aujourd’hui, il y a encore beaucoup de travail manuel derrière.
Les médecins déclarent leurs disponibilités dans Démarches Simplifiées,
et des agents les recopient à la main dans Rendez-vous Service Public.
Ça fonctionne parce qu’il y a des petites mains qui font tourner la machine.
C’est le cas typique d’un dispositif qu’on monte trop vite, sans avoir eu le temps de factualiser le problème, ni d’explorer plusieurs chemins possibles.
Jihane
Ce problème, il dure depuis longtemps. Au Booster 1, déjà, on avait eu une équipe qui s’en était occupée.
Pourquoi ça atterrit maintenant aussi rapidement, politiquement ?
Pourquoi aussi peu de temps ? Ça fait des années que ça dure, ce problème.
Philippe
Je pense que c’est le rapport qui est sorti en début d’année.
Et tout à coup, les élus ont dit : “Il faut faire quelque chose.”
Il y a eu la loi.
Et là, vous avez le cas typique : comment régler ce problème ?
Jihane
C’est ce que j’allais dire. C’est quoi votre conseil ? Si vous l’aviez eu dès le début ?
Philippe
Attends. Remontons.
Qu’est-ce qu’on aurait pu faire pour ne pas se retrouver dans cette situation-là ?
Je dirais qu’on aurait pu remonter un peu plus loin, et différemment.
Le problème, c’est la loi elle-même.
Normalement, il devrait y avoir un travail de préparation :
au moment où les études sortent, est-ce que le ministère de la Santé a le temps de se mobiliser, de réfléchir à des propositions de méthode ?
Encore une fois, ce qu’on a vu hier avec les équipes du Booster, c’est exactement ça :
il ne s’agit pas d’apporter une solution toute faite,
mais de factualiser un problème, pour identifier les pistes d’action qu’on peut expérimenter.
Et là, on n’est pas sûrs que ce qui marcherait à droite marcherait à gauche.
C’est pour ça qu’il aurait fallu laisser les territoires expérimenter.
Le souci, c’est quand une loi vient imposer la solution.
Et ce n’est pas notre rôle, à nous, de l’exécuter telle quelle sans recul.
Jihane
Et s’ils ne savent pas faire autrement ?
Philippe
C’est possible. Mais à une époque, on faisait des lois à l’expérimentation, tu te souviens ?
Jihane
Oui, il y en avait une, non ?
Philippe
Non, plusieurs. Et elles existent toujours.
D’ailleurs, c’est intéressant, parce que les préfets viennent de recevoir une circulaire du Premier ministre sortant,
leur donnant plus de compétences territoriales, y compris sur la santé.
Et c’est logique : il n’y a pas deux territoires pareils.
Ni en couverture médicale, ni en moyens, ni en organisation.
La santé, c’est un domaine hyper complexe.
Alors vouloir tout faire fonctionner de la même manière, partout, dans 150 territoires…
C’est un vœu pieux.
Et c’est un vrai problème de texte écrit comme solution.
Moi, je trouve ça dommage.
Jihane
Vous avez un peu figé, je crois que c’est ma connexion… Vous m’entendez ? Bon, je reviens.
Kévin
Je voulais rebondir là-dessus.
Les acteurs locaux, eux, ont eu un rôle clé dans la réussite ou non du dispositif.
Aujourd’hui, on est sur 5 lieux actifs sur les 151 prévus.
Le seul qui fonctionne vraiment bien, c’est à Gourin, dans le Morbihan.
Là-bas, ils ont une organisation fluide, des médecins réguliers, et surtout un relais médiatique fort :
l’ARS, Ouest-France, les collectivités… tout le monde a communiqué.
Et surtout, il y avait déjà un travail d’identification du désert médical en amont.
On est partis des besoins des usagers, pas d’une commande abstraite.
C’est ça, la clé : l’usager au centre.
Et d’ailleurs, je reconnais quelque chose : même nous, on peut tomber dans le travers inverse.
Quand on est trop technique, on se dit : “tiens, on pourrait faire ça, ce serait bien.”
Mais est-ce que quelqu’un en a vraiment besoin ?
C’est pour ça qu’il faut toujours revenir à l’usager, et à sa réalité.
Et travailler en équipe pluridisciplinaire : technique, terrain, communication, juridique.
C’est ça qui fait qu’un projet tient debout.
Jihane
C’est bien, tu fais exactement ce que je leur ai dit hier :
quand on sépare les gens par angle, ça ne marche pas.
Il faut qu’ils soient complémentaires :
penser aux émotions, aux faits, aux risques, à la créativité…
Et se demander : “moi, je regarde par quel prisme ?”
Je suis très idée, créativité, émotion ; j’essaye de me forcer à aller voir les faits et les données.
Et c’est pareil pour tout le monde.
Philippe
Oui. Et ça revient à un point clé de la démarche startup : comment on évalue l’impact ?
Quel problème veut-on régler ? Comment le factualiser ?
Quel est l’indicateur qui prouve qu’il y a un problème ?
Et surtout : comment on vérifie que l’action qu’on mène le réduit ?
C’est la base du pilotage de projet :
problème → indicateur → action → résultat → comparaison.
Mais dans la pratique, on oublie souvent de choisir le bon indicateur.
Parce que c’est difficile à définir.
Et selon la manière dont on le mesure, la lecture peut changer.
Jihane
Donne un exemple concret, peut-être sur Rendez-vous ou Démarches Simplifiées ?
Philippe
Sur Rendez-vous, on a deux types d’indicateurs.
Le premier, c’est le taux de rendez-vous non honorés : facile à suivre.
Et le deuxième, que j’ai introduit, c’est le coût du rendez-vous.
Parce que oui, un rendez-vous, ça coûte.
Quand je suis arrivé, un rendez-vous coûtait environ 1 euro.
C’est cher.
Donc, on s’est fixé un objectif implicite : réduire le coût, sans dégrader la qualité.
Pour Démarches Simplifiées, on a deux indicateurs principaux :
le délai de traitement et la satisfaction des usagers.
Et un troisième, un peu plus original : le nombre de tweets d’insultes.
Jihane
Ah oui, carrément ?
Philippe
Eh oui. Rien de pire qu’un tweet qui descend ton service en flèche.
Un bon indicateur, ça peut être ça aussi.
Et c’est pour ça qu’on a introduit la transparence :
dans chaque démarche, les usagers et les agents peuvent voir en temps réel les délais de traitement.
Ça a apaisé énormément de tensions.
Jihane
Oui, moi, en tant qu’usagère de Démarches Simplifiées, je le vois :
quand je réserve un lieu, je sais que la réponse est sous 48 heures.
Je ne me demande plus combien de temps ça va prendre.
Philippe
Exactement.
Et cette transparence-là, elle vient d’une crise.
Il y a quelques années, une association avait attaqué une préfecture, au motif que les étrangers étaient obligés de passer par Démarches Simplifiées.
Le Conseil d’État a dit : “on ne peut pas imposer le numérique sans alternative.”
On a pris contact avec eux, on a échangé, et ils nous ont dit :
“Ce n’est pas votre service le problème, c’est la manière dont la préfecture l’utilise.”
Alors on a décidé de rendre tout visible.
Nombre de dossiers déposés, en cours, traités, délais moyens.
C’est devenu un tableau de bord Lean, visible par tous.
Et ça a tout changé.
Et derrière, on a mesuré :
le coût du dossier est passé de 12 euros à 0,20 centime.
Jihane
Est-ce que vous allez calculer le coût d’une mise en relation médecin-patient ?
Philippe
Pas encore. On n’a pas d’indicateur clair pour ça.
Kévin
Oui, on est encore en expérimentation.
Les indicateurs viendront après.
Mais on récupère déjà des données : nombre d’invitations de médecins, nombre de comptes validés, nombre de rendez-vous par lieu…
Et on voit par exemple que Gourin en a 32, quand d’autres en ont moins de 5.
Ça nous permet déjà de comprendre où ça prend.
Jihane
Pour l’instant, on est donc sur du quanti : nombre de mises en relation, rapidité d’accès.
Mais on a encore des médecins sans patients – donc des pertes de chiffre d’affaires, du temps, de la fatigue.
Kévin
C’était vrai au début, beaucoup moins maintenant.
On a corrigé le parcours, amélioré la communication.
Et le processus, il évolue tous les jours.
On itère en permanence.
Jihane
Donc, vous réadaptez au fur et à mesure ?
Kévin
Oui, mais dans les limites de ce qui est possible.
On n’a pas changé l’organisation globale, on ajuste à la marge : les formulaires, les indicateurs, les acteurs intégrés.
Philippe
Moi, ce qui me gêne, c’est qu’on n’a pas renversé la table.
On n’a pas osé être vraiment créatif.
On est restés dans le risque et l’opportunité.
Pas dans l’idée et la créativité.
Jihane
Donc, vous êtes restés sur organisation et pilotage, un peu faits et données…
Philippe
Oui, exactement.
On a raisonné en bureaucratie.
Et pourtant, on aurait pu faire différemment.
C’est paradoxal : on a créé Démarches Simplifiées pour dé-bureaucratiser,
mais parfois, on reste dans nos travers.
Jihane
Et du coup, on a mis de côté la perception et les émotions.
On n’a pas pris en compte le vécu du médecin à qui on redemande cent fois les mêmes infos.
Alors, si quelqu’un devait revivre ce que vous avez vécu — recevoir une commande politique urgente — vos deux ou trois conseils concrets, ce seraient quoi ?
Philippe
C’est une posture très compliquée.
Franchement, j’ai toujours essayé d’éviter les chemins critiques des commandes politiques.
C’est fragile, dépendant d’un ministre, d’un cabinet…
Et parfois, la priorité change du jour au lendemain.
Donc, premier conseil : éviter la commande quand on peut.
Jihane
Comment ? En arrêt maladie ? (rires)
Philippe
Non, mais par exemple, ne pas accepter certains postes.
Ou alors, si tu l’acceptes, tu poses les conditions :
“Je veux du temps pour factualiser le problème.”
“Je veux rencontrer les gens concernés.”
Libérer du temps, détendre la temporalité, c’est essentiel.
Et s’entourer de partenaires qui partagent le problème, pas juste la solution.
Deuxième conseil : ne pas réduire trop vite le périmètre.
Souvent, pour livrer vite, on rabote, on fait petit…
Mais après, on reste bloqué.
Il faut garder une vision généralisable.
Regarde Rendez-vous Service Public : au départ, c’était fait pour les PMI.
On a élargi aux maisons de justice, aux collectivités…
C’est devenu un produit réutilisable.
Troisième conseil : ne pas développer trop vite.
Ne recrute pas de développeur avant de savoir ce que tu veux vraiment résoudre.
Sois pauvre. Fais avec ce que tu as.
Jihane
Il ne faut même pas “essayer” d’être pauvre, il faut l’être !
Philippe
Exactement. Fais avec ton frigo : trois bananes et un œuf ?
Fais une banane aux œufs !
Jihane
J’adore. Et toi, Kévin, tes trois conseils ?
Kévin
D’abord, partir du besoin de l’usager.
S’assurer que la commande correspond à un besoin réel.
Et si tu doutes, fais appel à des experts qui interrogent les usagers.
Ensuite, bien connaître l’essence de ton produit.
Savoir quand utiliser Démarches Simplifiées, GRIS ou Rendez-vous Service Public, selon la lourdeur du process.
Troisième conseil : connaître l’existant.
Savoir ce qui est déjà là, pour ne pas réinventer la roue.
Et si tu ne sais pas tout, entoure-toi.
Travaille en équipe pluridisciplinaire.
Et enfin, un quatrième, un peu plus personnel :
je préfère le mot “infuser” à “impacter”.
Quand tu fais infuser un thé, tu laisses le temps.
Si tu trempes ton sachet trop vite, ça éclabousse, c’est amer.
L’impact, c’est violent ; l’infusion, c’est durable.
Jihane
Magnifique image.
Mais finalement, ce que vous dites, ça vaut aussi pour le non-numérique.
C’est les mêmes règles : partir du réel, du besoin, du temps.
Philippe
Exactement.
Le seul moteur que je connais, c’est l’irritation.
Trouve ce qui t’irrite, et règle-le.
C’est valable pour tout : le numérique, l’administration, l’entrepreneuriat.
Un irritant, c’est un moteur.
C’est ce qui t’empêche de lâcher.
Et quand tu partages cet irritant avec d’autres, c’est là que la magie opère.
Jihane
Donc, même si on reçoit une commande, si elle touche un irritant réel, elle peut devenir moteur.
C’est exactement ce que tu dis.
Alors, on garde ça pour la suite : le prochain épisode, ce sera sur les irritants.
Merci messieurs, c’était passionnant.
Merci Philippe, merci Kévin, et merci à Fadila aussi, qui était à l’origine de ce projet.
On se retrouve pour la deuxième partie sur ton parcours, Philippe, et sur ta philosophie :
Protection, Puissance, Permission.
Kévin
Merci à toi, Jihane.
Philippe
Au revoir.
A venir
Jihane Herizi
Salut Damien, comment ça va ?
Damien Dufourd
Salut Jihane, ça va, ça va, je te remercie.
Jihane Herizi
Très contente d'être là avec toi ce matin.
Damien Dufourd
Moi aussi, merci d'avoir accepté cette invitation.
Jihane Herizi
On est mardi 18 novembre et on est sur l'épisode 7 du Coup de Boost Agile.
Et je suis très contente, je t'ai proposé il y a quelques semaines d'enregistrer avec moi sur ce que j'estime être deux sujets qui sont déjà très intéressants et qui font partie un peu de ton sac de Mary Poppins, de ton sac de magicien.
Je trouve que tu mènes très bien ces deux sujets.
Ça fait 6 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble chez Beta ?
Damien Dufourd
Oui, c'est ça, 2018 à peu près.
Jihane Herizi
2018, donc ça fait 7 ans qu'on se connaît et tu es arrivé un tout petit peu après moi.
Et moi, je t'ai vite identifié comme un des coachs seniors, en tout cas, avec lequel je matchais le plus sur la façon d'accompagner les équipes et de travailler chez Betagouv.
Et je t'ai envoyé plein de gens à chaque fois en mentorat : « Vous voulez devenir coach ? Allez bosser avec Damien, allez bosser avec Damien », et donc je t'ai vu évoluer et je sais que tu vas nous raconter un peu ton parcours.
Mais quand j'ai pensé à ces deux sujets, je me suis dit que c'était sûr que c'est toi qui devais intervenir.
Donc on précise évidemment, pour des questions de transparence, que Damien et moi sommes prestataires, nous ne sommes pas agents publics de la DINUM, on parle avec un regard de prestataire parce qu'on est des fervents défenseurs du service public et qu'on adore travailler dans ce milieu et qu'on avait envie d'enregistrer ensemble.
Donc il y a dans les précédents épisodes Fadila, Mélodie et Philippe qui sont agents, et on aura un agent pour l'épisode 9 également, mais nous sommes prestataires depuis 2017 et 2018 pour Damien, pour la direction interministérielle du numérique et Betagouv.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours depuis ton arrivée en 2018 chez Beta ?
Damien Dufourd
Yes.
Déjà, juste pour démarrer, aujourd'hui j'ai 41 ans et pour le coup je suis arrivé en 2017, avec surtout un gros bagage privé, avec tout ce que ça implique notamment en termes de méthode très tendue sur la performance et la productivité.
Donc quand je suis arrivé, ça a été un peu un choc.
À l'époque, c'est Pierre que j'avais rencontré qui m'avait un peu embarqué dans la découverte de la communauté, Pierre Péziard.
Et rapidement, je suis rentré en tant que coach au sein de la communauté pour accompagner une équipe autour des questions d'orientation et de formation professionnelle.
Ça a été ma première expérience.
À l'époque, on n'était pas très nombreux, tu disais « voilà, je suis peut-être l'un des coachs seniors », mais en fait c'était facile, il n'y en avait pas beaucoup.
J'ai eu la chance d'arriver à un moment où beaucoup de choses se construisaient au sein de la communauté, et notamment à peu près un an après que je suis arrivé, un petit peu moins, on avait initié, notamment avec d'autres personnes au sein de la communauté, la dynamique qui au fur et à mesure s'est transformée en logique d'investigation.
Donc aller explorer sur le terrain, regarder comment est-ce qu'on pouvait lancer des nouveaux services publics à l'ère du numérique, avec des agents et principalement auprès des collectivités territoriales.
Donc je suis pas mal intervenu au sein de différentes collectivités de toute taille, agglomération, département, région, pendant deux ans après que je suis arrivé.
Et en parallèle de ça, j'ai beaucoup gravité autour des sujets emploi, travail, formation professionnelle, donc là maintenant, au bout de sept ans, j'ai dû accompagner, que ce soit dans des phases plutôt d'exploration ou des phases de construction, à peu près une certaine… je pense que c’est certaines équipes qui sont vraiment passées à l'échelle sur des sujets comme la lutte contre le mal-logement ou l'accompagnement de la politique publique autour de l'apprentissage, des sujets autour de la justice, de l'ANSI.
Donc voilà, j'ai la chance vraiment, et c'est super, de pouvoir continuer à grandir au travers de cet écosystème au fur et à mesure qu’il se développe.
Jihane Herizi
Oui, quand je suis arrivée, on était 35.
Je pense que tu n’étais pas loin. On était moins d'une centaine.
Je me rappelle qu'on avait co-créé le programme de pré-incubation pour les collectivités.
Et c'est ça qui est intéressant pour moi : c'est qu'on parle beaucoup de l'État et je n'avais pas eu d'intervention jusqu'à présent de quelqu'un qui était plutôt côté collectivités, agglomérations.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas confirmer qu’en fait, c'est la même chose. Finalement, il se joue les mêmes choses en termes de management, en termes d'impact.
Et en même temps, il y a des différences que tu maîtrises puisque tu auras vu… entre la justice et une métropole ou une ville, ce n’est pas la même chose.
Et j'ai envie que tu fasses une petite dédicace peut-être aux produits avec lesquels tu as travaillé.
On peut parler d'Histologe, je pense, qui vient côté collectivité sur l'agglomération de Pau historiquement.
Damien Dufourd
Je suis pas mal intervenu sur l'accompagnement de la création de l'incubateur Justice au départ.
Et puis après, d'autres produits plutôt tournés vers les agents au sein du ministère, qui ont pu se développer plutôt dans une logique SI.
Il y a un sujet, c'est qu'on construit, notamment au sein de la communauté, la grande majorité des produits, et ça fait partie un peu des piliers, sont tournés vers les usagers.
Mais voilà, on a quand même aussi un certain nombre de produits qui visent à outiller, accompagner les agents dans leur travail.
Et de plus en plus, notamment, quand on pense le développement, on s'intéresse à des questions de transformation des modes de fonctionnement de l'administration.
Ça a toujours été ma conviction : je pense qu'on fait deux choses, notamment, que la communauté produit plusieurs choses.
La première, c'est des produits qui sont utiles et qui visent à avoir un impact national. On pourra revenir sur la question du pilotage par l'impact.
Et après, transformer le mode de fonctionnement, et ça rejoint nos sujets de management agile, mais de l'administration.
C’est : finalement, comment est-ce qu'on pense la création de valeur de demain, et en même temps qu'on réfléchit à la manière dont on exécute, dont on opère la création de valeur et de l'impact aujourd'hui.
Et arriver à trouver la bonne balance entre ces deux dimensions, je pense que ça fait partie des terrains sur lesquels on continue de travailler.
Jihane Herizi
Tu m'as fait une introduction parfaite, donc c'est les deux terrains qu'on va traiter sur ces deux épisodes.
Je te propose qu'on commence sur le deuxième, le management agile.
Moi, quand je t’ai connu, tu étais à ton compte en individuel.
J'ai vu une création de structure de ton côté qui est un peu spéciale, tu vas nous raconter comment ça se passe, mais il me semble que ça s'appelle WeValue.
Il y a quelque chose que tu as pris, j'imagine, de Betagouv, il y a des idées qui te sont venues de ce que tu as vu.
Il y a quelque chose aussi où tu as eu envie de te dire : est-ce que je ne pourrais pas faire un truc à côté, et en plus rajouter des choses que je pourrais ensuite ramener chez Beta ?
Moi j'ai eu cette impression de voir cette évolution, de ton côté, une espèce de pont, de vase qui se transvase de l'un à l'autre.
Tu nous racontes un peu ce que c'est que WeValue, et qu’est-ce que tu as compris de chez Beta que tu as pris chez WeValue, et qu’est-ce que tu as créé chez WeValue que tu ramènes chez Beta et que tu voudrais que les autres administrations puissent intégrer en termes de management notamment, et autres gouvernances et autres sujets que tu adores ?
Damien Dufourd
Yes.
Alors tu as raison de le souligner : il y a des ponts.
J'ai cette conviction qu'il y a des inspirations croisées gouvernance privée / gouvernance publique.
On se pose la question du régénératif aussi dans le monde de l'entreprise.
Donc on va au-delà de la pure dimension financière.
Moi, je pense que c'est un mouvement de fond, en tout cas que j'ai envie d'appuyer, de continuer de développer, et qui, si on le regarde avec un peu de recul, a plutôt tendance à s'inspirer justement de ce qui se fait historiquement côté secteur public.
On va penser l'intérêt général de ce qu'on produit, sans dire que l'entreprise est politique, mais finalement, aller s'intéresser à la question de ce qui est produit et des externalités à la fois positives et négatives côté entreprise, à mon avis.
C'est un pont qui est… c’est plutôt historiquement dans le giron de ce qu'on imaginait faire plutôt côté public.
Et à contrario, dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, dans lequel finalement c'est beaucoup plus compliqué de se projeter dans une vision d'administration, de plan d'exécution public long terme, parce qu'en fait tout bouge extrêmement vite — je ne reviens pas sur ce point-là particulièrement — mais en fait on est obligé d'aller s'inspirer de ce qui se fait plutôt bien côté privé, qui est la capacité à s'objectiver, à se mesurer, à arrêter les trucs qui ne fonctionnent pas, à relancer des nouveaux, à en accélérer certains.
Donc il y a une vraie porosité, je pense, qui se crée pour le coup entre ces deux mondes.
Et donc je le fais, parce que, comme je le disais, j'interviens des deux côtés, j'ai cette chance-là.
Et en même temps, parce que je pense qu'il y a aussi une question de cohérence, c'est-à-dire que c'est là où moi je mets moins cette barrière-là, Beta d'un côté ou WeValue de l'autre, privé, public : c'est moi qu'est ce qui m'anime.
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre, moi, de mes convictions, à quoi je crois, finalement, dans mes réalisations ?
Et ma conviction, c'est que ça infuse quelque part un peu dans ce que j'essaie de faire d'un côté comme de l'autre.
Évidemment, il y a des trucs qui vont se retrouver, ça va essayer, ça rime un peu, clairement.
Jihane Herizi
Alors, quelles sont tes convictions, côté management agile, et qu'est-ce que tu as récupéré – et je suis très contente de t'entendre dire ça, que le privé s'inspire aussi du secteur public – qu'est-ce que tu as récupéré du secteur public pour l'infuser côté privé, et qu'est-ce que tu fais côté privé, que tu aimerais infuser côté public ?
Qu'est-ce qui fonctionne, et qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné, et où tu t'es dit : ah oui, j'avais cette conviction, mais en fait, ça ne marche pas ?
Damien Dufourd
Ce qui est quand même l'apanage du privé, historiquement, c'est la question de la performance, de la gestion.
Tu as une culture forte de la redevabilité, qui d'ailleurs peut être toxique à certains moments, mais en gros, tu as des objectifs, tu as des résultats : soit ça marche, soit ça saute, et le marché est hyper dur par rapport à ça.
Demain, tu développes un produit, tu as passé des années à le développer, tu le sors sur le marché, le marché n'en veut pas, c'est fini, tu n’as plus de business, tu arrêtes tout.
Et tu ne peux pas aujourd'hui construire et développer une boîte si, à un moment donné, tu ne regardes pas dans les comptes si tu arrives à rentrer ou pas du cash.
Et ce truc-là, le privé le fait par structure, par nature en fait, ce qui est beaucoup plus complexe à partir du moment où on essaie de sortir de l'équation du cash côté public.
Donc ça, c'est des éléments, clairement, aujourd'hui, notamment – je te prends ce qu'on fait ensemble, ce qu'on a fait historiquement au sein de la communauté Betagouv – je pense qu’il y a une partie de ce qui est aujourd'hui poussé, notamment autour des méthodes Lean.
C’est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir imaginer faire différemment, il faut que tu crées un cadre managérial, de leadership, d'organisation du travail, qui te permette, qui t'autorise à faire autrement.
Et on va y revenir.
Et côté privé, pour le coup, ce qui fonctionne quand même hyper bien d'un point de vue public et qui est en train d'infuser de plus en plus, c'est notamment la question de la raison d'être, essayer d'avoir une vision un peu plus long terme, la question de la déontologie, de l'éthique.…
Donc ce rapport à la soutenabilité, à la fois économique mais aussi environnementale, sociétale, de ce qui est fait, pour le coup, est très intéressant, ça se développe de plus en plus, et j’ai été clairement inspiré par ce qui était historiquement dans le secteur public.
Jihane Herizi
Historiquement, est-ce que tu as le sentiment que ça appartenait au monde public ?
Est-ce que tu as le sentiment qu’on l’a perdu à un moment ? Est-ce que tu as le sentiment qu’on y revient ?
Où est-ce que tu penses qu’on en est ?
Damien Dufourd
Moi, je suis un peu autodidacte, pour le coup, du public, parce que comme je suis arrivée en 2017, j'avais une connaissance très pauvre de ce qui se passait dans l'administration, dans les politiques.
Donc, je vais avoir du mal à construire une vision vraiment argumentée de ce sujet-là.
Ce que je perçois d'un point de vue opérationnel, et c'est là où je trouve des points d'accroche dans ce que je fais, c'est la question de la temporalité.
Aujourd'hui, on a une temporalité qui s'accélère, on a une temporalité politique qui va très vite, des mandats qui sont courts, des gouvernements qui se succèdent, indépendamment de la situation présente.
Mais globalement, tout va quand même très, très vite.
Et moi, ce que je perçois – mais c'est probablement juste à mon niveau, je n’ai pas la prétention de le voir globalement – c'est qu'on a un temps d'administration qui se cale de plus en plus sur le temps politique.
Plus de difficultés à penser long terme, à se projeter.
Ça, c'est un premier élément.
Et deux, on a, je pense, de manière générale, une machine, une belle machine administrative qui a su – qui sait probablement encore – assez bien exécuter à l'échelle des politiques publiques de manière robuste, fiable, sécurisée.
Et en même temps, le corollaire de ça, c'est que c'est difficile à bouger.
C'est difficile à bouger par la structure – l'administration crée de l'administration – mais c'est difficile à bouger aussi, pourquoi ?
Parce qu’en fait, ça nécessite d'être blindé, d'être sécurisé, d'être extrêmement robuste.
Et donc, à l'intérieur de ça, comment tu crées des espaces dans lesquels tu t'autorises finalement à faire différemment, à changer certaines règles, à bouger ces gros blocs, peut-être par petits bouts d'ailleurs, probablement plus par petits bouts que par grands blocs ?
Voilà.
Et donc ça, je pense que c'est des facteurs aujourd'hui qui invitent à déployer, développer plus d'approches telles qu'elles sont poussées au sein de Beta, mais pas que, il y a quand même aujourd'hui une réflexion assez large.
Je le vois notamment dans d'autres accompagnements qu'on fait.
We just talking to put more approach products, how to question the utility of what we do, how to measure a little more, how to cast the silos managerial, how to give sense the work of agents, how to approach the finalities.
Jihane Herizi
All these questions are posed.
I would like to start on this question of cassing the silos managerial, which is the theme of our podcast.
On va parler de l’impact et du sens dans la deuxième partie.
On a une tendance, certaines personnes ont une tendance à opposer cette question du chef qui doit prendre des décisions.
« C’est important que le chef décide, c’est important qu’il tranche. »
Philippe nous racontait un peu l’inverse dans les épisodes précédents, en expliquant comment Démarches Simplifiées, Rendez-vous Service Public et tout ce qu’il a créé ont fonctionné grâce à une forme d’horizontalité et une forme de « tribu » initiale, où on prend des décisions ensemble, même s’il y a toujours un peu de leadership, mais il est partagé.
Chacun a un peu sa place, chacun a ses compétences, chacun a sa vision, et en fait tout se vaut.
Et c'est inutile d'avoir quelqu'un qui vient dire « ça va se passer comme ça », « je prends les décisions », « je te corrige ».
Tu parlais de redevabilité toxique.
Moi je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à la confiance et à l'horizontalité.
J'ai l'impression que je te vois hocher de la tête, j'ai l'impression qu'on est assez d'accord là-dessus, j'ai l'impression que c'est ce que tu as continué de créer en tant que coach chez Beta et c'est ce que tu as amené chez WeValue en termes de gouvernance partagée.
Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu aides les administrations et les projets à casser les silos ?
Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ne veulent pas de ça et qui veulent toujours jouer au petit chef ou à la petite cheffe, pour corriger, recevoir les informations avant tout le monde, décider, garder cette position d'autorité, et qui en parlent comme étant quelque chose qu’on ne doit pas enlever dans l'innovation d'aujourd'hui ?
Qu'est-ce que tu en penses ?
Damien Dufourd
Alors, c'est hyper large comme question. Oui, tu as la place de prendre un des bouts de la phrase.
Sur la question de la distribution de l'autorité, la distribution du pouvoir, notamment sur les modalités de gouvernance partagée, moi je crois beaucoup qu'une grande partie des métiers aujourd'hui qu'on est amenés à pouvoir faire sont des métiers qui nécessitent ou qui touchent à une forme importante de créativité.
Et donc, à ce titre-là, ça reste important d'arriver à proposer un cadre de travail qui permet justement à chacun de pouvoir s'exprimer, aux organisations d'arriver à être plurielles, de créer l'espace finalement de sécurité psychologique qui fait que chacun peut mettre de soi, un peu de ses convictions, dans ce qu'il fait.
Pour pouvoir finalement arriver, à la fois qualitativement et quantitativement, à des propositions qui vont au-delà de ce qui est capable de construire le silo historique.
Et ça, ça marche privé comme public, pour le voir des deux côtés. Ce qu'on évoque là sur la question des silos et des organisations, ça existe vraiment des deux côtés.
Le problème auquel finalement ces éléments viennent répondre, c'est la question de la centralité de la prise de décision, des goulots d'étranglement que ça peut créer, des chapelles de pouvoir, des ego qui viennent freiner finalement l'agilité, la capacité d'écoute et la capacité d'adaptation des organisations.
Et ça, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Néanmoins, on le voit, il y a cette accélération constante qui est en train d s'opérer, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue environnemental.
On voit que tout va quand même extrêmement vite. Aujourd'hui, le facteur numéro un de survie des organisations, ce n’est plus le fait d'être performant à un instant T, mais vraiment de développer cette capacité d'écoute, d'adaptation, cette robustesse qui va te permettre, pour le coup, de continuer de créer de la valeur demain.
Et donc, à ce titre-là, tu as besoin de développer cette capacité-là.
Et cette capacité, tu ne peux pas la développer si tu restes enfermé dans des silos, dans des logiques de penseur / faiseur, de personnes qui décident sans être connectées au terrain, parce que c'est de là que viennent à la fois les idées, mais aussi c'est de là que sont perçus les problèmes.
Si tu n’es pas connecté à la réalité du terrain, c'est hyper compliqué derrière de pouvoir penser stratégie.
Une de mes croyances, c'est qu'il y a un peu ce mythe de la stratégie qui vient dire qu'on peut penser finalement la stratégie de l'organisation, et puis après, parce qu’on l'a pensée et qu’on l’a écrite, c’est bon, c'est comme ça que ça va se passer.
Moi, ma conviction, c'est qu’en fait la stratégie d'une organisation se lit dans ce qui se passe, dans les actes, dans les comportements, dans les actions qui sont prises.
Tu as beau dire « en gros je veux aller à gauche », si in fine toute ta boîte, toute ton organisation, toute ton administration, elle tourne à droite, en fait ta stratégie, c'est que tu es en train de tourner à droite.
Et donc, de plus en plus, dans notre contexte actuel, l'action, moi, de ma fenêtre, prime sur la stratégie.
Et ça, c'est un truc, à l'occasion, on pourra en reparler. Moi je le trouve hyper intéressant, il est développé notamment au travers du principe de l'effectuation, qui est un des courants méthodologiques qui m'a pas mal alimenté ces dernières années.
J'ai un peu ouvert le cadre.
Jihane Herizi
Non, c'est très bien, tu réponds largement à ma question.
Le sujet de l'effectuation, je crois que tu étais là à l'intervention de Thomas Houy, H-O-U-Y, qui est intervenu sur le booster agile et qui parle beaucoup de ce sujet.
Il y a d'ailleurs un MOOC qu'on a mis en note, je crois, du premier ou du deuxième épisode, et qui vraiment… ça rejoint le Lean, quelque part, ce que tu disais tout à l'heure, L-E-A-N, c'est les mêmes sujets : c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a dans le frigo pour faire à dîner ce soir ?
Damien Dufourd
Exactement.
Il y a une métaphore qui est assez simple pour comprendre l'effectuation, c'est : globalement, tu veux faire des frites.
Dans la pensée causale, en fait, tu as besoin de pommes de terre pour pouvoir faire des frites.
Dans la pensée effectuale, tu as des pommes de terre : qu'est-ce que tu peux en faire ?
Donc oui, tu peux faire des frites, mais tu peux aussi faire de la purée, tu peux faire un parafoudre.
Il y a plein de trucs que tu peux faire avec tes pommes de terre, tu peux faire des tampons encreurs.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de partir de ce que tu as, et puis de te mettre en action pour arriver à produire des résultats avec ces éléments-là, et puis après, ça crée des nouveaux contextes sur lesquels tu vas pouvoir itérer.
Et le fond de la pensée, c'est de dire que finalement, les ressources à disposition et l'action vont primer sur la pensée stratégique.
Ça n’efface pas complètement la pensée causale, mais il y a cet enjeu de dire qu’on ne pourra travailler qu’avec ce qu’on a à disposition et que ce n’est qu’en se mettant en action que les contextes vont évoluer.
Jihane Herizi
Pour rejoindre un peu ce qui se passe en psychologie, donc là c'est un peu le courant freudien et adlérien, tu vois, en psycho, quand on va, dans la psychologie du travail, chercher ce qui s'est passé, pourquoi on fait ce qu'on fait, on est dans la pensée causale : on n'avance pas.
« Bah en fait, moi, il se passe ça au travail parce qu’avant il s'est passé ça et c'est la cause de… »
Et le courant adlérien parle de la téléologie, qui est justement : à quoi ce comportement, cette action, ce qui se passe aujourd'hui sert ?
À quoi ça sert en fait dans l'équipe ?
À quoi ça sert entre les deux personnes ? Qu'est-ce que ça protège ? etc.
Et c'est là où en fait on avance beaucoup plus vite, en arrêtant de penser aux causes et à la stratégie, en se mettant dans le temps présent et en se demandant : « à quoi me sert ce comportement aujourd'hui ? »
Et on est complètement d'accord sur ce qu'on dit.
Et là je sais que plein de gens vont nous écouter en disant : « Ah, je retrouve du sens dans ce que je fais, je retrouve de l'espace, je retrouve de la possibilité d'agir. »
Et puis après, il pourrait y avoir aussi la question du manager. On tape quand même beaucoup aussi sur le manager au sens hiérarchique du terme.
Damien Dufourd
Maintenant, c'est tout un système.
Au niveau de la personne qui manage une équipe, finalement, c'est quoi les différentes casquettes que tu as ?
Je pense qu'il y a un amalgame qui est assez courant, qu'on fait et qui est structurel aux organisations, c'est qu'on conjugue le management et la hiérarchie, donc la centralisation de l'autorité et du pouvoir.
Ce qui sont deux trucs qui peuvent être vus assez séparément, notamment quand on parle de gouvernance partagée, on essaye de découpler un peu ça en se disant : d'un côté, on peut avoir du management.
Ce n’est pas parce qu'il n'y a pas de manager qu'il n'y a pas de management.
Il faut continuer d'accompagner, de se fixer des objectifs, d'aller mesurer ce qu’on fait, d'animer le travail des équipes.
Par contre, on n’est pas forcément obligé de créer des autorités qui viennent centraliser le pouvoir au sein des organisations pour pouvoir faire du management.
Donc, le premier réflexe, je dirais, c'est de commencer à concevoir le fait que ce qu'on met derrière le mot “management” aujourd'hui révèle différentes réalités, différents outils, différents process, différentes postures, différents postes, différents rôles au sein de l'organisation.
Et à partir du moment où tu commences à l'ouvrir comme ça, en fait tu crées de la modularité organisationnelle.
Notamment, pour y revenir, un truc auquel je crois fondamentalement, c'est la question de la transparence comme vecteur de confiance dans l'organisation.
Et donc, plus tu vas ouvrir, plus tu vas casser ces gros blocs organisationnels, méthodologiques, ces gros postes, plus tu vas pouvoir créer des objets qui vont être distribuables dans l'organisation, et plus ils sont distribués, plus chaque personne au sein de l'organisation va pouvoir s'en emparer pour faire quelque chose de différent avec.
Jihane Herizi
Tu peux me raconter concrètement ?
Est-ce que vous avez eu un cas comme ça d'accompagnement, où vous avez cassé ces silos, où vous avez créé… alors je sais que chez WeValue, vous avez cette gouvernance partagée. Comment ça fonctionne, et comment tu fais toi en tant que chef d'entreprise dans ton ego avec tes associés ?
Non mais c'est vraiment ça.
J'estime que les réunions, c'est un endroit où on vient… ce n’est pas là où se prennent les décisions, c'est là où on voit les egos sur la table.
Comment vous avez fait, vous ? Comment tu fais avec l'administration ?
Est-ce qu'il y a un cas particulier que vous avez réussi à accompagner, où vous avez réussi à dire : « Voilà toutes les casquettes managériales qui existent, voilà comment vous pouvez fonctionner, voilà comment… »
Enfin, comment ça se passe vraiment concrètement ?
Damien Dufourd
Oui. Alors pour te répondre, je peux parler un tout petit peu de WeValue.
Donc en gros, il y a quelques années, avec un de mes anciens amis… merci… On a monté une structure qui s'appelle WeValue, qui est un cabinet de conseil en transformation technologique et organisationnelle, avec pour mission de révéler le potentiel des organisations pour conjuguer performance et responsabilité.
Donc on est arrivé vraiment avec cette idée de se dire qu'on peut accompagner à la fois culturellement et technologiquement, et aussi notamment à l'aune des questions de soutenabilité, les organisations à à la fois opérer et exécuter sur la création de valeur aujourd'hui, et en même temps à penser la manière dont elles créeront de la valeur demain.
À ce titre-là, on est partis avec deux principes hyper forts.
Le premier, c'est de dire qu'on est dans un monde créatif, on a besoin de la force, de l'intelligence, des convictions de chacun de nos consultants dans l'organisation.
Et à ce titre-là, au-delà du projet humaniste auquel on croit vraiment – se dire que c'est important que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il fait – ça représente aussi un enjeu de performance de ce qu'on produit, parce qu'on croit sincèrement que ça ne sert à rien d'infantiliser les personnes qu'on a dans l'organisation, et qu'on gagnera plutôt à libérer leur potentiel pour pouvoir permettre d'arriver à créer de la valeur pour les organisations qu'on accompagne.
Il y a, à ce titre-là, deux principes :
- un premier principe qui est la distribution de l'autorité, donc les enjeux de gouvernance partagée ;
- et un deuxième principe qui est la distribution de la valeur ajoutée, où, en gros, on se dit qu'on fait corps, on est un collectif, on décide ensemble et on gagne ensemble.
Et quand on gagne, on distribue ensemble.
Donc ça, c'est vraiment la manière dont on a pensé et conçu opérationnellement le cabinet.
Maintenant, de manière très concrète, pour l’imager notamment, on a une politique de transparence totale de tout ce qui se fait au sein de l'organisation, notamment sur les questions salariales, par exemple.
Tout le monde connaît le salaire de tout le monde.
Tout le monde connaît les contributions de chaque personne au sein de l'organisation.
On a une forte culture de l'écrit.
Et à ce titre-là, tout le monde est en capacité, à un moment donné, de se dire : « Bon, je sais où j’en suis en termes de performance, je sais où j’en suis en termes de rémunération », et par exemple – je te prends ce cas-là parce que c'est un sujet qui nous a occupés pas mal et qui continue de nous occuper – « j’aimerais être augmenté. »
On rentre dans un sujet assez concret.
Au début, quand on a créé WeValue, on est partis avec un principe sur ces questions de politique salariale, outillées de la transparence, de dire : n'importe qui, n'importe quand, au sein de l'organisation, peut lever la main et dire « moi, j'ai envie d'être augmenté ».
« J'ai envie d'être augmenté parce qu’il y a plein de trucs. »
Et notamment ce « parce qu’il y a plein de trucs », c'était à l'époque un peu processé : on disait « il faut arriver en expliquant, en justifiant pourquoi, par rapport à tes contributions et aux perspectives, tu penses que c'est normal, légitime, de recevoir une augmentation, et à quel niveau. »
Et donc il y avait un comité qui se montait, ouvert à tout le monde, et chaque personne pouvait se joindre à la conversation et in fine voter, pour dire oui ou non, on acceptait ça.
Ce qui s'est passé, c'est qu’il n’y a quasiment personne qui a demandé.
C’est incroyable.
Ah oui, c’est la limite : quand tu mets ce cadre-là, il n'y a personne qui ose.
En fait, ça fait partie des éléments qui sont un peu… il y a la question de « en fait, je n’ai pas envie de montrer que je veux plus que les autres », etc.
Mais si on prend un peu de recul, il y a un vrai sujet qui est la pression sociale du collectif.
C'est beaucoup plus simple d'aller toquer à la porte de ton boss et de lui dire : « Tu vois, cette année, j’ai tout cartonné, fais-moi une augmentation, sinon je me barre » ou « sinon tu verras ce que tu verras », versus venir devant le collectif et dire : « Aujourd'hui, je pense que je mérite d'être augmenté ».
Donc ça ne marchait pas.
Notamment sur certains profils – je ne dis pas que personne ne l’a fait, mais très peu de personnes l’ont fait – et c'était très compliqué, en particulier pour les profils plus introvertis.
Et donc ce qu'on a fait, c'est que dans ce genre de gouvernance, on a décidé de décider collectivement comment on faisait.
Et donc on s'est assis autour de la table, sur la politique de rémunération, et on s'est dit : il va falloir qu'on trouve une solution.
Co-construction des règles, en ligne avec nos principes, avec nos valeurs, avec notre manière de fonctionner.
Là, il y a un truc qui ne marche pas : on ne veut pas qu’il soit impossible de rétribuer les personnes qui le justifient.
Comment on fait ?
Et donc là, il y a eu un processus qui s'est mis en mouvement.
Notamment, on a mis en place une logique de « demande de changement » : n'importe qui peut lever la main, et là, pour le coup, les personnes s'en emparent au sein de l'organisation pour changer notre mode de fonctionnement, en tout cas pour le faire évoluer.
Et à ce titre-là, il y a eu un process d'évolution de notre politique de rémunération qui a été co-construit.
Alors, j’y ai contribué, tout simplement.
Moi, j'ai contribué aussi, au même titre que toutes les autres personnes de l'organisation, sur ce sujet-là, mais pas avec une autorité plus particulière.
C’est-à-dire que j'avais mes convictions, j'avais mes idées ; certaines ont été retenues, d'autres non.
Et in fine, on a atterri sur un dispositif qui, aujourd'hui, en transparence, tous les six mois, vient permettre à chacun, dans une logique de transparence, de pouvoir faire un état des lieux de ce qui a été, pour le coup, ses contributions au sein de l'organisation, la captation, pour le coup, de valeur aussi, notamment salariale, par rapport à cette période-là, de pouvoir faire un peu ces ratios-là, et de les avoir partagés avec tout le monde.
Et, globalement, de pouvoir se baser sur ces éléments-là pour ajuster, dans une politique de rémunération, de manière ouverte, sans forcément une autorité hiérarchique, managériale, qui dit « c'est comme ça qu’on va faire ».
Jihane Herizi
Oui, bon là ça marche pas parce qu'on parle d'administration et qu'on a des grilles – enfin, ils ont des grilles – on est prestas, mais il y a des grilles de rémunération, les congés, enfin tu vois, tout est un peu coincé, donc quelqu'un qui t'écoute va se dire : « Ok super, en fait nous on peut pas faire ça. »
Est-ce que tu as un autre exemple qui pourrait fonctionner dans l'administration, que vous avez mis en place, ou que vous avez mis en place dans une administration, de gouvernance partagée autre que la rémunération ?
Damien Dufourd
Bah typiquement, dans les inspirations que tu évoquais tout à l'heure, moi quand on est arrivé à peu près ensemble à Beta, on avait – je ne sais pas si tu te souviens – les séminaires.
Jihane Herizi
Oui, les petits, les grands.
Damien Dufourd
Les petits séminaires.
Et dans les petits séminaires, notamment, on avait un espace de gouvernance dans lequel on balayait les sujets et on prenait collectivement des décisions dans une logique de consentement.
Alors ça, c'est hyper intéressant, notamment d'un point de vue managérial.
C’est la distinction entre le consensus et le consentement, notamment, ou la décision autocratique managériale.
Mais si on prend, par exemple, la question du consensus, c'est : tout le monde est d'accord.
On est tous d'accord pour avancer dans cette direction, voilà.
Si on prend la question du consentement, c'est : tout le monde peut vivre avec la décision qui a été prise.
Alors, ce n'est pas forcément la décision que toi tu aurais prise.
Mais en vrai, tu arrives à vivre avec. C'est OK.
Tu peux avancer comme ça. Tu considères que ça ne va pas significativement poser un risque majeur sur l'organisation ou sur le mode de fonctionnement.
Et toi, en l'occurrence, ça te va d'avancer, même si ce n'est pas le choix que tu aurais fait.
Philippe disait : « On discute. On prend des décisions, et s'il n’y a pas de veto, on avance. »
En gros, c’est ce qu’on faisait dans l'expérience Beta, c’est un peu l’esprit des vetos.
Alors, c'est là où la question, c'est : comment est-ce que tu définis ce que tu mets derrière le sujet des vetos ?
Moi, j'aime bien dire : est-ce que je peux vivre avec ?
Parce qu’en fait tu pourrais très bien mettre un veto, mais il faut faire attention : il y a ce qui est de l’ordre de la préférence – en gros, qu'est-ce que toi tu préférerais faire – versus qu'est-ce qui te semble vraiment insupportable ?
Et ce n'est pas parce que tu préférerais faire autre chose que c'est une raison de bloquer.
Et donc ça, typiquement, on avait un espace côté Beta qu'on a repris, notamment côté WeValue, qui était cet espace de décision par consentement, où toutes les…
Jihane Herizi
C'était tous les mercredis après-midi.
Damien Dufourd
Un mercredi sur deux, je crois, de mémoire.
Jihane Herizi
Un mercredi sur deux, tu as raison.
Au début, c'était le jeudi, après mercredi.
On avait, je crois, une heure et demie ou deux heures, on prenait une salle en open space, on avait un paperboard, on avait quelqu'un qui tenait le temps, et on avait des post-its où on mettait des sujets, et quelqu'un qui tenait le paperboard, qui passait les sujets, et on avait, je crois, trois minutes par sujet.
Et si on voulait remettre du temps, on votait pour remettre du temps, pour continuer le sujet, jusqu'à ce qu'il s'épuise et que tout le monde dise « on passe au sujet suivant ».
Et donc veto / pas veto, mais du coup « est-ce que je peux vivre avec ou pas ? », et on prenait des décisions comme ça, collectives, avec la hiérarchie qui était là – Pierre, Yves, Ella et compagnie, tu vois – et on était tous… tout le monde avait une voix un peu égalitaire.
Jihane Herizi
Enfin, après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est une lecture aussi de ces types d'organisations, c'est que tu peux te retrouver à troquer l'autorité hiérarchique contre une forme d'autorité d'influence.
Donc tout n'est pas rose non plus, il faut regarder aussi la manière dont les choses se mettent en ligne dans l'organisation.
Mais c'est pas parce que tout le monde a la même voix qu’in fine la voix de tout le monde porte de la même manière.
Damien Dufourd
C’est vrai, il y a des critères de pondération, on l'a vécu, on est arrivés, c'était comme ça.
Jihane Herizi
C'est pour ça que ça fait huit ans que j'y suis, mais c'était assez impressionnant de voir que c'était possible, que ça fonctionne même en très grande équipe, puisque le grand séminaire qui avait lieu tous les 6 mois, à la campagne, où on était une centaine de personnes, c'était pareil : c'était un forum auto-organisé où on arrivait sans sujet, et on mettait les sujets sur la place, et puis il y avait le timing, il y avait les salles, et donc tout était vraiment très auto-organisé.
Tout ça, ça a été créé par des personnes qui ont cette culture et qui l'ont importée et apportée.
Si on arrive aujourd'hui dans une administration, une organisation où ça n'est pas le cas, ou dans une équipe où ça n’est pas le cas et où il y a quelqu'un de très autoritaire, comment tu expliques cette volonté d'être justement autocratique ou de garder le pouvoir ou de rester dans la stratégie, et de ne pas… ?
Damien Dufourd
Merci.
On a un peu les deux.
Alors, c'est rarement les gens qui sont plus réfractaires qui viennent nous voir et qui nous disent « aidez-moi à faire ce que je n’ai pas envie de faire ».
Tu peux avoir des mouvements, enfin tu peux avoir, à un moment donné, pour des questions de rupture – on en parlait tout à l'heure sur la question de la capacité d'adaptation des organisations, sur la perte de sens au travail, des sujets RH.
Tu vois, typiquement, nous – je le prends pas mal côté privé – mais beaucoup des sujets sur lesquels on est questionnés vont être des sujets qui vont tourner autour de la dynamique des équipes et de la coopération et de la question notamment du leadership et du sens des équipes et du bien-être des équipes.
Donc, à ce titre-là, ce sont des questions RH, et aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué…
C’est arrivé à la fois d’attirer et de fidéliser les talents au sein de cette organisation, et donc le management devient un vrai vecteur, pour le coup, de performance.
Et un manager toxique, qui n’est pas capable d'attirer et de fidéliser les talents au sein de son équipe, ça devient un problème de performance pour la boîte.
Jihane Herizi
Ou l'administration.
Damien Dufourd
Ou l'administration.
Il y a ces ponts qui se créent.
Maintenant, pour revenir, je pense qu'on est biberonnés quand même – c'était mon cas – à cette culture du management, de la hiérarchie.
Notamment, je parle avec le prisme français, mais on est un peu forcés à devenir manager.
C’est-à-dire que quelqu'un qui a la possibilité d'évoluer au sein d'une organisation, le parcours royal, classique, ce n’est pas le développement de ton expertise dans ton coin.
Non, c'est de monter en manager, avec une équipe de plus en plus grosse, et toute la logique de valorisation et de compensation qui est mise en œuvre tourne autour de ça.
Les gens les mieux payés, c'est des gens qui ont les plus grosses équipes.
Et donc on a un système qui pousse vers ça et qui pousse vers la centralisation, l'autorité, le côté très hiérarchique, historiquement, qui est en train d'évoluer.
Mais globalement il y a ce premier point.
Le deuxième point, moi, de ma fenêtre, c'est que finalement, après, la bureaucratie crée de la bureaucratie.
C’est-à-dire qu’une fois que tu es là et qu'il y a des process qui t'ont permis d'être là, finalement ces process vont emmener la construction d'autres process qui sont encore plus robustes.
Et in fine, en fait, tu vas venir complexifier et créer de plus en plus de couches, de strates, parce que, en fait, ça appelle mécaniquement à continuer de découper, de structurer, d'aller chercher plus de performance, de re-siloter.
Et une fois que tu as plus de silos, il va falloir trouver une manière de les coordonner, et donc d'autres comités de pilotage, etc.
Et donc, globalement, la bureaucratie appelle de la bureaucratie.
Le troisième axe, je pense qu'il y a un truc qui est plutôt perso, et qui est en lien avec la question égotique, mais c'est qu'une fois que tu as le pouvoir, c'est quand même pas simple de le lâcher.
Tu es là, tu as le pouvoir, tu le contrôles.
Alors je ne dis pas que les gens n'arrivent pas à s'en séparer, mais il y a vraiment ce côté : c’est d'une part addictif, et puis d'autre part, si ce n'est pas toi qui l'as, c'est quelqu'un d'autre.
Donc en fait tu as une perte de contrôle si tu perds le pouvoir.
Et l'autre élément, à mon avis, qui est plus à la marge par rapport à ça, c'est que je pense que pour une bonne partie du management – et plutôt du management intermédiaire – c'est des jobs où globalement tu es quand même un peu moins comptable de tes résultats que tes équipes, ou complètement la direction de l'entreprise.
Et donc, c'est plus compliqué d'arriver à dire « ce manager ou cette manageuse-là fait plus ou moins bien son taf », au-delà des indicateurs.
C'est plus dur d'être comptable, et donc à partir du moment où c'est plus dur d'être comptable, c'est plus dur de faire bouger ça, parce que tu ne peux pas dire « ça marche très bien » ou « ça ne marche pas du tout ».
Jihane Herizi
Ce que tu es en train de dire, c'est que le management intermédiaire a une direction qui est redevable de ce qui se passe dans l'entreprise, et a des équipes qui lui sont redevables, mais que cette personne-là finalement, elle-même, n’est pas redevable de ce qu’elle est en train de faire puisqu'elle est dans l'intermédiaire, et donc du coup c'est difficile de faire bouger cet endroit-là puisqu'on n'a pas en fait la mesure d'impact de ce qu'elle fait, c'est ça ?
Damien Dufourd
Exactement.
Et parce qu’en fait, dans l'intermédiaire, ce n’est pas juste un sujet de management, mais dans l'intermédiaire c'est flou.
Le schéma net, dans lequel on en parlait, notamment le lien entre l'aspiration stratégique et l'exécution terrain, il y a plein de manières d'aller les chercher.
L'aspiration stratégique, elle est souvent assez claire – ce n’est pas toujours le cas, mais souvent – tu as une direction d'administration ou, pour le coup, côté privé, qui sait à peu près où elle a envie d'aller, ce qu'elle a envie de faire.
Sur le terrain, les agents ou les salariés savent exactement aussi ce qu'ils font au quotidien.
Il n’y a pas de problème, ils sont du côté de l'action et du contact usager / utilisateur.
Entre les deux, c'est un peu plus flou.
Et donc, si c'est plus flou, c'est plus dur à objectiver, c'est plus dur à accrocher.
Alors après, tu peux travailler sur la structure, de dire : « globalement, je vais essayer de cascader, ou en tout cas de remonter au minimum, de se dire : ok, voilà ce qu'on fait sur le terrain, donc comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose qui nous semble plus aligné avec notre aspiration sur le terrain ?
Et comment est-ce qu’on remonte ces étages-là ? »
Mais là, ça veut dire arriver à construire toute une structure qui est parfaitement alignée, et c'est tous les enjeux de transformation aujourd'hui.
C’est de se dire : OK, comment est-ce qu’on remet du pilotage par l'impact, du sens, et qu'on fait le lien entre ce qu'on a envie d'aller chercher, en termes de services publics notamment, et la réalité de la…
Jihane Herizi
Du coup, pourquoi il y a ces couches-là ?
Parce que j'ai l'impression que c'est flou, on a du mal à les bouger, j'ai l'impression que c'est souvent là que se joue l'ego, que se joue la difficulté, dans ce management intermédiaire.
Qu'est-ce qui se passe au niveau de la direction, pour que le terrain n'ait pas cette confiance ouverte de créativité et d'action, sans avoir un reporting qui soit une avalanche sur la direction ?
Pourquoi on a des couches intermédiaires qui sont aussi floues ?
Damien Dufourd
Moi, je dirais que tu as plusieurs éléments.
Tu as déjà un historique.
Cette question de l'organisation silotée, dans une logique plutôt historique, a fait ses preuves en termes de performance.
Donc on a quand même réussi à construire, opérer, public comme privé, des grands services qui fonctionnent, et c'est encore le cas, dans des logiques, pour le coup, productivistes, assez performantes, silotées dans leur manière de fonctionner.
Le changement de paradigme, là, des quelques vingt dernières années, notamment, et qui tend à s'accélérer, moi, de ma fenêtre, c'est que, en fait, cette capacité à construire un plan et à l'exécuter avec la croyance que, en fait, le plan qu'on a conçu historiquement va répondre au problème le jour où ce sera là, et tout va bien se passer, est en train de s'effacer.
Et donc, c'est là où, en fait, ça vient confronter le fonctionnement des organisations, c’est-à-dire qu’on a des organisations qui ont, historiquement – pour les plus anciennes – été construites dans cette logique de performance, d’optimum, pour nous, globaux ou locaux, sur des chaînes de traitement, qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de se remettre globalement en question, parce que justement ça a créé ces silos-là, qui sont nécessaires aujourd'hui dans leur mode de fonctionnement.
Donc il y a quelque chose qui est hérité pour moi, pour répondre à ce premier point.
Le deuxième élément, c'est que, de ma fenêtre, au-delà de cet héritage, on a la question, individuellement, des personnes qu'on a positionnées à cet endroit-là, qui sont arrivées là parce que justement elles ont respecté les règles qui leur permettent d'arriver là.
Et donc mécaniquement, tu te retrouves dans cette espèce de croyance personnelle qu’en fait tu as réussi à grandir parce que justement tu as respecté les règles qui t'ont permis d'arriver là où tu es.
Et ces règles sont justement les règles historiques qui ont construit ces silos-là de performance.
Donc tu dois garder les règles, finalement, puisqu'elles t'ont protégé, t'ont amené à arriver là où tu es.
Tu ne peux pas les lâcher.
Et je pense qu’au-delà de ça, même sincèrement, ça ne me paraît pas aberrant que tu aies cette croyance de dire : « En fait, je n’ai pas tapé le plafond de verre, il faut que j’aille chercher encore la suite.
Et ce qui m'a permis d'arriver là où je suis, c'est probablement ce qui va me permettre de réussir demain encore. »
Alors que pas du tout.
Jihane Herizi
On change d'identité, donc on doit changer de règles, on doit changer de façon de faire.
On ne va pas du tout… c'est une fausse croyance.
Damien Dufourd
Et effectivement, parfois, c'est en cassant les règles et en faisant les choses différemment qu'on arrive à passer à l'étape du dessus, et pas en restant dans les mêmes règles.
Tout à l'heure, tu as dit un truc hyper intéressant, qui est la question de la pensée et de l'action.
Jihane Herizi
Est-ce que finalement ce niveau de management agile – enfin non agile d'ailleurs – intermédiaire, pour s'agiliser, ne devrait pas retourner plus sur le terrain, être plus dans l'action, et tu vois, jouer ce ratio-là un peu de pensée stratégique versus action ?
Plutôt que de rester tout le temps dans la tour d’ivoire, à réfléchir, à faire des slides, à lancer l'autorité / pouvoir, est-ce qu'il ne devrait pas se dire : « Allez, je vais aller avec les équipes sur le terrain, comprendre ce qu'elles font et me rapprocher des équipes » ?
Est-ce que ce n’est pas une des premières solutions ?
Et après, je te demanderai les autres, pour agiliser un peu ce niveau de management.
Damien Dufourd
Ça peut.
Je n'ai pas d'avis très tranché sur cette question-là.
Je ne sais pas s'il faut que les managers intermédiaires aillent sur le terrain ou si, en fait, il faut qu'ils laissent l'espace aux équipes pour pouvoir le faire par elles-mêmes et qu'ils repensent leur rôle, pour faciliter justement le travail des équipes pour pouvoir le faire.
Mais il y a en effet une question de posture et de rôle au sein de l'organisation.
Notamment, si j’en prends les piliers un peu Beta, auxquels je crois beaucoup, quelle que soit la forme de l'organisation, il y a la question de l'autonomie.
Et quel espace d'autonomie tu donnes aux équipes pour pouvoir faire et prendre des décisions au niveau le plus proche du terrain ?
Donc là, tu peux très bien, toi, en tant que manager, te dire : « Ok, je vais aller à ce niveau-là, je vais redescendre, je vais prendre des décisions avec les équipes, etc. »
Pourquoi pas.
Maintenant, je pense que c'est moins ton rôle, ou c'est moins le rôle qui est attendu, que de se dire : « En fait, je vais créer de la confiance, je vais créer l'espace, je vais donner la permission aux équipes de faire, je vais rendre les équipes capables d’eux.
Je vais leur donner les moyens d'arriver à s'emparer de ces zones d'autonomie. »
Et ça, c'est un truc qui est hyper clé.
On peut en reparler, notamment dans le changement entre hiérarchie et distribution de l'autorité.
Et après, je vais valoriser ce qui a été produit pour pouvoir tirer, en fait, être catalyseur de ce qui fonctionne au sein de l'organisation, plutôt que la personne qui ancre et qui décide de tout.
Donc, à mon avis, c'est moins une question d'action prioritairement – oui, les actions vont changer – que vraiment le sujet de posture managériale.
Jihane Herizi
Et donc, pour terminer cet épisode riche en informations, avant de passer à notre deuxième partie sur l'impact, tu m'as dit qu’il y a cette solution qui pourrait être de retourner sur le terrain, mais il y a tout simplement le fait de changer de posture et de prendre un rôle différent.
J'entends l'angoisse que ça peut créer chez certaines personnes, qui effectivement n'ont pas appris à avoir ces rôles-là, qui ont appris une forme de management historique.
Et là on leur dit : « Mais en fait, tu pourrais laisser plus d'autonomie, tu pourrais partager l'autorité, tu pourrais partager la valeur, tu pourrais avoir peut-être moins de codirs, moins de comités de pilotage, moins de réunionnite, moins de réunions, moins de mails, etc. »
Enfin tu vois, d’assommer tes équipes, parce que quelque part toi tu te sens redevable à ta direction, et donc tu es en train d'appuyer de manière toxique parfois sur ton équipe beaucoup plus que nécessaire.
Comment ce niveau de management peut – parce qu'on axe sur ce niveau-là, parce qu'on disait tout à l'heure qu’il y a la vision, le sens, on peut le cacher un peu derrière des KPI pour l'entreprise ou l'administration, et les équipes qui sont sur le terrain – et c'est pour ça qu'on se focalise sur ce niveau de management intermédiaire qui peut être quatre ou cinq niveaux, parfois, dans certaines administrations.
Comment enlever cette angoisse, de leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir un rôle où ils peuvent faire moins mais mieux, moins de réunions, moins de pression, et qu'ils peuvent aller chercher leurs propres KPI ?
Ils peuvent même mesurer ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, sans avoir besoin que les équipes le fassent pour eux, pour qu'eux puissent être redevables, et qu'ils puissent avoir un job qui fait sens.
Comment on fait pour les aider à se sentir mieux, plus apaisés ?
Ça, c’est ma première question, sur ce niveau-là, pour leur dire et leur faire comprendre tout ça.
C'est un long travail, j’imagine, qui va prendre des années, et tu vas avoir beaucoup de boulot.
Et la deuxième question, c'est : pour mon Booster Agile, et tous mes agents qui sont en management et qui sont coincés par ce management, c'est quoi la première étape pour aller s'asseoir face à ses managers ou à son manager et instaurer cette confiance, pour pouvoir avoir cette autonomie ?
Dans les deux cas, comment on fait ? Et on clôturera l'épisode qui a été hyper riche.
Damien Dufourd
D'un point de vue manager, déjà, il y a quand même un peu un désamour.
On voit, notamment, il y a pas mal de publications en ce moment sur ce rôle-là.
Ça attire moins de gens.
Le côté « je suis manager, je suis chef, c'est moi qui me tape toutes les mauvaises décisions, les trucs compliqués, et en plus j'arrive pas justement à faire le lien entre l'aspiration stratégique qui me semble un peu perchée et la réalité de ce que font mes équipes », je pense que c'est un métier qui donne de moins en moins envie.
Et on le voit pas mal aujourd'hui.
Donc le premier truc, c'est : comment est-ce qu'on redonne du sens ?
Comment est-ce qu'on redonne de l'envie ?
Comment est-ce qu'on recrée quelque chose qui est utile, à la fois pour l'organisation et pour soi en tant que manager ?
C'est-à-dire : comment est-ce qu'on a l'impression de faire quelque chose qui nous sert et qui sert le collectif ?
Je pense que c'est vraiment la première question.
C'est finalement : comment moi je m'épanouis en tant que manager dans l'organisation, et comment est-ce que je conçois mon rôle, justement, entre cet espace d'aspiration et ce qui est fait au niveau des équipes ?
Donc se requestionner déjà sur ton rôle et sur soi, ça me semble être une étape importante : qu’est-ce que tu as envie de faire, et comment le faire.
Après, plus concrètement, le changement de posture, de passer d'une logique d'objectif / contrôle à une logique plutôt de leadership, de « donner la permission », de « rendre capables », il y a un gros sujet d'ego.
Il y a un gros sujet d'ego.
Le premier truc, c'est : si on reprend les choses un peu catégorisées, il va falloir accepter que, un, ce n’est pas toi qui décides de tout.
Et ça, c'est une première étape. Je ne dis pas qu'elle est dure à récupérer, mais il faut accepter que tu ne vas pas décider de tout.
La deuxième, c'est qu’il faut accepter que les décisions qui vont être prises ne sont pas forcément les décisions que toi tu aurais prises.
Et ça, ça rejoint la notion de consentement que j'évoquais un petit peu tout à l'heure.
Et le troisième truc, qui est encore plus dur, c’est d’accepter qu’il y a des décisions qui vont être prises alors que tu considères que c'est des mauvaises décisions.
Et là, qu'est-ce que tu fais ?
C'est là où on voit vraiment les crash tests sur la question de l'autonomie des équipes.
Et puis, comment est-ce que tu accompagnes justement les équipes, pour le coup, à apprendre par elles-mêmes, à faire leurs propres erreurs ?
Comment est-ce que tu viens valoriser cet espace d'apprentissage, ces échecs, pour permettre aux équipes de continuer à grandir ?
Donc il y a vraiment, d'un point de vue manager, un travail sur soi, un travail sur sa posture, un travail sur ce qu'on vient y chercher, comment on le fait, et puis sur son rôle au sein de l'organisation.
Jihane Herizi
Là, tu es en train juste de m'ouvrir la porte en me disant : la psychologie du travail, la psychologie, le développement de soi, est un sujet extrêmement important dans le privé comme dans le public.
Et que c'est par là que ça part, puisque c'est soi.
Depuis tout à l'heure, on parle de soi.
Et c'est un sujet qu'on refuse beaucoup dans l'administration.
Donc, je te remercie pour ça.
Ok. Et ensuite ?
Damien Dufourd
Ensuite, d'un point de vue plutôt soit agent, soit salarié, je pense qu'il y a souvent des espaces – moi je le vois avec les équipes que j'accompagne – dans lesquels le modèle mental, la façon de fonctionner, les process, sont dysfonctionnels.
Il y a des espaces où, ok, c'est des gros morceaux, ça peut donner l'impression que ça tourne, que c'est compliqué, que c’est difficile, etc., mais ce n’est pas forcément là où il faut aller se confronter en priorité.
Par contre, il y a des espaces très clairs où, en vrai, le modèle de fonctionnement actuel ne marche pas.
Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça crée des interstices dans l'organisation dans lesquels on peut arriver, notamment en tant qu'agent, en tant que salarié – peu importe – dans l'organisation, en disant : « En fait, sur cet endroit-là, moi ce que je propose, c'est d'aller fonctionner un peu différemment, de faire un pas de côté et d'aborder cette question un peu différemment.
Et puis on va voir. »
On se met en action sur un plus petit périmètre, et on va essayer, non pas de tout bouger d'un coup, mais de le prendre par petits bouts, et de dire : on va d'abord changer un petit élément, ou en tout cas on va tester une nouvelle manière de faire dans un espace dans lequel on a fait le constat que notre manière de fonctionner aujourd'hui ne marchait pas.
Et donc, en fait, on vient se créer ces espaces où on peut expérimenter, on peut travailler un peu différemment.
Et ça, ça marche pour tout.
Ça marche pour les produits – c'est l'approche Beta, c’est ça, à la base.
C’est de se dire : on va faire un pas de côté, on va créer une zone d'autonomie.
Il y a un espace, là, de politique publique qui est dysfonctionnelle.
On va s'insérer dedans.
Et puis après, on va développer, on va développer, on va développer.
Et puis on va faire 1, 2, 3, 10, 100 services.
Et puis après, on va mettre tout ça en musique, et on va commencer à penser un discours où on peut imaginer fonctionner plus largement différemment dans la construction et l'opération des services publics.
Et c'est pareil, au sein d'une équipe, on peut transposer ce raisonnement, en disant qu'il y a probablement des espaces dans lesquels on peut commencer à faire différemment.
Et après, rapidement, je pense qu'une fois que tu as réussi à faire tes preuves sur des premiers espaces, pour créer de la confiance – parce qu’il y a vraiment cet enjeu – le point de friction, notamment au niveau managérial, entre penseurs et faiseurs, c'est que le penseur a cette conviction forte que, en fait, si ce n'est pas lui qui pense, ça ne va pas fonctionner.
Et donc, en recréant des succès et en ayant des apprentissages, finalement on crée de la confiance.
Et cette confiance vient permettre aussi d'ouvrir et de se dire : « Voilà, ce qu'on a réussi à faire là, différemment, on peut peut-être imaginer le faire ailleurs, autrement. »
Et après, rapidement, essayer de se confronter à quelque chose de plus massif.
Une fois qu'on a réussi à avoir ces premiers éléments de confiance qui se créent dans l'organisation, qui ont démontré qu'on pouvait fonctionner un peu différemment, aller le faire dans un espace critique.
Là, on prend un gros morceau et on y va.
Comme ça, on ne pourra pas nous dire en face : « Oui, c'est cool, vous l'avez fait, mais regardez, en fait, vous l'avez toujours fait sur des petits trucs, ça marche.
Mais maintenant, quand il s'agit de faire des trucs sérieux, ça ne marchera pas. »
Non.
À un moment donné, il faut sauter, il faut avoir fait ses preuves sur certains sujets, mais il faut prendre un gros morceau, il faut y aller, il faut mettre un maximum de moyens dessus, toute l'énergie qu'on peut, toutes les convictions qu'on a.
Et c'est parce qu'on a réussi aussi à le faire dans un espace qui est massif, qui est critique, qu'à un moment donné, on sera capable aussi de déconstruire cette croyance, qui est de dire que le seul modèle qui fonctionne, c'est le modèle hiérarchique, siloté, structurel, piloté par le haut.
Jihane Herizi
Le premier – moi j'adore parler de la théorie des 1 % – le premier pourcent, la première étape d'un agent qui a envie que ça change au niveau de son management, c'est quoi, selon toi ?
Le premier pourcent des agents, c'est ça la question ?
Damien Dufourd
Oui, oui, oui.
La première étape, je pense qu'il y a des espaces dans lesquels on peut faire sans forcément aller demander l'autorisation de faire.
Et ça rejoint ce qu’on disait un petit peu tout à l'heure sur : où sont les espaces dans lesquels finalement le risque est maîtrisé ?
Je pense qu'il faut s'extraire du fait que fonctionner différemment représente un risque significatif pour l'organisation, pour soi, pour son manager.
Et à mon avis, la réalité de ce qui peut se passer derrière, c'est : si ça fonctionne, c'est plutôt « bah c'est cool, bravo, on a réussi ».
Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas s'interdire, il faut même s'autoriser d'aller chercher à fonctionner différemment sans forcément aller demander la permission de le faire.
Et au pire, si ça ne marche pas, on l'a fait dans un espace qui est peu risqué.
Et l'argumentaire derrière, c'est : qu’est-ce qu'on a appris, en fait ?
Il ne faut pas voir l'échec comme une fatalité, il faut voir l'échec comme une manière d'aller apprendre, de développer cette capacité nécessaire à l'organisation de s'adapter et de tester des nouvelles choses.
Et si les premières démonstrations fonctionnent, après on peut tirer le fil.
Mais voilà, moi, mon raccourci, ce serait de dire : allez-y, faites.
Mettez-vous en mouvement, commencez par un espace qui est accessible pour vous.
On revient sur les principes de l'effectuation : qu'est-ce que vous avez dans votre frigo ?
C'est quoi votre contexte ? C'est quoi les éléments que vous avez à disposition ?
Qu'est-ce que vous pouvez gérer ? Qu'est-ce que vous pouvez changer, à votre niveau, qui vous semble un espace raisonnable, sans que vous ayez forcément besoin d'aller demander une autorisation de faire ?
Et faites.
Et tirez les apprentissages de ça, et remontez, au fur et à mesure, ces éléments-là, à valoriser : « Voilà ce qu’on a fait, voilà ce qu’on a appris, voilà ce que ça a changé pour les usagers, pour les agents, pour le service. »
Et la plupart du temps, c’est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant que ce qu'on imaginait.
Jihane Herizi
C'est la notion de loyauté dont je parle souvent en transgénérationnel, où je dis souvent à mes coachés : « Quand on sort de cette forme de loyauté qu'on a, qu’on pense qu’on doit continuer sur ce chemin, faire cette chose, on arrive à amener des choses à ces personnes-là qui, elles-mêmes, ne savaient même pas qu’elles en avaient envie. »
C’est-à-dire qu’en se donnant la permission et en s'autorisant, souvent on donne la permission et on autorise les managers à eux-mêmes se permettre et s'autoriser des choses qu'ils ne s'autorisaient pas.
C'est-à-dire qu'on libère les gens autour de nous, dans les équipes, et les managers aussi.
Je te vois réagir.
Damien Dufourd
L'une des raisons aussi de la structure managériale, c'est le cadre.
Mais tout est biberonné à ce truc-là.
C’est-à-dire qu'à un moment donné, dans le découpage penseur / faiseur, on va essayer… c’est sûr, on peut imaginer que des personnes vont se mettre en mouvement naturellement, mais la réalité, c'est que ce n’est pas systématiquement le cas.
Pourquoi ?
Parce que ces zones d'autonomie qui sont là, si tu ne permets pas à l'organisation – donc aux personnes dans ton service, dans ta structure – de s'en emparer, si tu ne les rends pas capables de s'emparer de ces autonomies, autrement dit, si tu ne crées pas un cadre différent, si tu fais juste péter le cadre en disant : « Allez-y, faites ce que vous voulez, maintenant c'est l'autonomie totale », il y a peut-être certaines personnes qui ont une mentalité d'entrepreneur, qui vont se débrouiller avec ça et qui vont réussir à s'en sortir.
Il y en a d'autres, ça fait 30 ans qu'elles sont accompagnées, qu’elles baignent dans le cadre – mais même depuis l'école.
Jihane Herizi
C’est parti.
Damien Dufourd
On nous a appris quand même à respecter les consignes et à tenir le cadre.
Quand tu fais péter ce truc-là, nous on l'a vécu côté WeValue, en fait tu as plein de personnes qui n’y arrivent pas, qui ne savent pas s'en emparer, ou pour lesquelles c'est plus difficile.
Et donc tu as une autre responsabilité, qui est de créer un cadre différent, qui permet de rendre capables les équipes de s'emparer des zones d'autonomie nouvelles.
Jihane Herizi
Mais chacun à son niveau.
C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'école, tout le monde ne doit pas faire la même chose de la même manière dans l'équipe.
Et c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, de sécurité psychologique.
Et notamment Google en a fait une étude, en se rendant compte qu’avec la sécurité psychologique, les performances augmentaient entre 35 et 50 % dans l'équipe.
C'est que cette sécurité psychologique doit être adaptée et adaptative aux personnalités, et pas toujours de la même manière.
On ne manage pas tout le monde de la même manière, tout comme tous les enfants ne devraient pas apprendre de la même manière.
Et je pense que c'est ça qui est intéressant : c'est à quel point on peut personnaliser le management pour soi, pour les autres, et pour son équipe.
J'espère que toutes les personnes qui nous ont écoutées, managers ou non, vont s'emparer du sujet.
On a parlé des deux, parce qu'effectivement, on ne tape pas sur les managers, on ne tape pas sur les agents.
Ce n’est la faute de personne.
Et la vraie conclusion, c'est : moi, en revenant à moi-même, qu’est-ce que j'ai envie de me permettre et de m'autoriser ?
Qu’est-ce que j'ai envie de créer comme bien-être pour moi et pour les autres autour de moi ?
Et on n'a pas besoin de suivre cette espèce de code pénal qu'on a dans la tête, de « si A alors B », mais en réalité, est-ce qu'à un moment donné, on peut s'asseoir avec soi et ressentir ?
Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens, si on discutait avec eux, ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils ont envie de faire, ils ne sont pas en train de manager comme ils auraient envie de manager, mais ils pensent qu'ils doivent faire comme ça parce qu'ils ont vécu ça eux-mêmes.
C'était un épisode très intéressant, je te remercie.
Et je te propose qu'on clôture celui-là et qu’on se retrouve pour la deuxième partie sur l'impact, avec un épisode un peu court mais sharp sur ce sujet que tu affectionnes beaucoup.
Ça te va ?
Damien Dufourd
Merci, Jihane. Avec plaisir.
A venir
A venir
Jihane Herizi
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd’hui pour l’épisode 10 du Coup de Boost Agile avec Arnaud Denoix. Salut Arnaud, comment tu vas ?
Arnaud Denoix
Très bien, et toi Jihane, merci.
Jihane Herizi
Ça va super bien, merci. Alors, je t’ai demandé il y a quelques semaines d’enregistrer cet épisode avec moi pour une raison. C’est qu’il y a quelques mois, j’ai vu que tu avais fait un post sur LinkedIn sur, il me semble, le produit Carnet de bord, et sur l’arrêt de Carnet de bord qui avait été salué.
Et ça fait beaucoup lien avec ce que je raconte sur l’agile, quand on fait les Boosters Agiles notamment. On explique toujours que dans la méthode, dans la posture agile, une des trois choses les plus importantes, c’est tuer, savoir tuer des choses, savoir arrêter des projets.
Et souvent, que ce soit dans le podcast ou ailleurs, ou dans les formations, on parle de débuter des projets, commencer des projets, réfléchir à des projets. Il y a toujours des thématiques un peu positives, et on met le côté arrêter, tuer, comme quelque chose de négatif.
Sauf que, il me semble — et tu vas nous le raconter aujourd’hui — arrêter est aussi positif que de commencer des projets. Et tu es une des personnes autour de moi qui me semble être la plus intéressante pour nous raconter cet épisode Carnet de bord.
Avant ça, j’aimerais bien que tu te présentes. Moi, je te connais depuis 6–7 ans. On a travaillé ensemble chez beta.gouv.fr, mais je pense que tu te présenteras mieux que moi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu as fait, où tu en es aujourd’hui ?
Arnaud Denoix
Oui, bien sûr. Je m’appelle Arnaud Denoix, et je dirige un groupement d’intérêt public qui a le statut d’opérateur d’État, qui s’appelle la Plateforme de l’Inclusion.
Notre mission, c’est de développer des services numériques pour les personnes en insertion professionnelle et les gens qui les accompagnent. Tous les travailleurs sociaux, les accompagnateurs, accompagnatrices France Travail, on en compte 160 000 en France.
Mon boulot, c’est d’animer un collectif produit, parce qu’en fait ce qu’on fait, c’est du numérique. On a des designers, des développeuses, des chargés de déploiement. Mon boulot, c’est de me poser à chaque fois la question de la meilleure organisation pour qu’on ait le plus d’impact possible avec nos outils à l’intérieur de l’État.
Je fais ça depuis bientôt quatre ans, et avant, j’étais agent à la Direction interministérielle du numérique. C’est là que j’ai pris un peu le virus des startups d’État et de beta.gouv.fr, et que j’ai découvert en même temps le monde de l’administration et celui du numérique public.
Jihane Herizi
Si on donne un peu plus de détails aux auditeurs, toi, tu viens du privé ?
Arnaud Denoix
Oui. Avant, j’étais dans une grande boîte qui s’appelle Google, une boîte américaine, et j’ai travaillé pour eux en France et aux États-Unis dans des fonctions commerciales.
Jihane Herizi
Qu’est-ce qui t’a fait venir dans l’administration publique, à la base ?
Arnaud Denoix
D’abord, le goût de l’intérêt général, et ensuite, je pense, la curiosité et l’envie de trouver une échelle un peu plus humaine pour travailler.
Je m’explique : dans mon dernier boulot chez Google, j’avais le sentiment de ne pas très bien comprendre comment ce que je faisais pendant la journée avait un impact réel sur notre organisation, indépendamment même du côté intérêt général, éthique, moral. C’est juste le fait de se dire : je suis dans une organisation tellement grande que je ne sais pas très bien à quoi je sers en tant qu’individu et à quoi on sert en tant qu’équipe.
Ce qui m’a plu quand j’ai rejoint les startups d’État et beta.gouv.fr, c’est de trouver des échelles plus petites. Une startup d’État, c’est 5 ou 6 personnes au début. Et donc de comprendre qu’on pouvait avoir une discussion le lundi avec un développeur, avoir quelque chose en production le mardi, et avoir des résultats avant la fin de la semaine.
Avant tout, c’est cette joie de retrouver une échelle — que j’appelle une échelle d’impact — de comprendre l’utilité et l’impact d’une discussion sur la vie d’un produit, qui m’a plu.
Après, il y a l’environnement dans lequel on le fait. Et je trouve que les sujets d’intérêt général et de l’État sont passionnants parce qu’ils touchent à des millions de vies. Quitte à essayer d’avoir de l’impact et à trouver de la joie dans le fait de fabriquer des produits numériques, autant le faire pour une cause qui le mérite.
Jihane Herizi
On est d’accord, on ne va pas se le cacher, qu’en termes d’avantages, en termes de salaire, ça n’a rien à voir de passer de Google à un ministère. Et pourtant on fait le choix de passer du privé au public. Tu as trouvé ton compte ?
Arnaud Denoix
Oui, complètement. Tu as raison, les conditions matérielles ne sont pas complètement les mêmes, mais plutôt que de me plaindre ou de regretter mon salaire chez Google, ce que je retiens, c’est que j’ai réussi à trouver un environnement de travail hyper intéressant à l’intérieur de l’État.
Et c’est ça auquel je suis attaché. À la Plateforme de l’Inclusion, grâce à une vraie politique RH ambitieuse, on a réussi à recruter des talents du numérique, à leur proposer des salaires qui sont très corrects, mais surtout, au-delà du salaire, de leur proposer une culture de travail qui leur convient.
Et qui fait qu’on arrive à être compétitifs. Même si on est l’État, même si on est un opérateur d’État, même si on n’est pas Doctolib ou Alan, on arrive quand même à être assez compétitifs, justement grâce à notre environnement de travail.
Donc moi, je n’ai pas du tout l’impression d’avoir vécu le passage du privé au public comme une régression sur le plan des conditions d’exercice de ma mission. Je gagne moins d’argent qu’avant, mais il y a plein d’aspects où je suis gagnant.
Jihane Herizi
Et donc toi, tu es arrivé en tant qu’agent ou en tant que prestataire à la DINUM ?
Arnaud Denoix
C’est une bonne question. J’ai découvert beta.gouv.fr et les startups d’État par le prisme de data.gouv.fr, Transport data.gouv.fr pour être précis, parce que je travaillais chez Google sur Google Maps.
J’essayais de récupérer les bonnes données de transport pour qu’elles soient affichées au bon moment, au bon endroit, en France et dans d’autres pays européens. Et les données de transport en France étaient magnifiquement consolidées par une équipe qui s’appelait Transport data.gouv.fr, que j’ai rencontrée à cette occasion.
En rencontrant Transport data.gouv.fr, j’ai rencontré les startups d’État, beta.gouv.fr, la DINUM et le monde de l’open data.
Jihane Herizi
Est-ce que tu es arrivé en prestataire ou en agent ?
Arnaud Denoix
Oui, j’ai tout de suite essayé de voir si je pouvais moi-même rejoindre l’administration et le monde des startups d’État.
Ce qu’on m’a proposé à court terme, c’était de devenir coach de trois équipes chez Pôle emploi. Pôle emploi avait un incubateur de startups d’État et ils cherchaient quelqu’un pour accompagner le déploiement à grande échelle de trois services numériques.
J’ai fait ça en tant que freelance pendant un an.
Et au bout d’un an, j’ai choisi de devenir agent public en acceptant une opportunité côté DINUM pour l’animation du programme beta.gouv.fr.
Là, mon boulot était un peu différent. Ce n’était plus simplement l’accompagnement opérationnel d’équipes en tant que coach, mais c’était essayer de faire rayonner la méthode beta.gouv.fr à l’intérieur de l’administration.
Convaincre des administrations centrales ou des cabinets ministériels d’utiliser cette méthode pour résoudre des problèmes de politique publique.
Jihane Herizi
Oui, c’est là où on a travaillé ensemble et on était agents tous les deux dans la même équipe. Et à ce moment-là, il me semble que c’est là où tu prends le portefeuille… Alors comment tu l’appelais ? Travail, insertion… comment il s’appelait ton portefeuille ?
Arnaud Denoix
Oui. En fait, si on se dit que l’objet de la DINUM, c’est de déployer les méthodologies beta.gouv.fr dans tous les domaines de l’État, moi j’ai essayé de le faire dans le secteur emploi-travail.
Ça correspond, pour les connaisseurs, aux programmes 102 et 103 du projet de loi de finances. Et mes interlocuteurs, ça a été beaucoup — à l’époque — Pôle emploi, devenu France Travail, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, et d’autres acteurs autour du ministère du Travail.
Jihane Herizi
Et du coup, comment naît le GIP ? Comment tu en deviens directeur, en quelques mots ?
Arnaud Denoix
Le GIP naît officiellement en 2022. Sa vocation était claire : comment pérenniser des services numériques qui ont prouvé leur impact, qui sont passés à l’échelle dans la sphère travail, et dont on avait envie de préserver les ingrédients du succès.
En 2022, il n’y avait pas d’organisation dans laquelle on pouvait facilement projeter ces startups d’État. Elles étaient trop différentes dans leur manière de travailler.
On voulait internaliser encore plus de compétences tech. Il ne fallait pas être contraints par les plafonds d’emploi. Il fallait pouvoir proposer des conditions de travail attractives pour convaincre des prestataires de changer de statut.
Pour toutes ces raisons, la ministre du Travail de l’époque, Élisabeth Borne, a poussé pour la création d’un groupement d’intérêt public avec une grande autonomie sur la manière de s’organiser.
Jihane Herizi
Tu parlais tout à l’heure justement d’une politique RH. Avec Mélodie, quand on est en formation, on a tendance à parler de santé mentale et d’impact dans l’agilité, qui sont pour nous les deux faisceaux d’indices qui montrent qu’un produit avance dans le bon sens.
Tu as parlé d’impact depuis tout à l’heure et tu as parlé d’une politique RH. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez mis en place qui est différent des autres organisations, des autres administrations, et qui a attiré autant de prestataires ou de personnes en contrat, au point qu’elles se disent : « j’ai envie de travailler pour la Plateforme de l’Inclusion » ? Et qu’est-ce qui pourrait être intéressant à reproduire ailleurs ?
Arnaud Denoix
C’est le sujet que je trouve le plus intéressant dans ce qu’on fait. On développe des outils numériques dont on peut être fiers, mais ces outils peuvent évoluer dans le temps. On va d’ailleurs parler d’un outil qu’on a nous-mêmes arrêté.
Ce qui reste à la fin, ce qu’on crée comme valeur durable, c’est l’organisation humaine et l’environnement de travail qui permettent à ces produits de fonctionner.
Je passe de plus en plus de temps — à mesure que les quatre ans du groupement passent — à m’interroger sur les conditions de succès de l’organisation humaine.
On n’a pas de leçons à donner. On se remet beaucoup en question. On a aussi pas mal d’échecs sur ces sujets d’intelligence collective et d’organisation humaine.
J’aime bien présenter notre culture de travail autour de trois mots-clés, trois principes qu’on essaie de faire vivre.
Le premier, c’est l’autonomie. Plus l’organisation est grande et complexe — et on sait qu’à l’intérieur de l’État, il y a de très grandes organisations — plus il est important de maximiser l’autonomie des gens qui fabriquent des choses.
J’ai été témoin trop souvent de l’impuissance de personnes qui attendent toujours des validations : du manager, du manager du manager, parfois jusqu’au cabinet ou à la ministre.
Dans beaucoup de cas, ça enraye la prise de décision, ça ralentit tout, et on perd la joie de voir l’impact de ce qu’on fait.
À la Plateforme de l’Inclusion, on a gardé comme unité de base une équipe produit de six ou sept personnes maximum.
Pourquoi maximum ? Parce qu’on a constaté que dès que l’équipe est plus grande, on perd en vélocité, en agilité, et on commence à se rebureaucratiser.
On appelle ça des unités de vie. Il y en a une dizaine chez nous. C’est là que les choses se font. C’est là que les produits sont conçus, développés, mis en production.
Ces équipes doivent avoir un maximum d’autonomie. Et moi, mon rôle, c’est justement de m’assurer que les décisions ne remontent pas inutilement jusqu’à moi.
Je passe beaucoup de temps à répondre à des sollicitations où ma réponse est simplement : « tu n’as pas besoin de moi pour prendre cette décision ».
C’est frustrant parfois, mais c’est indispensable si on veut faire vivre réellement le principe d’autonomie. Sinon, on retombe immédiatement dans un modèle hiérarchique classique où tout doit être validé par le chef.
Or ce n’est pas le modèle qu’on veut promouvoir.
Le deuxième principe, c’est la transparence et la circulation de l’information.
Quand j’ai rejoint beta.gouv.fr, j’ai été très marqué par le fait que tout se faisait sur des canaux publics. Avoir des discussions privées était presque mal vu.
Cette transparence a énormément de valeur. Elle permet à des personnes auxquelles on n’aurait jamais pensé de venir aider. Elle rend responsable vis-à-vis d’un collectif plus large.
Concrètement, chez nous, les grilles de salaire et les rémunérations de toutes les personnes qui travaillent avec la Plateforme de l’Inclusion — quel que soit leur statut, agents publics ou freelances — sont partagées.
Les feuilles de route produits sont accessibles. Les objectifs aussi.
Ce qui reste confidentiel, c’est ce qui relève strictement de la vie privée ou du RH sensible, comme un arrêt maladie. Mais par défaut, on applique un maximum de transparence.
On se donne même comme objectif de réduire au maximum le coût d’accès à l’information à l’intérieur du GIP.
Jihane Herizi
C’est hyper intéressant ce que tu dis, parce que dans l’épisode précédent j’ai reçu Damien, qui expliquait comment ils avaient mis ça en place dans le privé. Et je me disais que dans l’administration, ça devait être beaucoup plus compliqué.
Et en fait, tu es en train de montrer que non, c’est possible. Comment ça se fait que vous y arrivez et que d’autres administrations n’y arrivent pas ?
Arnaud Denoix
Je dirais que notre chance, ça a été de démarrer presque de zéro. On ne démarre pas totalement de zéro, parce qu’on reste des agents publics avec un cadre juridique, des contrats encadrés par la loi.
Mais l’organisation de la Plateforme de l’Inclusion, elle, a vraiment démarré en 2022. J’avais donc pas mal de cartes en main pour réunir les conditions que je trouvais désirables.
Je sais que pour d’autres administrations ou opérateurs, gérer un historique est beaucoup plus complexe. Mais malgré tout, beaucoup de choses que nous faisons sont réplicables. Nous-mêmes, on a énormément piqué aux autres.
Quand j’ai démarré le GIP, j’étais le premier salarié. Il n’y avait aucune fonction support. Pas de RH, pas d’équipe administrative.
La première question que je me suis posée, c’est : il faut faire une grille de salaire. Elle devait respecter les préconisations de la DINUM, mais dans la réalité, il fallait décider des forfaits jours, des congés, des équilibres.
Je suis allé voir des gens que je connaissais dans des environnements numériques publics et privés que je trouvais inspirants. Je me suis dit : si je veux recruter les mêmes profils, il faut comprendre ce qui a marché chez eux.
Jihane Herizi
D’ailleurs, cette histoire de sept personnes, il me semble que ça vient du privé. Il y a eu des études sur le nombre idéal de personnes dans une équipe, et c’était sept.
À partir de sept personnes, il y a un décrochage : à chaque personne en plus, il y a un risque supplémentaire de ne plus pouvoir décider. Google en parle d’ailleurs.
Arnaud Denoix
Oui, exactement. Et sur tous les sujets, on a essayé de se documenter.
J’avais l’intuition que les réponses se trouvaient du côté des organisations libérées, des organisations opales. Ce sont des notions auxquelles je ne connaissais rien au départ, mais qui me faisaient envie.
Ça part aussi d’un désir d’apprendre, de se former, et d’embarquer les autres.
Jihane Herizi
C’était des discussions qu’on avait eues chez beta.gouv.fr aussi, il y a quelques années. Et donc, la troisième, autonomie, transparence… c’est la troisième ?
Arnaud Denoix
La troisième, elle est super importante. C’est un des sujets sur lesquels je réfléchis le plus. C’est la question de la redevabilité.
Quelque chose, je pense, que les startups d’État ont réussi à restaurer un petit peu à l’intérieur de l’administration, c’est cette notion de redevabilité. Parce que parfois, les organisations sont tellement complexes que les gens n’ont pas vraiment les conditions pour réussir.
Ils sont dans un environnement de travail qui a plein de défauts, et à la fin, il y a une forme de déresponsabilisation généralisée.
On le voit avec tous ces grands projets informatiques qui échouent et coûtent parfois des centaines de millions d’euros. On cite souvent les exemples anciens des logiciels de paie de l’Éducation nationale ou des armées.
Mais en fait, là où on se parle, on est en décembre 2025, et sur les deux dernières semaines, il y a eu deux catastrophes industrielles qui ont coûté plusieurs centaines de millions d’euros d’argent public. Je pense notamment aux logiciels utilisés par la police et à un autre exemple.
Ce qui me frappe à chaque fois, ce n’est pas de me dire « ils n’ont pas fait de l’agile ». C’est plutôt : qui est en train de ne plus dormir la nuit à cause de ça ?
Et ce n’est pas clair aujourd’hui. J’ai l’impression qu’il y a plein de grands projets où on a tellement saucissonné les tâches, les missions, les responsabilités, que plus personne n’est responsable de rien.
On peut se retrouver à se dire qu’on a dépensé 271 millions d’euros pour quelque chose qui ne marche pas, sans que personne n’en subisse réellement les conséquences.
Jihane Herizi
Et en même temps, c’est difficile, et c’est aussi pour ça qu’il y a eu toutes les histoires avec les cabinets de conseil. De plus en plus d’agents ne souhaitent pas être redevables, pour ne pas avoir de problèmes.
Du coup, on délègue, on dilue, et on ne sait plus qui fait quoi, qui est responsable de quoi.
Cette question de la redevabilité, est-ce que c’est celle-là qui vous a amenés sur le sujet Carnet de bord et à l’arrêter ? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s’est passé, comment la décision a été prise ?
Arnaud Denoix
En partie, oui. Carnet de bord, c’est l’histoire d’un service numérique qu’on a décidé d’arrêter parce qu’il n’était pas suffisamment utilisé, et surtout pas suffisamment utile.
L’histoire remonte au Service public de l’insertion et de l’emploi, lancé autour de 2020-2021. Dans ce cadre-là, on avait un projet de dossier socio-professionnel unique.
L’idée — et le problème existe toujours — c’est que l’insertion est un millefeuille administratif. Les usagers sont confrontés à plein de guichets différents, doivent répéter les mêmes informations, se découragent, et parfois ne comprennent même pas qu’ils sont dans un parcours.
On parle beaucoup de parcours RSA, mais il suffit de passer un peu de temps avec des allocataires du RSA pour se rendre compte qu’ils n’ont pas nécessairement conscience qu’ils sont dans un parcours.
Arnaud Denoix
Pour toutes ces raisons, le gouvernement nous a missionnés et on a collectivement pensé que ce serait utile de créer un dossier qu’on a appelé Carnet de bord, qui donnerait un minimum d’informations sur une personne et qui pourrait être partagé entre plusieurs professionnels.
On a réussi à créer ce dossier unique, à le mettre en ligne, à embarquer une douzaine de conseils départementaux, à récupérer des données intéressantes de Pôle emploi et des conseils départementaux, à les rendre visibles.
On a réussi à mettre les acteurs autour de la table pour créer des référentiels de données. Mais on n’a pas réussi à ce que ça marche à la fin.
Quand je dis « que ça marche », c’est que notre promesse était de simplifier la vie des usagers et des travailleurs sociaux. Et sur le terrain, on s’est rendu compte qu’on avait surtout créé un outil de reporting.
Les accompagnateurs ouvraient le carnet de bord non pas pour gagner du temps en rendez-vous ou mieux accompagner la personne, mais parce que leur manager leur avait demandé de le faire, parce que ça rentrait dans du reporting.
Ce n’est pas une finalité déshonorante, mais ce n’était pas du tout celle qu’on nous avait confiée.
Jihane Herizi
Et à ce moment-là, vous vous dites quoi ?
Arnaud Denoix
On se dit qu’il y a un problème. Et là, la notion de redevabilité rentre en jeu.
Tout le monde était plutôt content du point de vue des usages déclarés, mais nous, on ne pouvait pas être contents. Parce que notre cadre de redevabilité, ce n’est pas uniquement la satisfaction de nos financeurs ou de nos partenaires, c’est notre capacité à démontrer un impact réel.
C’est assez contre-intuitif. On te finance, tu produis quelque chose, tu as la confiance de tes financeurs, et pourtant tu dis : « je ne vais pas me contenter de cette confiance, il y a un problème ».
Donc on va voir nos financeurs et on leur dit : désolé, mais ça ne fonctionne pas, il faut sans doute s’y prendre autrement.
Jihane Herizi
Et ça, ce n’est pas possible dans un cadre classique.
Arnaud Denoix
Exactement. Dans un modèle classique de marché public ou de délégation à un éditeur privé, il n’y a aucune incitation à faire ça.
Il n’y a pas beaucoup d’éditeurs qui vont dire à leur donneur d’ordres : « vous aviez prévu de me donner dix millions l’an prochain, mais récupérez-en cinq, parce que ce qu’on fait n’est pas utile ».
Dans le service public, quand on fait les choses en interne, c’est possible.
Jihane Herizi
Concrètement, comment vous avez décidé ?
Arnaud Denoix
J’ai demandé à l’équipe Carnet de bord de se réunir avec un regard extérieur. C’était Nicolas, qui est coach et expert en mesure de la valeur.
On s’est posé une question simple : quels sont les indicateurs dont on ne dispose pas aujourd’hui et qui permettraient de dire si le produit marche vraiment ou pas ?
Il y avait un décalage entre les chiffres d’usage et ce qu’on ressentait sur le terrain. Et quand il y a un décalage entre les chiffres et la réalité, c’est souvent qu’on ne regarde pas les bons indicateurs.
Arnaud Denoix
La première étape, ça a été de regarder les bons indicateurs. Ça a été rendu possible par l’intervention de Nicolas et par le fait d’avoir un regard extérieur.
Quand on est au four et au moulin, on ne voit plus certaines choses. Le regard extérieur permet de re-questionner ce qu’on ne questionnait plus.
On a donc défini un ensemble d’indicateurs. Par exemple, la notion de rétention. En numérique, la rétention est fondamentale.
Un travailleur social découvre Carnet de bord dans les Ardennes, commence à l’utiliser. La question, c’est : est-ce que deux mois plus tard, il continue à l’utiliser ?
C’est un indicateur qu’on regarde très peu, même dans les startups d’État. On regarde souvent les courbes d’usage, beaucoup moins celles de rétention, parce qu’elles sont plus difficiles à calculer.
Nous, on a décidé d’en faire un critère central de la valeur créée par le produit.
Jihane Herizi
Et qu’est-ce que ça a donné ?
Arnaud Denoix
Au bout de quelques semaines, on s’est rendu compte que les indicateurs étaient mauvais.
À partir de là, le travail a été d’aller voir nos financeurs et nos sponsors et de leur dire : on ne sait pas exactement pourquoi ça ne marche pas, mais notre devoir, c’est de vous dire que ça ne fonctionne pas.
Et donc on vous propose d’arrêter.
Jihane Herizi
Pas de modification ? On arrête direct ?
Arnaud Denoix
Oui. Parce qu’on était arrivés à un point où on ne pensait pas qu’un pivot ou un ajustement stratégique suffirait.
Souvent, on a l’impression qu’il faut avoir compris exactement pourquoi ça ne marche pas avant d’arrêter. Et ça retarde l’arrêt.
On se dit : c’est peut-être la mauvaise équipe, peut-être un problème de santé mentale, peut-être que les gens ne s’entendent pas bien. On commence par changer les personnes.
Ensuite, on se dit que ce n’est pas le bon produit, puis que ce n’est pas la bonne techno. On passe des dizaines d’heures à discuter de la techno, à se dire qu’elle est trop lourde, pas assez interopérable.
Pendant ce temps-là, on continue de brûler de l’argent public.
Jihane Herizi
Mais vous avez demandé aux utilisateurs pourquoi ils ne revenaient pas ?
Arnaud Denoix
Oui, bien sûr. Mais le problème, c’est que dans l’insertion, les utilisateurs ont été habitués à des expériences informatiques assez mauvaises.
Ils sont très gentils. Ils nous disaient : « c’est super Carnet de bord, il manque juste ce petit truc, et si vous faisiez ça, je reviendrais ».
Mais on s’est retrouvés avec une liste énorme de petits trucs, des dizaines de cartes dans le backlog.
Tout ça fait perdre un temps fou. Et pendant ce temps-là, on continue de dépenser de l’argent public.
Jihane Herizi
Et donc vous arrêtez.
Arnaud Denoix
Oui. D’abord, on arrête. Parce que l’urgence, c’est d’arrêter l’hémorragie.
Si on pense qu’on est en train de mal employer de l’argent public, il faut arrêter immédiatement.
Ensuite, bien sûr, on fait un post-mortem, on regarde ce qu’on aurait fait différemment, on partage les apprentissages.
Mais on peut arrêter un produit sans avoir complètement compris pourquoi il ne marchait pas.
Jihane Herizi
On était sur quel type… enfin, combien de personnes et quel type de budget, pour essayer de comprendre où se situait le produit ?
Arnaud Denoix
Alors, Carnet de bord, dans mon souvenir, ça coûtait à peu près 500 000 euros par semestre. Donc environ 1 million d’euros en année pleine.
Et comme c’était en production depuis au moins deux ans, ça a dû coûter autour de 2 à 2,5 millions d’euros.
Dans l’équipe, il devait y avoir trois ou quatre développeurs, un PM, un designer. Et si tu comptes les coachs, les renforts qui viennent et qui repartent, on devait être autour d’une dizaine de personnes.
Jihane Herizi
Et qu’est-ce que vous faites des gens quand vous arrêtez ?
Arnaud Denoix
C’est tout l’intérêt d’avoir constitué un groupement d’intérêt public. On peut redéployer les moyens là où ils sont utiles.
L’arrêt de Carnet de bord a été le début de plein de choses. Déjà, ça nous a rendus meilleurs.
On a compris qu’il fallait dérisquer le fantasme du dossier social unique. Même quand tout le monde te dit : « ce serait génial d’avoir toutes les infos sur une personne », il y a parfois un décalage énorme entre le discours et l’usage réel.
Jihane Herizi
Donc vous avez fait autre chose ?
Arnaud Denoix
Oui. On a lancé dans la foulée une expérimentation beaucoup plus frugale sur les données partagées.
Plutôt que de partager tout un diagnostic socio-professionnel, on s’est demandé quelle était la donnée minimale qui pouvait vraiment créer de la valeur.
Et on s’est rendu compte qu’une information extrêmement simple avait beaucoup plus d’impact : savoir qui accompagne la personne.
Jihane Herizi
C’est-à-dire ?
Arnaud Denoix
Si un conseiller France Travail reçoit une personne en rendez-vous et sait qu’elle a vu juste avant un agent du CCAS, on ne lui dit pas ce qu’ils se sont dit, on ne partage pas les détails du dossier, on lui dit juste : tu n’es pas le seul à accompagner cette personne.
Et en fait, ça change tout. Les professionnels connaissent leur métier. Ils vont appeler, se coordonner, adapter leur accompagnement.
On s’est rendu compte que cette donnée-là avait énormément plus de valeur qu’un dossier hyper détaillé partagé à tout le monde.
Jihane Herizi
Donc est-ce que ça veut dire que Carnet de bord est allé trop loin, trop vite, et qu’il fallait l’arrêter pour repartir autrement ?
Arnaud Denoix
Oui, je pense que c’est ma responsabilité aussi. Il y a eu trois responsables produit différents sur Carnet de bord.
Quand il y a autant de changements, c’est souvent le signe que la mission n’était pas claire. On ne s’est pas assez concentrés sur la résolution d’un problème concret au départ.
Dès que tu entends « dossier social unique », tu devrais te méfier. On a voulu répondre à trop d’objectifs en même temps.
Arnaud Denoix
On était pris dans des injonctions qui n’étaient pas toujours compatibles. Certains financeurs trouvaient Carnet de bord super parce que ça allait être un très bon outil de reporting sur les parcours intensifs RSA.
D’autres — parfois les mêmes — disaient que ce serait un succès si on arrivait à mettre en œuvre le Dites-le-nous-une-fois et à supprimer des ressaisies de données.
Sur le papier, ce ne sont pas des objectifs incompatibles, mais en réalité, tu ne mesures pas du tout la même valeur selon que tu consolides un reporting pour un financeur ou que tu fais gagner du temps à un usager.
Dès le départ, on a essayé de tenir plusieurs objectifs en même temps, et c’est typiquement le piège du cahier des charges. On cherche à satisfaire trop de parties prenantes à la fois.
Jihane Herizi
Si c’était à refaire, ça aurait dû commencer comment ?
Arnaud Denoix
Si c’était à refaire, on démarrerait de manière beaucoup plus modeste, en essayant de résoudre un petit problème très concret.
Et peut-être que ça nous aurait menés, à la fin, à un dossier social unique, mais peu importe. On aurait gagné la confiance en chemin.
Si je prends d’autres exemples de choses qui ont fonctionné à la Plateforme de l’Inclusion, notamment sur la simplification administrative, on s’est toujours concentrés sur un verrou très précis.
Jihane Herizi
Par exemple ?
Arnaud Denoix
Par exemple, l’orientation vers l’insertion par l’activité économique, avec les chantiers et entreprises d’insertion.
Le verrou, c’était l’agrément IAE, qui obligeait les employeurs à passer par une agence Pôle emploi. Il y avait énormément de temps perdu, et ça retardait le démarrage des contrats.
Autre exemple : les immersions professionnelles. Il y avait un CERFA de plusieurs pages, avec énormément d’informations, trois signatures obligatoires.
On observait un taux d’abandon énorme. Convaincre une entreprise d’accueillir quelqu’un en immersion est déjà compliqué. Si en plus tu lui demandes de remplir un CERFA interminable, tu perds tout le monde.
Jihane Herizi
Et donc vous avez fait quoi ?
Arnaud Denoix
On s’est concentrés uniquement sur la réduction de ce taux d’abandon. On a fait tout ce qu’on pouvait pour simplifier cette étape-là, et seulement ça.
Ça a donné des outils aujourd’hui utilisés par des centaines de milliers de personnes partout en France, avec une croissance très forte.
Et une fois ce problème résolu, seulement après, on a pu travailler sur des tableaux de bord pour les financeurs, sur le pilotage par la donnée.
On n’a pas fait les deux en même temps. On a commencé par résoudre un vrai problème de terrain.
Jihane Herizi
Quand on écoute cet épisode depuis l’administration, il y a deux cas.
Soit on est sur un projet qu’on sent devoir arrêter mais le management ne veut pas, ou l’équipe n’est pas d’accord.
Soit on est sur un projet qui dure depuis des années, qui a coûté énormément d’argent, et où il y a ce biais des coûts irrécupérables : « on a déjà investi, donc on continue ».
Dans ces deux cas, quel conseil tu donnerais ?
Arnaud Denoix
C’est là qu’on revient aux cadres de redevabilité.
Ce qui dysfonctionne, c’est que personne n’interrompt le cercle des coûts irrécupérables. Et c’est très difficile de demander à une équipe qui travaille depuis des années sur un produit d’être lucide sur le fait qu’il faudrait peut-être arrêter.
Il y a de la peur : peur de l’échec, peur qu’on demande des comptes sur l’argent investi. Et il y a aussi un manque de discernement quand on est trop impliqué.
Jihane Herizi
Donc il faut quelqu’un d’extérieur ?
Arnaud Denoix
Oui. Il faut des garde-fous. Un peu comme la Cour des comptes ou les inspections générales, mais intégrés au pilotage opérationnel.
Il faut quelqu’un qui puisse venir dire : il y a un problème. Pas pour désigner un coupable, mais pour forcer la décision.
Jihane Herizi
Et quand c’est une commande politique ?
Arnaud Denoix
J’ai travaillé quasiment uniquement sur des commandes politiques. Je ne crois pas à l’opposition entre commandes politiques et problèmes de terrain.
Une commande politique, ça doit être un objectif, pas un cahier des charges technique.
Ce qui aide beaucoup, c’est de clarifier très tôt ce qui définira le succès ou l’échec du produit. Et de se mettre d’accord avec les financeurs sur des indicateurs clairs.
Jihane Herizi
C’est-à-dire ?
Arnaud Denoix
Par exemple, se dire : dans six mois, si on n’a pas amélioré concrètement la vie de mille allocataires du RSA, alors on arrête.
Ça oblige à s’engager sur des cibles quantitatives, pas juste sur des indicateurs vagues.
Et quand tu reviens six mois plus tard et que tu montres que tu n’as pas atteint ces cibles, en général, les gens respectent l’accord.
Jihane Herizi
Donc on peut faire ça dès le début, même avec une commande politique.
Arnaud Denoix
Oui. Et le premier conseil que je donnerais, c’est : moins d’indicateurs, mais des cibles claires.
Beaucoup de projets se lancent sans jalons précis, sans seuils de décision. Et ensuite, plus personne n’ose arrêter.
Jihane Herizi
Pour conclure, pourquoi selon toi on n’arrive pas à arrêter plus de produits aujourd’hui ?
Arnaud Denoix
Parce que c’est extrêmement difficile psychologiquement. Tout nous pousse à persévérer, surtout quand on a déjà investi beaucoup d’énergie.
Rien, dans l’organisation du travail aujourd’hui, n’encourage naturellement l’arrêt. Il faut donc créer artificiellement des garde-fous.
Je pense aussi que la contrainte budgétaire peut aider. Quand les budgets sont très confortables, on est moins exigeant sur le retour sur investissement.
Jihane Herizi
Un dernier mot ?
Arnaud Denoix
Oui. Il faut toujours demander de l’aide.
Même quand on a déjà arrêté un produit, on continue à vivre des situations où c’est difficile. Demander de l’aide à des collègues, à la DINUM, à des personnes extérieures, ce n’est jamais une faiblesse.
Jihane Herizi
Merci beaucoup Arnaud pour cet échange. C’était extrêmement précieux.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve l’année prochaine pour la suite du Coup de Boost Agile.
Bonne soirée Arnaud, au revoir tout le monde.
Arnaud Denoix
Merci Jihane, merci pour l’invitation, et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter.